Durkheim : « l’art » éducatif, une domestication sociale ?
Education Sociologie et Anthropologie
12 Juil 2022
Imprimer
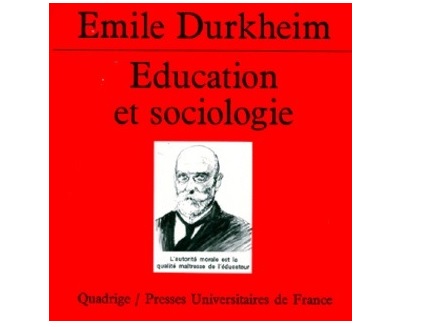
Note de lecture de :
Emile Durkheim, 1985 [1922], Education et sociologie, Paris, Quadrige/PUF, préface de Maurice Debesse, introduction de Paul Fauconnet
Émile Durkheim (1858-1917) est souvent présenté, dans les manuels scolaires dès le lycée et à l’université, comme le « grand-père » de la sociologie académique française. En effet, il est l’un des intellectuels de la fin du XIXème qui ont le plus réfléchi aux conditions nécessaires pour faire de la sociologie une science, dans la continuité d’Auguste Comte. Pour consolider celle-ci, il s’est efforcé de lui faire une place à l’université. Il débute en tant que chargé de cours en pédagogie et sciences sociales à l’université de Bordeaux en 1887, et publie de nombreux travaux de recherche, avant d’être nommé chargé de cours à la faculté des lettres de l’université de Paris en 1902. Il devient titulaire de la chaire de sciences de l’éducation en 1906 et succède à Fernand Buisson. Cette chaire devient, en 1913, chaire de sociologie.
On voit que chez Durkheim les questions d’ « éducation et sociologie » sont très proches tout au long de sa carrière universitaire. Il donne des cours sur l’éducation et la pédagogie, qui seront publiés à titre posthume, comme L’Éducation morale ou L’Évolution pédagogique en France. Le recueil dont je rend compte, Éducation et sociologie regroupe quant à lui « les seules études pédagogiques que Durkheim ait publiées lui-même » , selon Paul Fauconnet (p.39), sociologue proche de Durkheim, qui a rédigé l’introduction du recueil. Celui-ci se compose de deux longs articles publiés en 1911 dans le Nouveau dictionnaire de pédagogie dirigé par Fernand Buisson, la conférence donnée par Durkheim à son entrée à La Sorbonne en 1902, et une conférence donnée aux candidats aux agrégations de l’enseignement secondaire en 1905. Selon Fauconnet, ces textes forment une bonne introduction à l’oeuvre pédagogique de Durkheim. En effet ils sont connus, brefs, et plutôt accessibles. Pour ces raisons, selon moi, ils figurent aux programmes de lecture des étudiant·es en sciences sociales.
Cependant comme le précise le préfacier Maurice Debesse, professeur en sciences de l’éducation, toute doctrine pédagogique est contingente à son époque, et de nombreuses évolutions sont survenues. Il ne faudrait donc pas lire Durkheim comme un maître mais le « consulter » comme un ami (p.5-9). On peut donc se questionner à nouveau sur les apports et le sens des analyses de Durkheim, rapportés à notre contexte actuel.
Introduction. L’œuvre pédagogique de Durkheim, par Paul Fauconnet (p.11-40)
Durkheim a toujours enseigné et fait une place à la pédagogie. Il aborde l’éducation par le côté où « elle est un fait social » (p.11). Elle apparaît comme une socialisation et forme la partie sociale de l’individu (p.12-13). La philosophie universaliste reste spéculative sur le sujet : « la philosophie classique a presque toujours oublié de considérer l’homme réel d’un temps et d’un pays, le seul qui soit observable, pour spéculer sur une nature humaine universelle, produit arbitraire d’une abstraction faite, sans méthode, sur un nombre très restreint d’échantillons humains » (p.14) Il faut observer que « l’éducation est chose sociale : c’est-à-dire qu’elle met en contact l’enfant avec une société déterminée, et non avec la société in genere » (p.15). Selon Fauconnet, Durkheim ne veut pas là imposer un quelconque nationalisme. Son « réalisme » permet d’analyser les interactions entre individus et société (p.15-17).
La psychologie en éducation est selon Durkheim nécessaire mais non suffisante : c’est la sociologie qui doit accorder les pratiques et visées éducatives avec les attendus de la société (p.18-19). Pour cela elle se base sur l’observation des faits réels afin de proposer des réformes : « mieux on connaît la nature des choses, mieux on a de chances de l‘utiliser efficacement » (p.21). C’est ainsi qu’on peut concevoir une « pédagogie rationnelle » (p.22) : « l’opinion, le législateur, l’administration, les parents, les maîtres ont, à tout instant, des choix à faire, qu’il s’agisse de réformer profondément les institutions ou de les faire fonctionner au jour le jour. Or, ils travaillent sur une matière résistante qui ne se laisse pas manier arbitrairement : milieu social, institutions, habitudes, traditions, tendances collectives. La pédagogie, en tant qu’elle dépend de la sociologie, est la préparation rationnelle de ces choix » (p.23). La vision de Durkheim a des soubassements moraux, civiques. Il faut combiner la diversité des positions morales des individus avec l’impératif de faire société (p.23-29).
Chapitre premier. L’éducation, sa nature et son rôle (p.41)
Les définitions de l’éducation. Examen critique (p.41-47)
Durkheim refuse les définitions idéalistes et, globalement, métaphysiques de l’éducation, qui considèrent qu’elle doit servir au développement harmonieux des facultés, le « bonheur », la « vie » : ces conceptions sont impossibles à mettre en pratique. Il appelle à repartir du constat que « l’éducation a infiniment varié selon les temps et selon les pays » (p.44) : chaque société se dote de son « système d’éducation » qui s’impose aux individus. Ce système se construit à travers une multitude de facteurs dont le principe est l’histoire et « l’œuvre des générations antérieures » (p.46). On ne peut donc définir l’éducation par la seule dialectique, mais en commençant par observer concrètement à quoi elle a servi par le passé.
Définition de l’éducation (p.47-51)
L’idée de base est que l’éducation est l’action de générations adultes sur des générations plus jeunes. Mais quelle est cette action ? Le système d’éducation est « à la fois un et multiple » (p.47). Il est multiple du fait de la diversité des « milieux différents » qui coexistent, voire du fait des diverses professions spécialisée qui différencient forcément l’éudcation à un moment : « et cette spécialisation devient chaque jour plus précoce » (p.48). Mais en même temps la diversité des éducations repose sur une « base commune », qu’elle soit religieuse ou cimente un « esprit national » (p.49). En effet, « chaque société se fait un certain idéal de l’homme », sur le plan intellectuel, physique et moral, mais cet idéal diffère en partie selon les milieux. L’éducation doit susciter chez l’enfant certains « états » attendus par la société et par son milieu : « la société ne peut vivre que s’il existe entre ses membres une suffisante homogénéité : l’éducation perpétue et renforce cette homogénéité en fixant d’avance dans l’âme de l’enfant les similitudes essentielles que réclame la vie collective. Mais, d’un autre côté, sans une certaine diversité, toute coopération serait impossible : l’éducation assure la persistance de cette diversité nécessaire en se diversifiant elle-même et en se spécialisant » (p.50). La société se donne l’éducation qu’elle nécessite : « l’éducation n’est donc pour elle que le moyen par lequel elle prépare dans le cœur des enfants les conditions essentielles de sa propre existence (…) L’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné » (p.51).
Conséquence de la définition précédente : caractère social de l’éducation (p.51-58)
Dans ce chapitre fondamental, Durkheim établit que l’éducation est ce qui caractérise l’humain car c’est ce processus qui en fait un être social, contrairement aux animaux.
Ainsi, « l’éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération » (p.51). En d’autres termes, elle vise à forger « l’être social » en nous, c’est-à-dire à nous inculquer le « système d’idées, de sentiments et d’habitudes qui expriment en nous, non pas notre personnalité, mais le groupe ou les groupes différents dont nous faisons partie ». Ce « système » contrebalance les « états mentaux » qui relèvent de notre personnalité (p.51). En effet, « spontanément, l’homme n’était pas enclin à se soumettre à une autorité politique, à respecter une discipline morale, à se dévouer et se sacrifier » (p.52). Que s’est-il passé ? « C’est la société elle-même qui, à mesure qu’elle s’est formée et consolidée, a tiré de son propre sein ces grandes forces morales devant lesquelles l’homme a senti son infériorité ». Pour résumer : l’éducation « crée dans l’homme un être nouveau », contrairement à l’éducation chez les animaux qui « ne crée rien » (p.52).
Les qualités développées en chacun dépendent de ce que la société a sélectionné pour répondre à ses besoins de « fonctionnement » au fil de son développement, ces qualités devenant « désirables » selon ce que la société décide (p.52-53) : « même les qualités qui paraissent, au premier abord, si spontanément désirables, l’individu ne les recherche que quand la société l’y invite, et il les recherche de la façon qu’elle lui prescrit (…) Tandis que nous montrions que la société façonnant, suivant ses besoins, les individus, il pouvait semblait que ceux-ci subissaient de ce fait une insupportable tyrannie. Mais, en réalité, ils sont eux-mêmes intéressés à cette soumission ; car l’être nouveau que l’action collective, par la voie de l’éducation, édifie ainsi en chacun de nous, représente ce qu’il y a de meilleur en nous, ce qu’il y a en nous de proprement humain. L’homme, en effet, n’est un homme que parce qu’il vit en société » (p.55). En somme, par son action de socialisation et d’éducation, c’est la société qui fait accéder l’individu au statut d’humain, parce que « socialisé ». C’est la société qui nous apprend à nous réfréner, à sortir de l’égoïsme animal ; « c’est ainsi que nous avons acquis cette puissance de nous résister à nous-mêmes » (p.56).
Ainsi, la science et la religion sont aussi formées socialement, par la coopération de nombreux êtres sociaux, rendue possible par le langage : « sans le langage, nous n’aurions pour ainsi dire pas d’idées générales ; car c’est le mot qui, en les fixant, donne aux concepts une consistance suffisante pour qu’ils puissent être maniés commodément par l’esprit. C’est donc le langage qui nous a permis de nous élever au-dessus de la pure sensation ; et il n’est pas nécessaire de démontrer que le langage est, en premier chef, chose sociale » (p.56-57). En somme, sans la société, « l’homme sombrerait au rang de l’animal » (p.57). La société permet en effet l’accumulation des savoirs et le progrès : « le sol de la nature se recouvre ainsi d’une riche alluvion qui va sans cesse en croissant. Au lieu de se dissiper toutes les fois qu’une génération s’éteint et est remplacée par une autre, la sagesse humaine s’accumule sans terme, et c’est cette accumulation indéfinie qui élève l’homme au-dessus de la bête et au-dessus de lui-même » (p.57). Il n’y a donc pas d’opposition entre société et individu puisque l’un nourrit l’autre, la société fait grandir l’individu : « l’individu, en voulant la société, se veut lui-même » (p.57-58). L’éducation va en faire « un être vraiment humain » (p.58). Postulat normatif implicite : être humain est-ce mieux (et bien différent ?) d’être « animal » ??
Le rôle de l’État en matière d’éducation (p.58-61)
La société ne peut pas être absente des questions d’éducation scolaire : elle doit indiquer au maître les idées à transmettre sans quoi « la grande âme de la patrie se diviserait ». De ce fait, l’État doit nécessairement s’intéresser lui aussi à ce qui se passe dans les écoles (p.59). Ainsi, comme « chez nous, cette unité morale n’est pas, sur tous les points, ce qu’il faudrait qu’elle fût », c’est à l’État de « consacrer » une « communauté d’idées » mais sans que l’école devienne « la chose d’un parti ». Pour cela, il faut admettre que « il y a, dès à présent, à la base de notre civilisation, un certain nombre de principes qui, implicitement ou explicitement, sont communs à tous, que bien peu, en tout cas, osent nier ouvertement et en face : respect de la raison, de la science, des idées et des sentiments qui sont à la base de la morale démocratique » (p.60).
Pouvoir de l’éducation – Les moyens d’action (p.61-68)
On peut se demander comment rendre l’éducation « efficace », car il y a toujours eu des débats entre ceux qui disent que « l’éducation est toute-puissante » et ceux qui disent que l’inné domine. Il est d’accord pour dire que « l’éducation ne fait pas l’homme de rien » et qu’« elle s’applique à des dispositions qu’elle trouve toutes faites », telles que les « tendances congénitales » et autres « conditions organiques » qui font que d’un certain point de « tout l’avenir de l’individu se trouve fixé par avance, et il ne reste pas beaucoup à faire à l’éducation » (p.61). Mais il nuance immédiatement en disant que « les prédispositions innées » chez l’humain sont particulièrement « générales » et « vagues » et que, en d’autres termes, il n’existe aucune sorte d’ « instinct » (p.61-62).
On n’hérite donc d’aucune sorte de conduite sociale, mais plutôt de « facultés très générales » qui font que « l’avenir n’est pas étroitement prédéterminé par notre constitution congénitale » (p.62-63). En effet, « dire que les caractères innés sont, pour la plupart, très généraux, c’est dire qu’ils sont très malléables, très souples (…) » (p.63). Il signale ainsi que pour exercer cette action éducative, on est dans une situation analogue à la « suggestion hypnotique » : l’enfant est passif et le maître a un « ascendant » sur lui (p.64). Autrement dit, l’éducateur a un très grand « pouvoir », dont il faut se méfier : « bien loin que nous devions nous décourager de notre impuissance, nous avons plutôt lieu d’être effrayés par l’étendu de notre pouvoir » (p.65). Il précise ainsi que l’éducation ne fonctionne qu’avec le temps : « quand l’éducation est patiente et continue, quand elle ne recherche pas les succès immédiats et apparents, mais se poursuit avec lenteur dans un sens bien déterminé (…) » (p.65). Néanmoins, « l’éducation doit être essentiellement chose d’autorité » (p.66), car elle doit créer un être social et le « superposer » à l’être asocial que nous sommes à la base : « or, nous ne pouvons nous élever au-dessus de nous-mêmes que par un effort plus ou moins pénible. Rien n’est faux et décevant comme la conception épicurienne de l’éducation, la conception d’un Montaigne, par exemple, d’après laquelle l’homme peut se former en se jouant et sans autre aiguillon que l’attrait du plaisir. Si la vie n’a rien de sombre et s’il est criminel de l’assombrir artificiellement sous le regard de l’enfant, elle est cependant sérieuse et grave, et l’éducation, qui prépare à la vie, doit participer de cette gravité » (p.66).
L’enfant doit apprendre la « contention » à dépasser son « égoïsme naturel ». Or cette contention ne peut passer par la contrainte physique : elle doit donc passer par « le sentiment du devoir » (p.66). Les parents et éducateurs doivent donc incarner ce devoir : « c’est dire que l’autorité morale est la qualité maîtresse de l’éducateur. Car c’est par l’autorité qui est en lui que le devoir est le devoir ». Il doit avoir un « ascendant moral », ce qui implique de la « volonté » et de la « confiance ». Mais ce n’est pas le plus essentiel : « ce qui importe avant tout, c’est que l’autorité dont il doit donner le sentiment, le maître la sente réellement en lui » (p.67). En somme l’éducateur ou le maître doit avoir la foi : « ce n’est pas du dehors que le maître peut tenir son autorité, c’est de lui-même ; elle ne peut lui venir que d’une foi intérieure. Il faut qu’il croie, non en lui, sans doute, non aux qualités supérieures de son intelligence ou de son cœur, mais à sa tâche et à la grandeur de sa tâche. Ce qui fait l’autorité dont se colore si aisément la parole du prêtre, c’est la haute idée qu’il a de sa mission ; car il parle au nom d’un dieu dont il se croit, dont il se sent plus proche que la foule des profanes. Le maître laïc peut et doit avoir quelque chose de ce sentiment. Lui aussi, il est l’organe d’une grande personne morale qui le dépasse : c’est la société. De même que le prêtre est l’interprète de son dieu, lui, il est l’interprète des grandes idées morales de son temps et de son pays » (p.67-68).
La liberté et l’autorité ne doivent donc en aucun cas être opposées : « la liberté est fille de l’autorité bien entendue. Car être libre, ce n’est pas faire ce qui plaît ; c’est être maître de soi, c’est savoir agir par raison et faire son devoir. Or c’est justement à doter l’enfant de cette maîtrise de soi que l’autorité du maître doit être employée. L’autorité du maître n’est qu’un aspect de l’autorité du devoir et de la raison » (p.68).
Chapitre II. Nature et méthode de la pédagogie (p.69)
Il faut distinguer : éducation (« action exercée sur les enfants par les parents et les maîtres », même parfois inconsciemment) et pédagogie, qui renvoie aux théories sur l’éducation (p.69). Il n’y a donc pas toujours eu de pédagogie. Il faut se demander si cette dernière est une science, « la science de l’éducation » (p.70). Pour étudier cette question il reprend les 3 caractéristiques d’une science : 1) une science se définit par son objet 2) Il faut que les faits qui en sont l’objet « présentent entre eux une homogénéité suffisante » 3) la science étudie ces faits « pour les connaître, et seulement pour les connaître, d’une manière absolument désintéressée (…) La science commence dès que le savoir, quel qu’il soit, est recherché pour lui-même » (p.70-71). Dès lors, l’éducation a tout pour devenir un objet de science, car elle est une réalité très puissante contre laquelle il est vain de vouloir se révolter (p.72). Cette réalité est composée de faits qui « nous résistent » mais ont un point commun : « toutes les pratiques éducatives, quelles qu’elles puissent être, quelque différence qu’il y ait entre elles, ont en commun un caractère essentiel : elles résultent toutes de l’action menée par une génération sur la génération suivante en vue d’adapter celle-ci au milieu social dans lequel elle est appelée à vivre » (p.73). Cependant, une première difficulté de cette science de l’éducation est que « les pratiques éducatives ne sont pas des faits isolés les uns des autres » (p.73), chaque société, milieu social, développe ainsi différentes formes d’éducation. Étudier cette diversité est en soi une tâche de la science de l’éducation, de même qu’étudier le fonctionnement des institutions éducatives elles-mêmes (p.73-76). Il ressort de ces observations que la pédagogie est fort différente : elle doit, au contraire, « déterminer ce qui doit être » (p.77).
Qu’est-ce donc que la pédagogie ? On peut dire qu’il s’agit d’un art, mais ce terme peut être confus car il peut renvoyer à « l’expérience pratique (…) dans l’exercice de la profession » (p.78), alors que la pédagogie contient une réflexion spéculative : « on peut être un parfait éducateur et pourtant être tout à fait impropre aux spéculations de la pédagogie. Le maître habile sait faire ce qu’il faut, sans pouvoir toujours dire les raisons qui justifient les procédés qu’il emploie ; inversement, le pédagogue peut manquer de toute habileté pratique ; nous n’aurions pas confié une classe ni à Rousseau ni à Montaigne » (p.78). L’art du pédagogue n’a donc rien à voir avec celui de l’éducateur. « Il faut, croyons-nous, réserver le nom d’art à tout ce qui est pratique pure sans théorie » (p.78-79). Autrement dit, « un art est un système de manières de faire qui sont ajustées à des fins spéciales et qui sont le produit soit d’une expérience traditionnelle communiquée par l’éducation, soit de l’expérience personnelle de l’individu. On ne peut les acquérir qu’en se mettant en rapport avec les choses sur lesquelles doit s’exercer l’action et en agissant soi-même. Sans doute, il peut se faire que l’art soit éclairé par la réflexion, mais la réflexion n’en est pas un élément essentiel, puisqu’il peut exister sans elle. Même, il n’existe pas un seul art où tout soit réfléchi » (p.79). Mais entre l’art et la science, il y a une « attitude mentale intermédiaire », lorsqu’on réfléchit sur les procédés d’action ; pour chercher à les « apprécier » voir les modifier. « (…) Les idées ainsi combinées ont pour objet, non d’exprimer la nature des choses données, mais de diriger l’action », ce sont d’une certaine façon des « programmes d’action ». Ainsi, « pour exprimer le caractère mixte de ces sortes de spéculations, nous proposons de les appeler des théories pratiques ». La pédagogie en fait partie : « elle n’étudie pas scientifiquement les systèmes d’éducation, mais elle y réfléchit en vue de fournir à l’activité de l’éducateur des idées qui le dirigent » (p.79).
Reste alors à déterminer sur quelle science la pédagogie doit s’appuyer : sociologie et psychologie sont jeunes et controversées, la science de l’éducation est à « l’état de projet » (p.79-80). Pourtant, le problème est que la société évolue et il est faut réfléchir à l’adaptation du système d’éducation car « rien n’est vain comme ces tentations pour donner une vie artificielle et une autorité d’apparence à des institutions vieilles et discréditées (…) » (p.81). Il faut s’atteler au changement par la réflexion : « qu’est-ce que la pédagogie, si ce n’est la réflexion appliquée le plus méthodiquement possible aux choses de l’éducation en vue d’en régler le développement ? » (p.81). Il faut donc rassembler les faits et les interpréter avec méthode, accepter de prendre des risques malgré le fait que les sciences en la matière ne soient pas matures : « l’action ne va jamais sans risques ; la science, si avancée qu’elle puisse être, ne saurait les supprimer » (p.82). Par ailleurs la pédagogie est utile à l’éducation au quotidien : « si l’art de l’éducateur est fait, avant tout, d’instincts et d’habitudes devenues presque instinctives, il est cependant nécessaire que l’intelligence ne s’en retire pas » (p.82). L’éducateur doit en effet prendre soin du « germe d’individualité » en chaque enfant, s’adapter à chacun : « une éducation empirique, machinale, ne peut pas ne pas être compressive et niveleuse ». L’éducation doit faire preuve de réflexion sur ses méthodes et ses fins pour dépasser « l’obstacle aux progrès » qu’est « la routine » (p.83).
Pour se développer et comprendre le système éducatif actuel, la pédagogie doit commencer par regarder son histoire : « ce système d’éducation est un produit de l’histoire que l’histoire seule peut expliquer. C’est une véritable institution sociale » (p.85). Cela inclut d’étudier l’histoire des doctrines éducatives en vigueur : « la culture pédagogique doit avoir une base largement historique (…) Trop de pédagogues, et parmi les plus illustres, ont entrepris d’édifier leur système en faisant abstraction de ce qui avait existé avant eux » (p.87). Il ne faut donc pas « se placer en dehors des conditions du réel. L’avenir ne peut être évoqué du néant : nous ne pouvons le construire qu’avec les matériaux que nous a légués le passé » (p.87). A l’histoire il faut ajouter la « psychologie infantile » et la « psychologie collective » (psychologie de groupe)(p.89) afin de connaître les moyens à utiliser en éducation, pour fonder la pédagogie : « la conscience de ses lois propres, qu’il faut connaître pour pouvoir les modifier » (p.88).
Chapitre III. Pédagogie et sociologie (p.91)
Il est honoré de prendre la suite de F. Buisson à la chaire mais explique qu’il n’ a pas la même « compétence » ou la même approche : il parlera de l’éducation en « sociologue », précisant : « je considère, en effet, comme le postulat même de toute spéculation pédagogique que l’éducation est chose éminemment sociale, par ses origines comme par ses fonctions, et que, par la suite, la pédagogie dépend de la sociologie plus étroitement que de toute autre science » (p.92).
I) p.93
Il commence par signaler que jusqu’à il y a peu, on considérait qu’à l’image d’une supposée « nature humaine », l’éducation aussi était « une » (p.93-94). La réalité contredit cette conception : à l’intérieur même d’une société, les milieux sociaux ont des éducations différentes, et celles-ci tendent même à se « spécialiser » de façon de plus en plus « précoce », selon les fonctions professionnelles auxquelles il faut préparer chacun (p.94-95). C’est la société qui influence le plus fortement ces spécialisations, par le biais de l’éducation (p.96). Cependant, cette spécialisation entraîne une « déchéance partielle » car certaines « fonctions » ne sont plus développées : « nous ne pouvons développer avec l’intensité nécessaire les facultés qu’implique spécialement notre fonction, sans laisser les autres s’engourdir dans l’inaction, sans abdiquer, par conséquent, toute une partie de notre nature. Par exemple, l’homme, en tant qu’individu, n’est pas moins fait pour agir que pour penser. Même, puisqu’il est avant tout un être vivant et que la vie c’est l’action, les facultés actives lui sont peut-être plus essentielles que les autres. Et cependant, à partir du moment où la vie intellectuelle des sociétés a atteint un certain degré de développement, il y a et il doit nécessairement y avoir des hommes qui s’y consacrent exclusivement, qui ne fassent que penser. Or la pensée ne peut se développer qu’en se détachant du mouvement, qu’en se repliant sur elle-même, qu’en détournant de l’action le sujet qui s’y donne. Ainsi se forment ces natures incomplètes où toutes les énergies de l’activité se sont, pour ainsi dire, converties en réflexion, et qui, pourtant, quelque tronquées qu’elles soient par certains côtés, constituent les agents indispensables du progrès scientifique » (p.96-97).
Néanmoins les diverses « éducations spéciales » ont une « base commune », une éducation générale qui est spécifique à une société (p.97). Ces éducations sont contingentes : « ce n’est pas que, par suite d’aberrations, les hommes se soient mépris sur leur nature d’hommes et sur leurs besoins, mais c’est que leurs besoins ont varié, et ils ont varié parce que les conditions sociales dont dépendent les besoins humains ne sont pas restées les mêmes » (p.98). On a du mal à admettre cette contingence pour l’éducation moderne. La diversité des origines et la division du travail semblent créer en effet une grande hétérogénéité mais justement : peut-être que le « type collectif » à promouvoir par nos sociétés modernes doit-il désormais être « le type générique d’homme » (p.99-100). Et c’est bien la société qui décide de « l’homme que l’éducation doit réaliser en nous » (p.100), et imprime la marque de ses évolutions : « ainsi, dans le présent comme dans le passé, notre idéal pédagogique est, jusque dans ses détails, l’œuvre de la société. C’est elle qui nous trace le portrait de l’homme que nous devons être, et dans ce portrait viennent se refléter toutes les particularités de son organisation » (p.101).
II) p.101
L’éducation est ainsi « socialisation méthodique de la jeune génération », un « moyen » par lequel la société se perpétue en assurant homogénéité et différence entre ses membres : il y a en nous deux êtres – individuel et social – qu’on ne peut séparer que par abstraction : « en chacun de nous, peut-on dire, il existe deux êtres, qui, pour être inséparables autrement que par abstraction, ne laissent pas d’être distincts. L’un est fait de tous les états mentaux qui ne se rapportent qu’à nous-même et aux événements de notre vie personnelle. C’est ce qu’on pourrait appeler l’être individuel. L’autre est un système d’idées, de sentiments, d’habitudes qui expriment en nous, non pas notre personnalité, mais le groupe ou les groupes différents dont nous faisons partie ; telles sont les croyances religieuses, les croyances et les pratiques morales, les traditions nationales ou professionnelles, les opinions collectives de toute sorte. Leur ensemble forme l’être social. Constituer cet être en chacun de nous, telle est la fin de l‘éducation » (p.102).
Rien ne nous prédispose à nous incliner devant tel ou tel emblème. L’éducation « crée dans l’homme un homme nouveau » (p.103), comme le montre les croyances relatives à la « cérémonie de l’initiation »dans les diverses sociétés. Cet être nouveau c’est l’être social : ses qualités sont déterminées par la société ; y compris certaines « vagues et confuses prédispositions ». Pour cette raison, la psychologie, seule, est insuffisante à fonder la pédagogie (p.104-107).
III) p.107
Concernant les « moyens » et les « lois de la conscience », c’est à la psychologie qu’il faut effectivement se fier. En revanche si la pédagogie est importante dans « la science de l’individu », il ne faut pas se passer de la sociologie car « les fins de l’éducation sont sociales » (p.108), les institutions pédagogiques sont donc des analogies des institutions sociales : « la vie scolaire n’est que le germe de la vie sociale (…) On peut donc s’attendre à ce que la sociologie, science des institutions sociales, nous aide à comprendre ce que sont ou à conjecturer sur ce que doivent être les institutions pédagogiques. Mieux nous connaîtrons la société, mieux nous pourrons nous rendre compte de tout ce qui se passe dans ce microcosme social qu’est l’école » (p.109). Les techniques pédagogiques et les moyens sont dépendants des orientations sociales : « c’est donc toujours à l’étude de la société qu’il faut en revenir ; c’est là seulement que le pédagogue peut trouver les principales de la spéculation » (p.110). L’importance de ce type d’étude est d’autant plus prégnant que la société évolue : « il ne s’agit plus de mettre en œuvre des idées acquises, mais de trouver des idées qui nous guident » (p.111), il faut sonder la société pour trouver à quels besoins répondre. « Jamais une culture sociologique n’a été plus nécessaire à l’éducateur. Ce n’est pas que la sociologie puisse nous mettre en main des procédés tout faits et dont il n’y ait plus qu’à se servir. En est-il, d’ailleurs, de cette sorte ? Mais elle peut plus et elle peut mieux. Elle peut nous donner ce dont nous avons le plus instamment besoin, je veux dire un corps d’idées directrices qui soient l’âme de notre pratique et qui la soutiennent, qui donnent un sens à notre action, et qui nous y attachent ; ce qui est la condition nécessaire pour que cette action soit féconde » (p.112).
Chapitre IV. L’évolution et le rôle de l’enseignement secondaire en France (p.113)
Il ne cherche pas à apprendre aux enseignants « la technique de leur métier », car « elle ne peut s’apprendre que par l’usage ». Cependant, « une technique, quelle qu’elle soit, dégénère vite en un vulgaire empirisme, si celui qui s’en sert n’a jamais été mis à même de réfléchir au but qu’elle poursuit et aux moyens qu’elle emploie » (p.113). Il va donc chercher à stimuler la « réflexion » et donner au « praticien » avant tout « une pleine conscience de sa fonction » (p.113). En effet, « en un temps où, dans toutes les sphères de l’activité humaine, on voit la science, la théorie, la spéculation, c’est-à-dire en somme la réflexion, pénétrer de plus en plus la pratique et l’éclairer, il serait par trop étrange que, seule, l’activité de l’éducateur fît exception » (p.114).
On a tendance à croire que le professeur de lycée a une formation suffisante et que la « la puissance de sa réflexion » va se déployer naturellement au contact des élèves (p.114), pourtant, il faut continuer à exercer cette « réflexion » pour éviter la « routine » et l’ « immobilisme », et arriver à penser en dehors de sa « spécialité » (p.115). En effet, « chaque catégorie de faits demande à être réfléchie à sa façon, d’après les méthodes qui lui sont propres ; et ces méthodes ne s’improvisent pas, mais doivent s’apprendre. Il ne suffit donc pas d’avoir réfléchi aux finesses des langues mortes, ou aux lois des mathématiques, ou aux événements de l’histoire soit ancienne, soit moderne, pour être ipso facto en état de réfléchir méthodiquement aux choses de l’enseignement » (p.116). Par ailleurs, la « réflexion pédagogique » est nécessaire dans le secondaire car c’est « un organisme autrement complexe que ne l’est l’enseignement primaire (…) » (p.116). Cela d’autant que, paradoxalement, les enseignants dans le secondaire se spécialisent par rapport au primaire, et s’isolent les uns des autres : il faut que les enseignants aient malgré cela « le sentiment de ce tout » (p.117). S’il faut « former un esprit » à travers le secondaire, « comment chaque maître pourra-t-il s’acquitter de sa fonction, de la part qui lui revient dans l’œuvre totale, s’il ne sait pas quelle est cette œuvre, comment ses divers collaborateurs y concourent avec lui, de manière que ses efforts rejoignent les leurs ? » (p.117).
Cependant, la formule « former un esprit » reste assez vague : « tout ce qu’elle énonce, c’est qu’il ne faut pas spécialiser les esprits » (p.117). Pourtant, au lycée, « chacun professe sa spécialité comme si elle était une fin en soi », et dans ce cas les professeurs ont peu à se dire car « tout objectif commun fait défaut » (p.118). Il faut que les enseignants prennent conscience du tout auquel ils appartiennent. Pour cela, il faudrait une visée : dire qu’on veut faire de nos élèves des humains ne suffit pas : « il s’agit précisément de savoir quelle idée nous devons nous faire de l’homme » (p.119). Cette visée relève d’un idéal et ne se décrète pas : « quelle qu’en soit l’autorité, règlements et arrêtés ne sont jamais que des mots qui ne peuvent devenir des réalités qu’avec le concours de ceux qui sont chargés de les appliquer. Si donc vous, qui aurez pour fonction de les faire vivre, vous ne les acceptez qu’à contrecœur, si vous les subissez sans y adhérer, ils resteront lettre morte et sans résultats utiles (…) On ne décrète pas l’idéal, il faut qu’il soit compris, aimé, voulu par tous ceux qui ont le devoir de le réaliser » (p.120).
Pour l’instant, l’enseignement secondaire est en difficulté car cet idéal nouveau manque : « aucune foi nouvelle n’est encore venue remplacer celle qui disparaît » or « un corps enseignant sans foi pédagogique, c’est un corps sans âme » (p.121). Pour effectuer ces changements il faut tenir compte de l’institué, des « institutions pédagogiques », et du « mouvement vers autre chose », qui les fracasse sans cesse : ne pas souhaiter l’effondrement du système actuel mais plutôt « couler des idées neuves dans des moules antiques », au mieux… car « l’avenir ne s’improvise pas » et les démarches « révolutionnaires » sont iconoclastes et dangereuses (p.122-123).
Pour réformer les institutions il faut donc d’abord bien les connaître. L’histoire peut nous en apprendre beaucoup : si l’enseignement secondaire n’a pas existé de tous temps, c’est qu’il répond à des besoins et conditions spécifiques (p.124). Par ailleurs, il y a de réels efforts de recherche objective à mener, en sortant hors de nous et des idées et vues à travers lesquelles notre milieu nous façonne (p.125-127). Il n’a donc pas l’intention de « prêcher » aucune foi, mais de faire que « la science des choses humaines » puisse « guider utilement la conduite humaine ». Or « pour se bien conduire, dit un vieil adage, il faut se connaître » (p.129). Cependant, « pour se bien connaître, il ne suffit pas tourner notre attention sur la partie superficielle de notre conscience ; car les sentiments, les idées qui viennent y affleurer ne sont pas, il s’en faut, celles qui ont le plus d’efficacité sur notre conduite. Ce qu’il faut atteindre, ce sont les habitudes, les tendances qui se sont constituées peu à peu au cours de notre vie passée, ou que nous a léguées l’hérédité ; ce sont là les vraies forces qui nous mènent. Or elles se dissimulent dans l’inconscient » (p.129).
