Une critique de l’aliénation et du système économique par K. Marx dans sa jeunesse
08 Jan 2023
Imprimer
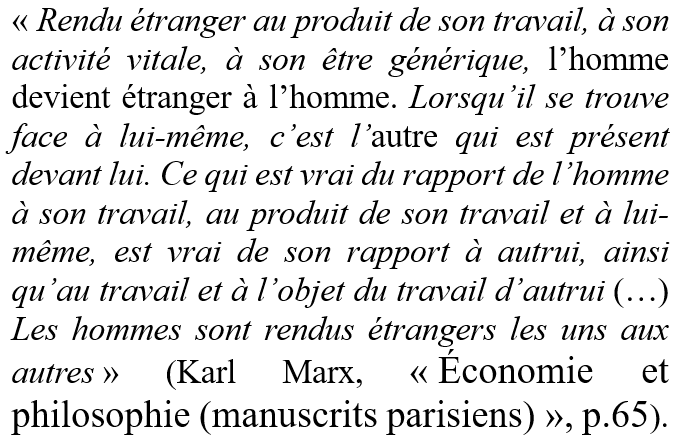
Note de lecture de :
Marx, K., 1968, « Économie et philosophie (manuscrits parisiens) », in Œuvres. Économie II, Paris, Gallimard, Coll. « Bibliothèque de La Pléiade », pp.1-141.
Vers le milieu de sa vingtaine, Karl Marx (1818-1883) a commencé à publier des articles de journaux en Allemagne, dans lesquels il critique le système politique et l’Etat absolu, il dénonce des injustices, et polémique avec d’autres auteurs. Il exprime son engagement pour la cause de « l’émancipation des travailleurs » dans plusieurs textes écrits entre 1842 et 1844, et à propos desquels j’ai rédigé des notes de lecture :
- L’introduction à la Critique de la philosophie de Hegel, écrite en 1843
- La réaction au livre de B. Bauer intitulé « La question juive » , écrite en 1844
- L’introduction à un livre critique sur la philosophie du droit de Hegel, écrite en 1844
A travers ces textes aux noms complexes, Marx souhaite en fait développer une « critique totale des institutions » de la société moderne, d’après M. Rubel : religion, politique, morale, travail… En raison de la teneur de ces écrits, Marx est expulsé d’Allemagne par les autorités, et trouve refuge en France, où il fréquentera les milieux ouvriers, croisera son ami Friedrich Engels pour la première fois, mais aussi Proudhon…
Durant cette période, Marx poursuit sa découverte critique des théories dominantes en économie politique. Il note ses réflexions critique sur le système économique et sur l’aliénation dans des manuscrits, que l’on appelle souvent les Manuscrits de 1844 ou encore Manuscrits parisiens. Le film Le jeune Karl Marx retrace cette période durant laquelle Marx a baigné dans l’effervescence parisienne.
Ces manuscrits seront publiés après le décès de Marx. Malgré leur caractère inachevés (Marx ne les destinait pas à être publiés en tant que tels), ils seront considérés au XXème siècle comme une des plus grandes oeuvres « de jeunesse » de Marx. En effet, on y voit apparaître différents raisonnements que Marx perfectionnera au fil de sa carrière, dans sa démarche critique du système capitaliste. Mais on voit également en quoi Marx finit de digérer certaines approches philosophiques qui ont influencé sa construction (Hegel, Feuerbach…) pour commencer à définir sa propre approche matérialiste.
La première partie des Manuscrits publiés dans les éditions de La Pléiade est constituée de notes de lectures des économistes de l’époque. La seconde partie est un ensemble de « fragments » comme dit Rubel, intitulée Ébauche d’une critique de l’économie politique : partie la plus percutante selon moi, car Marx tente une critique générale du système économique décrit dans les livres des théoriciens dominants de l’époque, et il discute notamment du concept d’aliénation dans des pages vraiment passionnantes (voir ci-dessous « Le travail aliéné », p.56). Les Manuscrits s’achèvent sur une critique de la dialectique hégélienne. La pagination suivante à laquelle je me réfère est celle de l’édition de La Pléiade, présentée par Maximilien Rubel.
Avant-propos, par Marx (p.5) :
Marx dit qu’il voulait développer une critique du droit, de la morale, de la politique, etc. et que la suite viendra. Il évoque ses sources d’étude de l’économie (socialistes français, allemands, économistes scientifiques…) (p.5). Il estime que Feuerbach est « la seule véritable révolution dans la théorie » depuis les travaux de Hegel (p.6). Il reste désormais à dépasser la théologie hégélienne : « Même critique, le théologien reste théologien » (p.6).
1. Notes de lectures (p.7).
Il s’agit de fragments à l’allure d’aphorismes, sur un ton hégélien mais percuté par l’économie politique. Y est critiquée l’approche idéaliste de l’économie politique, qui prend comme base la propriété privée sans l’expliquer : « en refusant toute importance à la vie elle-même, les abstractions de l’économie politique ont atteint le sommet de l’infamie (…) l’humanité se situe au-dehors de l’économie politique, l’inhumanité au-dedans» (p.12-13).
« C’est le cercle vicieux habituel de l’économie politique : le but, c’est la liberté de l’esprit ; donc, pour la majorité, c’est la servitude abrutissante. Les besoins physiques, ce n’est pas le seul but ; donc, pour la majorité, c’est l’unique but » (p.11).
Il aborde l’aliénation par l’argent en la comparant avec l’aliénation religieuse (influence de Moses Hess) :
« ce qui, de prime abord, caractérise l’argent, ce n’est pas le fait que la propriété s’aliène en lui. Ce qui y est aliéné, c’est l’activité médiatrice, c’est le mouvement médiateur, c’est l’acte humain, social, par quoi les produits de l’homme se complètent réciproquement ; cet acte médiateur devient la fonction d’une chose matérielle en dehors de l’homme, une fonction de l’argent ».
L’homme se retrouve ainsi « au comble de la servitude » et ce médiateur devient un dieu : « son culte devient une fin en soi. Les objets, isolés de ce médiateur, ont perdu leur valeur ». L’argent est une « médiation aliénée » (p.17). Les économistes savent bien d’ailleurs que l’argent n’a pas qu’une forme matérielle, mais est aussi une valeur abstraite et universelle (p.18-19).
Le « crédit » en tant que prêt d’argent aux pauvres est de ce point de vue une « déshumanisation » particulièrement « infâme » parce qu’elle atteint le « cœur humain », et que « sous l’apparence de la confiance de l’homme en l’homme, elle est la suprême défiance et la totale aliénation » (p.20). En effet, « le crédit est le jugement que l’économie politique porte sur la moralité d’un homme », l’homme devient un « capital » assorti d’ « intérêts » avec le crédit : « ce n’est pas l’argent qui s’abolit dans l’homme au sein du système du crédit ; c’est l’homme lui-même qui se change en argent (…) Le crédit taille la valeur monétaire non pas dans l’argent, mais dans la chair humaine, dans le cœur humain » (p.21). Celui qui n’obtient pas de crédit est vu comme un « paria » à qui on ne peut faire confiance : il doit mentir, simuler pour en obtenir un, et le créditeur doit se méfier, espionner… (p.22).
Une communauté qui ne se reconnaît pas comme humaine et constituée de « l’être de chaque individu » est une communauté aliénante. Il explique de manière un peu hégélienne que si l’on suit l’économie politique, qui fonde la communauté humaine sur l’échange et le commerce, on a l’image d’une communauté aliénée, « caricature » d’une communauté humainement fondée (p.23) : l’économie politique ne voit les individus que comme des propriétaires privés animés par les intérêts au commerce, « l’économie politique fixe la forme aliénée des rapports sociaux comme le mode essentiel et originel du commerce humain et le donne pour conforme à la vocation humaine » (p.24).
Le travail est aliéné par l’échange lucratif : « le travail était la source de subsistance directe, mais en même temps l’affirmation de l’existence individuelle. Par l’échange, le travail est devenu en partie une source d’acquisition. Son but et sa réalité ne sont plus les mêmes. Le produit est fabriqué comme valeur, valeur d’échange, comme équivalent et non plus à cause de sa relation immédiate et personnelle avec le producteur (…) », le lucratif devient fin en soi (p.26-27). La conséquence est que « plus le pouvoir de la société paraît grand et organisé dans le système de la propriété privée, plus l’homme devient égoïste : il se sent étranger vis-à-vis de la société et vis-à-vis de son propre être » (p.27).
La division du travail elle-même, « change l’homme en un être abstrait, en une machine-outil, etc., pour le réduire à un monstre physique et intellectuel » (p.27). Ainsi, « si l’unité du travail humain n’est plus conçue que sous l’aspect de la division, c’est que l’être social n’existe que sous la forme de l’aliénation, comme un être qui est le contraire de lui-même », en effet l’homme produit « dans l’indifférence totale » à la seule fin de pouvoir obtenir de l’argent : « l’argent incarne l’indifférence totale vis-à-vis de la nature de la matière (…) l’argent incarne la domination totale de l’objet aliéné sur l’homme ». Il y a une « domination universelle de l’objet sur la personne, du produit sur le producteur » (p.28).
La propriété privée suppose que l’homme « ne produit que pour avoir » (p.29).
En tant qu’humains, on n’a aucun pouvoir sur ce que produit autrui, on en est donc dépendant (p.30). Avec l’échange lucratif cependant, l’autre devient « le moyen et l’instrument » (p.32), « c’est le pillage réciproque » (p.31). Dès lors, « le seul langage compréhensible que nous puissions parler l’un à l’autre est celui de nos objets dans leurs rapports mutuels. Nous serions incapables de comprendre un langage humain : il resterait sans effet. Il serait compris et ressenti d’un côté comme prière et imploration, et donc comme une humiliation ; exprimé honteusement, avec un sentiment de mépris, il serait reçu par l’autre côté comme une impudence ou une folie et repoussé comme telle. Nous sommes à ce point étrangers à la nature humaine qu’un langage direct de cette nature nous apparaît comme une violation de la dignité humaine ; au contraire, le langage aliéné des valeurs matérielles nous paraît le seul digne de l’homme, la dignité justifiée, confiante en soi et consciente de soi » (p.32). Au final :
tu es devenu, en fait, ton propre moyen, l’instrument de ton objet dont ton désir est l’esclave, et tu as accepté de travailler en esclave afin que l’objet ne soit plus jamais une aumône à ton désir (…) La valeur que chacun de nous possède aux yeux de l’autre est la valeur de nos objets respectifs. Par conséquent, l’homme lui-même est pour chacun de nous sans valeur
p. 33
Une production humaine est une production dans laquelle chacun puisse s’affirmer réciproquement : « nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l’un vers l’autre » (p.33).
Que prouvent les moyennes utilisées en économie ? « Que l’on fait de plus en plus abstraction des hommes, que l’on écarte de plus en plus la vie réelle, et que l’on ne considère que le mouvement abstrait de la propriété matérielle, inhumaine. Les moyennes sont de vrais outrages infligés aux individus réels » (p.35). Les lois de l’économie politique sont d’ailleurs abstractions : « La loi et les économistes ne se soucient absolument pas des milliers de gens voués à la ruine par l’action de cette loi ». Plus l’économie reconnaît le « travail accumulé » comme source de richesse, plus elle dégrade paradoxalement l’homme car son travail devient marchandise (p.36). Les lois de l’économie politique doivent forcément faire abstraction des « conditions actuelles » et sont donc « pure abstraction » (p.37). « Les économistes ne trouvent pas étrange qu’il puisse y avoir abondance de produits dans un pays où la plupart des gens manquent cruellement des subsistances les plus élémentaires. Ils savent que la richesse a pour condition une misère incommensurable » (p.41).
2. Ébauche d’une critique de l’économie politique (p.44)
Salaire, profit et rente foncière (p.44).
Salaire (p.44).
La réalité des ouvriers contredit la vision théorique de l’économie politique sur la place des ouvriers : ces derniers reçoivent en salaire de quoi « perpétuer non pas l’humanité, mais la classe des esclaves ouvriers » (p.44). Par ailleurs, « alors que la division du travail en augmente la force productive, la richesse et le raffinement de la société, elle appauvrit l’ouvrier en le ravalant à l’état de machine ». Ainsi, « sans que l’économiste le sache lui-même, ses conceptions démontrent que le travail comme tel – non seulement dans les conditions présentes, mais en général, pour autant que son seul but est l’accroissement de la richesse – est nuisible et funeste » (p.45).
« Le travailleur souffre le plus quand la société est sur le déclin (…) » (p.45). L’économie politique ne voit le prolétaire que comme travailleur, et « quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ». Il y a deux questions à étudier : quel sens donner au fait que « la majeure partie des hommes est réduite au travail abstrait », et quelles sont les erreurs des « réformateurs en détail » qui veulent simplement élever le salaire, améliorer la condition ouvrière, garantir l’égalité de salaire (p.46).
Profit du capital (p.46).
Il copie et commente des extraits d’économistes qui lui font dire : « le capital est le pouvoir qui règne sur le travail et ses produits » (p.46-47).
Rente foncière (p.47).
Il contredit l’idée de l’économie politique selon laquelle le propriétaire est intéressé au bien-être de la société. Les intérêts des propriétaires fonciers ou industriels sont opposés à ceux des travailleurs (p.48). Il y a concurrence entre petits et grands propriétaires mais les seconds finissent par l’emporter (p.48-49) et les logiques capitalistes s’immiscent du fait de cette concurrence, « une partie de la grande propriété foncière devient industrielle », et les différences entre propriétaires et capitalistes disparaissent… (p.50) : la dimension lucrative prend nécessairement le dessus (p.52). Les masses paysannes sont ainsi poussées vers l’industrie, concurrence qui finit par ruiner la propriété foncière concentrée (p.53-55).
Le travail aliéné (p.56)
Marx s’exprime dans ce texte avec un « style personnel », et dans une « volonté de synthèse », visant à dépasser sa culture philosophique et ses lectures économiques dans une visée « éthique » selon Rubel (p.1608).
Il y a enjeu à une critique de l’économie politique (Marx n’emploie pas ce terme ici), car celle-ci sépare tout est prend comme prémices des idées abstraites et arbitraires sans les expliquer : propriété privée, séparation du travail, de la terre, du capital (p.56-57). Lui veut donc refaire le lien entre tous ces éléments, et notamment entre « toute cette aliénation et le système de l’argent » (p.57). Il veut procéder en partant d’un « fait économique » : le travail aliéné « du point de vue du travailleur » [p.66].
Il y a donc un premier sens de l’aliénation : aliénation du produit matérialisé du travail (réification) : le produit du travail s’oppose au travail comme un « être étranger » car « le produit du travail est le travail qui s’est fixé, matérialisé dans un objet, et il est la transformation du travail en objet ». Par conséquent, parfois, « la réalisation du travail se manifeste comme déperdition de réalité, au point que l’ouvrier est vidé de sa réalité jusqu’à en mourir d’inanition » (qu’on songe aux maladies du travail). C’est parce que « l’ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le même rapport qu’avec un objet étranger » et le monde des objets autour de lui devient de plus en plus puissant, de manière similaire avec la religion : « plus l’homme place en Dieu, moins il conserve en lui-même (…) » (p.58).
« La dépossession[Entäusserung] de l’ouvrier au profit de son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et qu’il devient une puissance autonome face à lui. La vie qu’il a prêtée à l’objet s’oppose à lui, hostile et étrangère » (p.59).
L’économie politique cache « l’aliénation qui marque le travail », et notamment le fait que « des machines remplacent le travail, mais une partie des ouvriers est rejetée dans un travail barbare, l’autre est elle-même transformée en machines » (p.60).
On en arrive à un deuxième sens de l’aliénation : celle-ci n’est pas que dans le produit matérialisé mais également dans « l’acte de production ». « L’aliénation de l’objet du travail n’est que le résumé de l’aliénation », il y a également « dépossession du travail », c’est-à-dire que le travail lui-même est « extérieur », que « dans son travail, l’ouvrier ne s’affirme pas, mais se nie (…) » (p.60). L’ouvrier n’a le sentiment d’être à soi qu’en dehors du travail. Autrement dit, le travail est extérieur et forcé : « Travail forcé, il n’est pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, on fuit le travail comme la peste. Le travail aliéné, le travail dans lequel l’homme se dépossède, est sacrifice de soi, mortification. Enfin, l’ouvrier ressent le nature extérieure du travail par le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas ; que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas à lui-même, mais à un autre » (p.61). L’homme n’a plus de spontanéité que dans ses « fonctions animales » (p.61).
Il propose une synthèse des deux premiers sens (p.61-62) :
- « 1° le rapport de l’ouvrier au produit du travail comme objet étranger qui le tient sous sa puissance. Il se trouve dans le même rapport au monde extérieur sensible qu’aux objets de la nature, c’est un monde étranger, qui lui est contraire et hostile
- 2° le rapport entre le travail et l’acte de production à l’intérieur du travail ; c’est le rapport de l’ouvrier à sa propre activité comme activité étrangère, qui ne lui appartient pas ; c’est l’activité comme passivité ; c’est la force comme impuissance, la procréation comme émasculation ; c’est sa propre énergie physique et intellectuelle, sa vie – car qu’est-ce que la vie, sinon l’activité ? – comme activité dirigée contre lui-même, indépendante de lui, ne lui appartenant pas. C’est l’aliénation de soi venant après l’aliénation de l’objet »
Il reste à étudier un troisième sens de l’aliénation : l’humain se distingue par le fait qu’il développe une activité vitale consciente dans ses rapports avec la nature. Le travail aliéné le sépare de cette activité et donc de sa nature et son espèce (Rubel signale ici une « anthropologie qui n’est pas exempte d’anthropocentriste » p.1609).
L’homme fait partie de la nature et vice versa :
« Concrètement, l’universalité de l’homme apparaît précisément dans le fait que le nature entière constitue son prolongement non organique, dans la mesure où elle est son moyen de subsistance immédiat et la matière, l’objet et l’outil de son activité vitale. La nature, pour autant qu’elle n’est pas elle-même le corps humain, est le corps non organique de l’homme. L’homme vit de la nature – ce qui signifie que la nature est son corps et qu’il doit maintenir des rapports constants avec elle pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et intellectuelle de l’homme est liée à la nature ne signifie rien d’autre que la nature est liée à elle-même, car l’homme est une partie de la nature » (p.62).
Par conséquent « le travail aliéné rend l’espèce humaine étrangère à l’homme (…) Il aliène la vie de l’espèce et la vie de l’individu ». Alors que c’est la spécificité de l’humain que de déployer une « activité libre, consciente » : « l’homme fait de son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente (…) », tandis que l’animal ne produit que pour répondre à des besoins pratiques immédiats (p.63).
« L’homme produit alors même qu’il est libéré du besoin physique, et il ne produit vraiment que lorsqu’il en est libéré ». Ainsi, « l’objet du travail est donc la réalisation de la vie générique de l’homme. L’homme ne se recrée pas seulement d’une façon intellectuelle, dans sa conscience, mais activement, réellement, et il se contemple lui-même dans un monde de sa création. En arrachant à l’homme l’objet de sa production, le travail aliéné lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique, et en lui dérobant son corps non organique, sa nature, il transforme en désavantage son avantage sur l’animal. De même, en dégradant au rang de moyen la libre activité créatrice de l’homme, le travail aliéné fait de sa vie générique un instrument de son existence physique. Bref, du fait de l’aliénation, la conscience que l’homme a de son espèce se modifie au point que sa vie générique devient pour lui un instrument » (p.64).
« Rendu étranger au produit de son travail, à son activité vitale, à son être générique, l’homme devient étranger à l’homme. Lorsqu’il se trouve face à lui-même, c’est l’autre qui est présent devant lui. Ce qui est vrai du rapport de l’homme à son travail, au produit de son travail et à lui-même, est vrai de son rapport à autrui, ainsi qu’au travail et à l’objet du travail d’autrui » (p.64-65). En un mot, « les hommes sont rendus étrangers les uns aux autres » (p.65).
Comment le concept de travail aliéné se manifeste-t-il ? Si le travail est aliéné et l’homme dépossédé c’est qu’un autre s’est approprié ce travail : « l’être « étranger » à qui appartient le travail et le produit du travail, qui dispose du travail et jouit du produit du travail, ne peut être autre que l’homme lui-même » (p.65), « le rapport de l’homme à lui-même n’est objectif, réel que dans son rapport à autrui. Si donc il se comporte comme à l’égard du produit de son travail, de son travail matérialisé, comme à l’égard d’un objet étranger, hostile, puissant, indépendant de lui, ce rapport est tel qu’un autre homme, étranger, hostile, puissant, indépendant de lui, est le maître de cet objet. Si sa propre activité n’est pas libre, c’est qu’il se rapporte à elle comme à une activité au service, sous la domination, la contrainte et le joug d’un autre ».
À travers le travail aliéné, l’homme produit également le rapport avec ces autres hommes qui le dépossèdent (p.66) : « À travers le travail aliéné, dépossédé, le travailleur produit un rapport entre ledit travail et un homme qui n’y est pour rien et qui lui est étranger. Le rapport du travailleur au travail engendre le rapport du travail au capitaliste (ou à tout autre maître du travail, quelque nom qu’on lui donne) » (p.67).
L’étude du travail aliéné nous ramène à la propriété privée. Celle-ci ainsi que le salaire apparaissent donc comme des conséquences du travail aliéné : « L’analyse de ce concept [la propriété privée] nous montre que, si la propriété privée apparaît comme la raison, la cause du travail aliéné, elle en est bien plutôt la conséquence, de même qu’à l’origine les dieux ne sont pas la cause, mais l’effet des égarements de l’esprit humain (…) Le salaire, qui rétribue le produit, l’objet du travail, le travail lui-même, n’est qu’une conséquence nécessaire de l’aliénation du travail » (p.67).
Du point de vue de la transformation sociale, il n’est donc pas loin d’être inutile de vouloir améliorer les salaires : « Un relèvement autoritaire du salaire (abstraction faite de toutes les autres difficultés, et sans considérer le fait qu’il s’agirait d’une anomalie ne pouvant être appliquée que par la force) ne serait donc rien d’autre qu’une meilleure rémunération d’esclaves ; ce ne serait ni pour le travailleur ni pour le travail une conquête de leur vocation et de leur dignité humaines.
L’égalité du salaire elle-même, telle que Proudhon la réclame, ne fait que généraliser le rapport de l’ouvrier de notre temps à son travail, en en faisant le rapport de tous les hommes au travail. La société est alors conçue comme un capitaliste abstrait.
Le salaire est une conséquence directe du travail aliéné, et le travail aliéné est la cause directe de la propriété privée. Par conséquent, si la cause tombe, l’effet disparaîtra aussi ». L’émancipation des ouvriers sera donc l’émancipation de toute la société (p.68). Selon Rubel, le capitaliste abstrait c’est la société mais ce peut également être l’État (p.1610).
Il reste deux problèmes à étudier, concernant le rapport du non-travailleur au travailleur, et ce qu’implique son appropriation : objet de la partie suivante (p.68-70).
Propriété privée et travail (p.71)
L’économie politique a progressivement saisi le travail humain « en général » comme essence de la propriété privée, mais en confondant les deux, elle vire au cynisme et n’est plus qu’une science du « déchirement » (p.71-75).
Les économistes qui considèrent que c’est la propriété privée qui est l’essence sont des « catholiques » (p.71), tandis que ceux qui reconnaissent le travail comme essence de la propriété en réalité nient l’humain (p.72). L’économie politique dépasse le cynisme et ne se fonde plus que sur « le principe de ce déchirement » de l’humain (p.73). La physiocratie a néanmoins certains mérites (p.73-74) car elle reconnait la propriété foncière comme première forme propriété privée, mais finalement elle est dépassée par la propriété industrielle : « le capital industriel est la forme objective, accomplie de la propriété privée » (p.75).
Communisme et propriété (p.76)
Le rapport entre travail et capital s’incarne dans le mouvement de la propriété privée : il y a « contradiction » qui avance vers sa solution : « l’abolition de l’aliénation de soi suit la même voie que l’aliénation de soi » (p.76).
Dans un premier temps la propriété privée est dépassée par un « communisme vulgaire » (p.78) dans lequel la communauté agit comme « capitaliste universel » qui prostitue tous les individus(exemple l’URSS ?). Le rapport de l’homme à la femme exprime pourtant l’humanité du rapport de l’homme à lui-même : « il permet de juger de tout le degré du développement humain » (p.79). D’autres formes légèrement plus avancées restent « imparfaites » car elles sont encore un communisme « politique, démocratique ou despotique » (le communisme français selon Rubel) (p.79).
Tandis que le communisme comme dépassement positif de la propriété privée implique la suppression de toutes les aliénations et le retour de l’humain à sa propre essence naturelle : « c’est le retour total de l’homme à soi en tant qu’homme social, c’est-à-dire humain, retour conscient, accompli dans toute la richesse du développement antérieur. Ce communisme est un naturalisme achevé, et comme tel un humanisme » (p.79).
Le développement du communisme est fondé sur le mouvement de la propriété privée :
« Tout le processus révolutionnaire trouve son fondement tant empirique que théorique dans le mouvement de la propriété privée, qui est le mouvement de l’économie. Cette propriété privée matérielle, immédiatement sensible, est l’expression concrète de la vie humaine aliénée. Son mouvement – la production et la consommation – révèle concrètement le mouvement de toute la production passée, c’est-à-dire la réalisation ou la réalité de l’homme. La religion, la famille, l’État, le droit, la morale, la science, l’art, etc., ne sont que des modes particuliers de la production et tombent sous sa loi universelle. Le dépassement positif de la propriété privée, qui est l’appropriation de la vie humaine, signifie le dépassement positif de toute aliénation, par conséquent l’abandon par l’homme de la religion, de la famille, de l’État, etc., et son retour à son existence humaine, c’est-à-dire sociale. L’aliénation religieuse comme telle n’a lieu que dans le domaine de la conscience, dans le for intérieur de l’homme, quand l’aliénation économique est celle de l’existence concrète. Surmonter l’aliénation économique implique le dépassement dans les deux sphères » (p.80).
En somme, il faut combattre l’aliénation économique plutôt que religieuse : « la philanthropie de l’athéisme n’est donc, d’abord, qu’une philanthropie philosophique abstraite, alors que celle du communisme est réelle et directement tendue vers l’action » (p.80).
Pour récapituler, la nature humaine est sociale, il ne faut pas opposer à l’individu la société:
« de même que la société crée l’homme en tant qu’homme, de même elle est créée par lui. L’activité et la jouissance, tant par leur contenu que par leur mode d’existence, sont sociales (…) », « ma propre existence est activité sociale », « ma conscience générale n’est que la forme théorique de tout ce dont la communauté réelle, l’être social, est la forme vivante ; mais de nos jours la conscience générale réduit la vie réelle à une abstraction qui, comme telle, s’oppose avec hostilité à l’existence » (p. 81). « Il faut avant tout éviter de fixer la « société » elle-même comme une abstraction face à l’individu. L’individu est l’être social », la vie individuelle est « une manifestation et une affirmation de la vie sociale », l’individu n’est rien que « l’existence subjective de la société pensée et sentie pour soi » (p.82).
La propriété privée nous a aliéné jusqu’à nos sens : sortir de l’aliénation implique de les recouvrer car on ne perçoit du monde que ce que nos sens maîtrisent (exemple : on n’apprécie comme musique que ce que notre oreille est formée à apprécier comme telle, p.84). Le « sensible » à travers lequel l’homme entre en rapport avec le monde doit donc être « la base de toute science » (p.82-88).
La propriété privée fait que nous ne percevons qu’un objet est nôtre que s’il est « utilisé », que s’il est bien un de nos « moyens de vivre », et la vie elle-même comme vie de la propriété privée (travail et capital). Nos « sens physiques et intellectuels » ont été aliénés au profit du « sens de l’avoir ». L’abolition de la propriété engendre le retour du caractère humain-social des choses : l’ « objet devient un objet social, humain, venant de l’homme et aboutissant à l’homme » (p.83). On ne perçoit que ce que nos sens maîtrisent, et cette perception s’affine avec la libération de l’homme : « c’est seulement grâce à l’épanouissement de la richesse de l’être humain que se forme et se développe la richesse de la sensibilité subjective de l’homme » (p.84-85). Une personne affamée ne percevra de la nourriture que « l’existence abstraite » et non humaine : « le souci et le besoin rendent l’homme insensible au plus beau des spectacles »… (p.85).
Les antithèses ne se résolvent que par la pratique : « On voit que les antithèses théoriques elles-mêmes ne peuvent être résolues que d’une manière pratique, par la seule énergie pratique des hommes, si bien que leur solution n’est aucunement la tâche de la seule connaissance, mais une tâche réelle de l’existence, tâche que la philosophie n’a pu résoudre précisément parce qu’elle l’a conçue comme une tâche qui n’est que théorique » (p.85).
L’industrie fait partie de la nature humaine et en dit de son développement : « L’histoire de l’industrie parvenue à l’existence objective constitue le livre ouvert des forces essentielles de l’homme, sa psychologie concrète (…) Une psychologie qui refuse de puiser dans ce livre, partie la plus concrète, la plus immédiate, la plus accessible de l’histoire, ne peut devenir une science réelle et vraiment profonde ». « C’est par le moyen de l’industrie que les sciences de la nature sont intervenues pratiquement dans la vie humaine ; en transformant l’industrie elles ont préparé l’émancipation de l’homme, bien qu’elles aient dû d’abord en parachever la déchéance » (p.86). « La nature, telle qu’elle se fait dans l’histoire – acte de genèse de la société humaine – est la nature réelle de l’homme ; bien que sous une forme aliénée, elle devient, grâce à l’industrie la vraie nature anthropologique » (p.87).
Il faut une science pour l’homme et une science pour la nature, qui finiront par se rejoindre si elles partent du « sensible » (référence à Feuerbach) : « Dire qu’il y a une base pour la vie et une autre pour la science est un mensonge pur et simple ».
« Réalité sociale de la pensée, le langage est de nature sensible » (p.87).
« La pauvreté est le lien passif qui fait que l’homme éprouve le besoin de la plus grande des richesses : autrui » (p.88).
On a du mal à considérer l’homme et la nature comme « indépendants » (se créant eux-mêmes), pourtant poser la question de leur genèse c’est nier leur existence. Pour le socialisme l’histoire est l’engendrement de l’humain par son propre travail : il n’y a plus besoin d’athéisme (p.88-90). « Le communisme est la forme nécessaire et le principe agissant du proche avenir, sans être en tant que tel le but du développement humain : la forme achevée de la société humaine » (p.90).
Besoin, luxe et misère : communisme et division du travail, p.91
La propriété privée engendre un « pillage réciproque » et un rapport instrumental et inhumain à autrui. Cette aliénation engendre la perte des besoins et sens humains : l’homme se contente du « cloaque » de la civilisation (p.91-92).
« Le besoin d’argent est le vrai et l’unique besoin produit par l’économie politique », « le sujet devient l’esclave inventif et toujours calculateur d’appétits inhumains, raffinés, imaginaires et contre nature » à force d’être dupé et manipulé par un autrui perçu comme hostile (p.91) : tout comme l’eunuque flatte les bas instincts du souverain, « l’eunuque industriel » se pliera aux « caprices les plus abjects » et autres « appétits morbides » afin de gagner un peu d’argent : « (…) je te plume en te procurant un plaisir » (p.92).
Cette« aliénation » engendre la régression des besoins : « Même le besoin de grand air cesse d’être un besoin pour l’ouvrier ; l’homme retourne à sa caverne qu’empeste désormais le souffle nauséabond et méphitique de la civilisation, et qu’il n’habite plus que d’une façon précaire (…) Cette maison mortuaire, il faut qu’il la paie (…) La crasse, cet encanaillement, ce pourrissement de l’homme, le cloaque (au sens littéral) de la civilisation, le relâchement complet et contre nature, la nature putride deviennent l’atmosphère où il vit. Tous ses sens sont morts » (p.92). « Dans cet état, les besoins de l’homme ne sont pas humains, et même les besoins animaux restent insatisfaits » (p.93).
L’économiste construit en théorie et le capitaliste en pratique un ouvrier sans besoin, indigent, avec une activité abstraite (p.93-94). Ce que tu ne peux plus, l’argent le peut pour toi : « (…) Tout ce que l’économiste t’ôte de vie et d’humanité, il le remplace en argent et en richesse ; tout ce que tu ne peux pas faire, ton argent le peut : (…) il est la vraie puissance ». Par conséquent, « L’ouvrier doit avoir juste assez pour vouloir vivre et ne doit vouloir que pour posséder » (p.94). La morale de l’économie politique est ascétique et utilitariste : elle a ses propres règles morales, ce qui contribue à l’aliénation (p.93-96) : « il est de l’essence de l’aliénation que chaque sphère m’applique une norme différente et contraire : la morale m’en propose une et l’économie une autre, car chacune est une forme de l’aliénation humaine ; chacune s’attache à une sphère particulière de l’activité aliénée ; toutes sont dans un rapport d’aliénation réciproque » (p.95-96). L’industrie spécule sur le raffinement et la grossièreté des besoins (p.96-97).
Le mouvement communiste est la négation de la propriété privée (elle-même négation de l’essence humaine), donc affirmation à partir de la propriété privée. Le mouvement communiste implique une action réelle, ainsi qu’un « très long et très dur processus ». L’abolition de l’aliénation dépend cependant des formes dominantes de l’aliénation dans chaque contexte : « Il est clair que l’abolition de l’aliénation part toujours de la forme de l’aliénation qui est prédominante », cependant « L’aliénation réelle de la vie humaine demeure d’autant plus grande que l’on en est plus conscient » (p.98).
Rapports de la « richesse inactive, dissipatrice » avec la « richesse industrielle » (p.100) : la jouissance se soumet peu à peu au capital, « la baisse du taux d’intérêt est, en effet, une conséquence et un résultat nécessaire du mouvement industriel », « la jouissance – contrairement à ce qui avait lieu autrefois – est soumise au capital, l’individu jouisseur est soumis à l’individu qui accumule du capital » (p.101).
L’économie politique voit l’homme comme individu abstrait : « La société, telle qu’elle apparait à l’économiste, est la société bourgeoise où chaque individu constitue un ensemble de besoins. Comme tel il n’existe pour l’autre, et l’autre n’existe pour lui, que dans la mesure où chacun devient un moyen pour autrui. L’économiste (tout comme par ailleurs la politique quant aux droits de l’homme) réduit tout à l’homme, c’est-à-dire à l’individu, qu’il dépouille de toute détermination pour le considérer soit comme capitaliste, soit comme ouvrier » (p.102). Il restitue la conception de la division du travail chez Smith, Say, Mill, Skarbek… (p.102-105).
L’homme-marchandise : propriété foncière, capital et travail (p.106)
L’ouvrier n’existe plus que comme marchandise, en fonction du capital qui le fait exister. Si le capital cesse d’exister pour l’ouvrier, celui-ci cesse d’exister et « n’a plus qu’à disparaître » (p.106). L’économie politique ne le reconnait que comme tel : « Le coquin, l’escroc, le mendiant, le travailleur qui chôme, qui meurt de faim, qui est misérable et criminel – autant de figures qui n’existent pas pour l’économie politique, mais aux seuls yeux du médecin, du juge, du fossoyeur, du prévôt des mendiants, etc. » (p.106-107)« Elle ne voit dans les besoins de l’ouvrier que ce qui est nécessaire à son entretien tant qu’il travaille, et ce à seule fin que la race des ouvriers ne vienne pas à s’éteindre. Le salaire a donc tout à fait la même signification que l’entretien, le maintien en bon état de tout autre instrument productif, que la consommation du capital en général pour pouvoir se produire avec profit ». Le salaire est un « frais nécessaire » comme un autre (p.107).
« La production ne produit pas seulement l’homme comme une marchandise, la marchandise humaine, l’homme destiné au rôle de marchandise, elle le produit, conformément à cette destination, comme un être déshumanisé aussi bien intellectuellement que physiquement » (p.107).
Il y a opposition entre capitalistes et propriétaires fonciers à mesure que « l’agriculture devient une industrie » mais c’est les capitalistes qui sont appelés à vaincre (p.109-112).
Il décrit le mouvement qui unit la propriété privée, le travail et le capital : 1) unité capital-travail, 2) opposition et négation l’un de l’autre, 3) opposition de chacun à soi-même, le capital est du travail accumulé, le travail est une marchandise (p.112-113).
L’argent (p.114)
Il part cette fois d’extraits de Goethe et Shakespeare pour montrer en quoi l’argent est « la puissance aliénée de l’humanité », car il change tout en son contraire et rend irréel ce qui n’a pas d’argent pour exister. L’argent lie et délie tous les liens (p.116). Il corrompt et rend les choses fausses, « il est le monde à l’envers » (p.117-118). Selon Rubel, c’est sur cette touche « romantique » que se conclut la partie critique de l’économie politique qui ne sera reprise que 13 ans plus tard (p.1619-1620).
Critique de la dialectique hégélienne et de la philosophie allemande (p.119)
- L’héritage de Hegel : mérites de Feuerbach (p.119)
Toute la critique jeune-hégélienne reste empêtrée dans la dialectique hégélienne et théologique, à l’exception de Feuerbach, qui a plusieurs mérites, notamment d’avoir fondé le « vrai matérialisme » et la « vraie science », basés sur le « rapport social de l’homme à l’homme » (p.119-122).
- Système de Hegel (p.122)
- Phénoménologie (p.122)
Malgré la « double erreur » qui consiste à poser les choses à partir d’idées abstraites, la Phénoménologie contient « les éléments nécessaires à la critique » et Marx montre là ce qu’il doit à Hegel et ce qui l’en sépare à ce stade (p.122-125) : « le philosophe – type abstrait de l’homme aliéné – se pose en étalon du monde aliéné » (p.124).
- Aliénation et objectification du travail (p.125)
Le mérite de Hegel est de donner toute son importante au processus d’ « autocréation » humaine, notamment comme l’économie politique, à travers le travail ; cependant il en reste à identifier l’humain avant tout comme « conscience de soi », donc comme abstraction (p.125-129).
- Humanisme et naturalisme (p.129)
Le « naturalisme accompli ou humanisme » dépasse « l’idéalisme » de Hegel (ce que Rubel appelle « spiritualisme de la conscience de soi », p.1622) : l’humain est « être naturel », sensible, qui a besoin d’objets extérieurs pour vivre, et devient donc par interaction également objet pour eux : il possède sa nature « hors de lui ». L’humain est donc un « être objectif sensible » et « passionné » mais en tant qu’humain il est fait par « l’histoire » (p.129-131).
« L’homme est immédiatement être naturel. En tant qu’être naturel vivant, il est d’une part doté de forces naturelles, d’énergies vitales, c’est un être naturel actif ; ces forces existent en lui, sous forme de dispositions, d’aptitudes, d’impulsions. D’autre part, en tant qu’être physique, corporel, sensible, il est aussi un être passif, dépendant et limité, tout comme l’animal et la plante. Cela signifie que les objets de ses impulsions existent hors de lui et indépendamment de lui ; mais ils correspondent à ses besoins et sont essentiels, indispensables à l’exercice et au développement de ses énergies. Dire que l’homme est un être matériel, corporel, énergique, vivant, réel et sensible, c’est dire que sa nature, que la manifestation de sa vie réclament certains objets réels et sensibles, ou que c’est seulement en eux et par eux que sa vie peut s’extérioriser. Être objet naturel et sensible, ou avoir en face de soi objets, nature, sens, ou bien être soi-même objet, nature, sens pour un tiers, tout cela est identique. La faim est un besoin naturel ; elle exige donc, pour se satisfaire et s’apaiser, quelque chose de naturel, un objet qui lui est extérieure. La faim est, dans mon organisme, le besoin réel d’un objet extérieur et indispensable à son intégration et à la manifestation de son être. Le soleil est, pour la plante, l’objet qui lui est indispensable et qui affirme sa vitalité, de même que la plante est objet du soleil, dont elle exprime la force créatrice de vie, l’énergie de son essence réelle.
Un être qui ne possède pas sa nature hors de lui n’est pas un être naturel, ne participe pas de l’essence de la nature. Un être qui n’est pas lui-même objet pour autrui ne possède aucun être qui soit son objet, c’est-à-dire ne peut pas avoir de comportement objectif, son existence est immatérielle.
Un être immatériel est un monstre » (p.130).
« Sitôt qu’il y a un objet pour moi, je suis moi-même objet pour lui. Mais un être non objectif est un être irréel, non sensible, seulement pensé, c’est-à-dire imaginé : un être d’abstraction. Être sensible, ou réel, cela signifie être objet des sens, objet sensible, et donc avoir hors de soi des objets qui se rapportent à la sensibilité. Être sensible, c’est pâtir. En tant qu’être objectif sensible, l’homme est un être qui pâtit, et, comme il ressent ses souffrances, un être passionné. La passion, c’est l’énergie naturelle de l’homme toute tendue vers son objet (…) » (p.131).
- Aspects concrets de la dialectique (p.131)
L’idéalisme hégélien aboutit à un solipsisme en considérant que l’humain est avant tout « conscience de soi » et que la suppression de l’aliénation consiste en la suppression de la réalité. Cette conscience de soi en effet ne s’incarne que dans les savoirs qu’elle détient ; ce qu’elle ne sait pas n’existe pas. Cette dialectique est une « affirmation de l’être fictif » et non sa négation (p.131-135).
- Aspects positifs de la dialectique (p.136)
Athéisme et communisme ne sont que des « médiations » qui devront être dépassées pour permettre le retour de l’homme à lui-même (p.136). Hegel malgré son idéalisme a réalisé quelque chose de « positif » en associant l’abstraction à la nature humaine. Mais, demeurant dans cette abstraction, il n’a pu faire sa place à la nature qu’en tombant dans la « contemplation » : le penseur abstrait a une vision abstraite de la nature, ce qui revient à la nier (p.138-141).
