Histoire de la philosophie matérialiste
06 Juil 2014
Imprimer
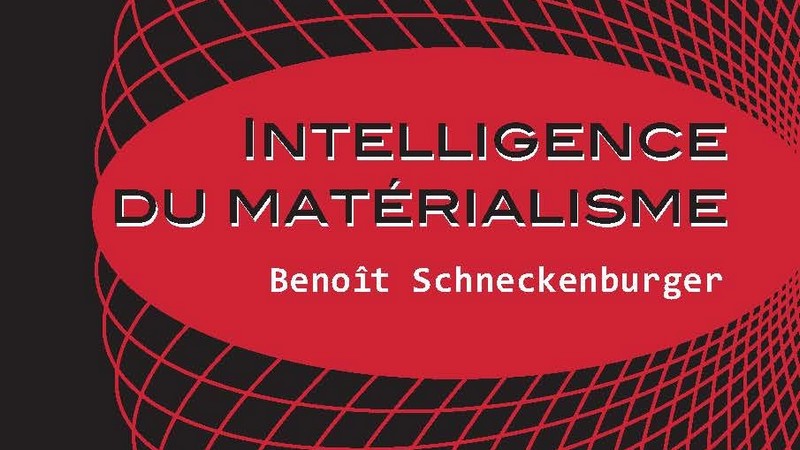
Note de lecture de :
Benoît Schneckenburger, Intelligence du matérialisme, Les Éditions de l’Épervier, coll. « Pour aller plus loin », 2013, 128 p., Préface de Jean-Luc Mélenchon
Disponible à l’adresse suivante : Lectures
Le livre se présente comme « une tentative de synthèse des réponses déjà apportées par l’approche matérialiste et le rejet de fausses questions portées par les approches idéalistes et spiritualistes » (p. 12). Il s’agit avant tout d’un ouvrage de vulgarisation philosophique qui, réalisant une présentation du courant matérialiste dans un sens large, défriche une grande variété de thématiques, suggère des pistes de réflexion, présente synthétiquement quelques références théoriques, et inscrit en partie sa démarche dans une perspective historique. Le texte de Schneckenburger est également militant, en ce qu’il est écrit par un militant (l’auteur, philosophe de formation, est, entre autres, secrétaire national du Parti de gauche) (et préfacé par J.-L. Mélenchon), qu’il exprime ouvertement un parti pris pour le matérialisme, et qu’il n’hésite pas à tirer à vue sur diverses formes d’« idéalisme ».
Quels sont exactement les termes du débat ? Le courant idéaliste consiste globalement, aux yeux de l’auteur, en des doctrines diverses, dont l’archétype est la religion, mais qui concernent également le platonisme, par exemple, et qui ont en commun la croyance en « une entité invisible et immatérielle plus vraie et plus réelle que le monde » (p. 14). À l’inverse, pour comprendre le monde, les matérialistes s’appuient sur les principes qui lui sont immanents, tels que « les lois de l’univers et des corps vivants ».
Une fois posées ces définitions, et pour explorer l’opposition entre les deux courants, l’auteur commence par réinscrire le débat dans la perspective historique, qui est avant tout celle du « procès en sorcellerie » fait aux matérialistes, notamment par les idéalistes, incarnés d’abord par les autorités religieuses. Ainsi, dans l’Antiquité, le « mythe de Socrate » (p. 18) forgé par Platon a éclipsé nombre d’autres philosophes, les présocratiques, dont plusieurs étaient matérialistes ; Épicure a vu sa pensée déformée et a été accusé de « mœurs impures » ; Guillaume d’Ockham, Spinoza, Galilée, puis les Lumières, c’est-à dire la plupart de ceux qui étaient « suspectés de matérialisme », ont essuyé les foudres des autorités religieuses : au moins jusqu’à Diderot et Montesquieu, « la haine anti-matérialiste semblait ne pas avoir de bornes » (p. 22).
Cette haine s’explique d’une part car les matérialistes remettaient régulièrement en question le pouvoir de l’Église et, d’autre part, car l’emprise de cette dernière sur la société avait ancré une « haine du corps » et un mépris des travaux manuels, qui peuvent encore se lire notamment dans les débats sur l’œuvre d’art ou la supposée dématérialisation du monde moderne avec l’avènement des nouvelles technologies.
En outre, « de Platon à Hegel, sans oublier Descartes ou Kant, le matérialisme a fait l’objet de diverses tentatives de réfutations » (p. 35) par des philosophes illustres, ce qui a contribué à discréditer ce courant, dont Schneckenburger s’efforce de restituer divers arguments, estimant que « ce n’est pas la matière qui est pauvre en soi, mais l’image que s’en font les idéalistes » (p. 36).
« La science » elle-même se place, aux yeux de Schneckenburger, du côté de la « méthode matérialiste : ne pas recourir à autre chose qu’à la matière pour expliquer le monde » (p. 42). Pourtant, celle-ci est menacée par « l’obscurantisme idéaliste » qui s’immisce sous diverses formes et contraint à réfléchir à une défense de la science. Si les progrès scientifiques évoqués par l’auteur semblent faire reculer l’idéalisme sur divers fronts, la question de la compréhension de l’homme reste, en revanche, une exception, que le philosophe décide donc de discuter à travers le thème de l’« humanisme matérialiste ».
L’idéalisme pose en effet l’homme comme un être d’exception, supérieur, un « sujet doué d’une conscience libre et autonome » (p. 55), et propose donc des modes de compréhension qui sont insuffisants, pour Schneckenburger, si l’on considère les déterminismes biologiques et sociaux qui pèsent sur l’individu. Un « humanisme matérialiste » supposerait, à l’inverse, tout d’abord, de réinscrire l’homme dans son environnement naturel, comme le suggère l’auteur en étudiant quelques propositions relatives à l’approche matérialiste de l’écologie, qui incite à organiser rationnellement les rapports sociaux, techniques et culturels avec la nature menacée par l’homme.
En outre, contre les « idéalistes subjectivistes », l’auteur souligne la « continuité entre la matière et l’esprit », fortement appuyée par les dernières avancées dans les neurosciences et la « cartographie mentale », qui posent, contrairement à la phrénologie, que le cerveau est caractérisé par une grande « plasticité », une « capacité à évoluer ». À ces suggestions s’ajoute une étude de la « fonction symbolique » de l’homme par Schneckenburger, fonction qui, elle aussi, à la base, « relève de la physiologie (l’appareil vocal ou toute partie du corps qui symbolise et mime le réel), du fonctionnement intérieur du cerveau » (p. 69), et du maniement de signes linguistiques simples permettant l’élaboration d’abstractions.
Pour compléter sa description de « l’humanisme matérialiste », et contre ceux qui considèreraient que le matérialisme est une négation de la liberté humaine, l’auteur subvertit l’argument en répondant que c’est, précisément, en explorant les contraintes et les déterminations qui pèsent sur l’homme que celui-ci peut espérer s’en émanciper, et songer à « produire une morale et une politique », thème qui constitue la troisième et dernière grande partie de l’ouvrage.
Au moment de passer à l’action – politique –, le matérialisme doit refuser la morale dans sa forme idéaliste, fondée sur des concepts transcendants, des valeurs présentées comme « vraies en soi et pour soi ». Les critères moraux étant contingents par rapport à une situation socio-historique, l’auteur plaide donc plutôt pour une « éthique de l’action » (p. 78), qui permette de réaliser un « mieux » concret plutôt qu’un « Bien » absolu et inatteignable. Avec un certain pragmatisme, Schneckenburger propose d’approfondir cette « éthique de l’action » par une « éthique du plaisir » (p. 83) en s’inspirant des préceptes d’Épicure dégagés de tous les contre-sens infligés par les réinterprétations successives. Aux yeux de Schneckenburger, Épicure considère que l’individu est guidé par la quête du plaisir (pas nécessairement physique) ou, à défaut, par la fuite de la peine. Ainsi, l’individu réalise un « calcul rationnel » entre les plaisirs et les peines escomptés à chaque action, et en fonction d’une hiérarchie (nécessaires, non nécessaires, naturels, non naturels), ce qui constitue cette doctrine en une « éthique du travail sur soi » et de l’équilibre interne.
Jusqu’ici, cependant, l’éthique matérialiste reste profondément individualiste et n’aide pas celui qui voudrait agir dans la vie de la cité. Après avoir mis en évidence les insuffisances de ce matérialisme individualiste, tel qu’il se présente notamment chez La Mettrie, Sade et Michel Onfray, Schneckenburger propose d’appliquer à l’intervention politique un certain nombre d’idées évoquées dans l’ouvrage, à commencer par « l’éthique de l’action ». Il suggère que la politique doit favoriser le bonheur commun — ou intérêt général — et utiliser à cette fin le bonheur lui-même comme moyen. Pour appuyer cette proposition, l’auteur étudie certaines thèses de Babeuf, Helvétius et Karl Marx concernant la « politique de l’égalité », avant d’expliquer longuement que « la matière première de la politique, c’est l’homme » (p. 112) ; ce qui signifie que la politique matérialiste cherche à comprendre ce qui détermine la condition des sujets, et se sert des facteurs de changement comme de leviers pour amener le corps social vers le bien commun.
Au final, l’ouvrage est salutaire par la diversité des thèmes qu’il défriche et la rigueur avec laquelle est appliquée la méthode matérialiste dans toute sa créativité. Le lecteur pourra, sans doute, apprécier que le matérialisme soit présenté ici sous une forme extensive — au niveau historique et au niveau des thèmes abordés — mais également sous une forme critique et non homogénéisante, Schneckenburger n’hésitant pas à distinguer les forces et faiblesses de chaque auteur mobilisé, et les distinctions, voire divergences, qui existent au sein du courant matérialiste. Il faut enfin insister sur un dernier élément qui peut avoir son poids, mais sur lequel l’auteur ne s’étend pas : le matérialisme en général est bien distinct du matérialisme historique et du matérialisme dialectique, raison pour laquelle quelques pages seulement sont consacrées à K. Marx et au marxisme, laissant le champ libre pour une diversité de thèses et d’auteurs qui, avant le penseur allemand, avaient commencé à creuser les sillons de l’émancipation collective.
