Le travail social indépendant : libération ou libéralisation ?
Sociologie et Anthropologie Travail social
20 Août 2020
Imprimer
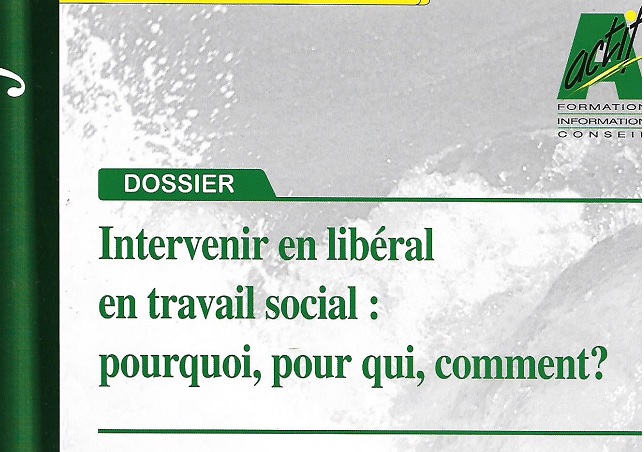
Jonathan Louli, Janv.-Fév. 2020, « Le travail social indépendant : libération ou libéralisation ? », in Les Cahiers de l’Actif, n°524-525, pp. 69-94
Site de la revue Les Cahiers de l’Actif
Résumé :
Le travail social est un champ d’activités dont les fondements sont en eux-mêmes, historiquement, indépendants de l’appareil d’État et des logiques capitalistes, et qui le situent plutôt dans les efforts de la société civile pour œuvrer au progrès social. Pour diverses raisons, cependant, il a fallu financer, donc réglementer, ces différentes activités, qui, de ce fait, ont été petit à petit encadrées par l’appareil d’État. C’est ainsi qu’a progressivement été structuré le champ du travail social. Cette institutionnalisation a pu mettre en difficulté nombre de ces démarches, anciennement militantes, et a été vivement critiquée à partir des années 1960.
Le champ du travail social a commencé à se reconfigurer dans le dernier quart du XXème siècle, alors qu’il commençait à subir la montée du néolibéralisme dans l’appareil d’État. Au nom de l’indépendance du travail social, de nombreux professionnels en ont alors appelé à un renforcement de l’ « État-Providence » pour protéger leurs secteurs de la loi marchande du plus fort. D’autres, en revanche, dénoncent le fait que « l’art de la surveillance apparaît comme la voie la plus « moderne » du pouvoir »[1], les actes et les populations étant de plus en plus soumis au contrôle du panoptique gestionnaire sur lequel s’échafaude l’appareil d’État contemporain. D‘autres professionnels encore tentent de déserter tout rapport de subordination salariale en expérimentant différentes formes de travail social indépendant. Mais ce que révèlent ces différentes positions, c’est que tous et toutes ont une exigence principale : travailler avec l’autonomie adéquate pour soutenir les personnes accompagnées dans le développement de la leur. Tous et toutes cherchent un modèle plus émancipateur d’activité, qui puisse pallier aux défauts des différents encadrements du travail social.
Introduction
Dans sa forme actuelle, le travail social indépendant suscite de nombreuses polémiques. Ses opposants déplorent les risques de libéralisation des secteurs sociaux, c’est-à-dire un développement renforcé des logiques marchandes, voire d’ubérisation. Ceux qui sont favorables au travail social indépendant disent qu’il permet une plus grande autonomie et davantage de souplesse face à la demande sociale, et peut donc représenter au final une libération du travail social. Le débat semble actuellement se résumer à cette question : entre la bureaucratie d’État et la fluidité du marché, quel est le plus adéquat pour le travail social ?
Le présent article se veut une contribution théorique à cette polémique, tirée de mes recherches sociologiques, ainsi que de mes expériences de travailleur social et de militant. J’aimerais montrer que de nombreux points de vue sceptiques et de nombreux points de vue favorables au travail social indépendant ne devraient pas avoir de mal à se rejoindre, si l’on clarifie les principaux termes du débat, en vue d’en ouvrir les perspectives.
Pour ce faire, il faut d’abord réaliser une généalogie du travail social indépendant, c’est-à-dire une esquisse d’histoire sociale et politique visant à mettre en lumière les conditions dans lesquelles il émerge. Notre séquence historique actuelle prend en effet ses racines dans les processus de professionnalisation et d’institutionnalisation des interventions sociales.
L’actualité de la séquence que nous traversons se trouve dans les restructurations profondes subies ces dernières décennies par ces secteurs et pratiques professionnelles, de plus en plus poussés sur la voie de l’industrialisation[2]. Cette proposition théorique doit nous amener à constater qu’une grande porosité s’est développée, ces dernières années, entre les logiques bureaucratiques et marchandes, renforçant les dynamiques paradoxales qui traversent le travail social.
C’est uniquement en ayant à l’esprit ces différentes contingences actuelles que l’on peut analyser le processus de « destruction créatrice » en cours, comme dirait l’économiste J. Schumpeter[3], au sein de nos secteurs et pratiques professionnels. Le travail social indépendant dans sa forme actuelle semble en effet contribuer tout autant à une marchandisation destructrice des secteurs, qu’à une libération créative des pratiques.
Pour ne pas en rester à cette contradiction objective, il faut interroger plus concrètement les intérêts et conditions des premières personnes concernées, à savoir les acteurs et actrices de terrain, professionnels comme personnes accompagnées. C’est au prix de cette confrontation des différentes thèses et niveaux d’analyse que l’on peut trouver comment sortir de façon constructive de l’opposition entre – pour le dire vite – partisans théoriques de l’État et partisans théoriques du marché.
Si l’on se place du point de vue des gens, des acteurs et actrices de terrain, on comprendra aisément que le mieux c’est de les laisser déterminer eux-mêmes ce qui est le mieux pour eux-mêmes. Le travail social indépendant pose en effet la question du besoin d’autonomie des professionnels et des personnes accompagnées, c’est-à-dire du besoin de démocratie dans le travail social.
Il serait regrettable d’écarter le thème du travail social indépendant au seul titre que, sous certaines formes, il alimente la marchandisation, alors qu’à travers les questionnements qu’il porte, il pourrait également ouvrir des possibles peu aperçus jusque-là. C’est pourquoi la piste de réflexion qui sera proposée, en conclusion, sera celle d’un autre modèle de travail social indépendant : le travail social coopératif et la « dimension émancipatoire »[4] qu’il comporte pour chacun et chacune individuellement, et pour toutes et tous ensemble.
I – Généalogie du travail social indépendant
Comme l’a montré le sociologue Robert Castel, l’histoire du travail social est très tôt influencée par ses liens avec l’appareil d’État. C’est surtout après la Seconde guerre mondiale qu’on observe une forte « solidarité » entre le développement de « l’État providence » et de ce qu’on appellera le travail social. Tout un champ d’activités s’institutionnalise à cette époque, avec pour mission de s’occuper de populations restées « en marge d’une société en plein développement économique et social »[5]. Ces différentes activités sont très vite placées dans une situation paradoxale à travers le « mandat » et les injonctions qui leur sont adressés par l’appareil d’État[6].
L’équilibre est difficile à construire entre, d’un côté, les aspirations des acteurs et actrices provenant de la société civile, et, de l’autre, l’encadrement croissant par l’appareil d’État, mais cette structuration sera soutenue par l’esprit de reconstruction et de croissance économique qui fleurit à la fin de la Seconde guerre mondiale. À partir des années 1970 cependant, l’appareil d’État se convertit petit à petit à la libéralisation économique, ce qui restructure totalement ses rapports avec les secteurs encadrés du travail social : Robert Castel parle d’une « décollectivisation » ou d’une « réindividualisation » des régulations socio-économiques et institutionnelles[7]. Cette libéralisation est à l’origine de profondes mutations des secteurs sociaux et des pratiques professionnelles, qui posent question aux acteurs et actrices de terrain.
Il semble bien que c’est en observant les évolutions des secteurs et pratiques dans leurs rapports tumultueux avec l’appareil d’État qu’on peut saisir comment, récemment, certains ont pu estimer plus pertinent de sortir des régulations institutionnelles classiques une part plus ou moins importante de leur activité, et ouvrir la voie au travail social indépendant.
1.1 Les racines de la séquence actuelle
C’est au XIXème siècle qu’est posée la « question sociale » dans sa forme moderne. Les manufactures des débuts du capitalisme industriel, implantées dans certaines villes, drainent une importante main-d’œuvre rurale, qui se retrouve parquée dans des lieux de vie collectifs indécents pour effectuer un travail difficile et dangereux. Une condition ouvrière misérable se développe alors, avec son lot de souffrances et révoltes. Différents types d’acteurs se mobilisent pour tenter de remédier à ce sort, contribuant ainsi à l’émergence de ce qu’à partir de la fin du XIXème siècle on appelle économie sociale et solidaire[8]. Parmi ces différentes initiatives, certaines veulent apporter un secours charitable, humanitaire, aux démunis : « face au paupérisme de la population (mauvaises conditions de vie et de travail, disette, hygiène rudimentaire, etc.) et aux révoltes spontanées qui y répondent, seules les organisations privées, notamment religieuses, apportent un maigre secours. »[9]
Dès le XIXème siècle, la plupart des démarches qui, au siècle suivant, constitueront le champ du travail social, au sens large, sont caractérisées par une démarche militante, bénévole, et la plupart sont plutôt inscrites dans cette logique d’économie sociale et solidaire classique. Même marquées par la philanthropie bourgeoise ou la charité chrétienne, ces démarches cherchent, non sans une certaine ambiguïté parfois, à contribuer activement à une certaine forme de « progrès social »[10].
Bien avant que la loi ne pose certains jalons, différentes composantes du mouvement ouvrier et de l’économie sociale donnent naissance à des associations, coopératives ou mutuelles, aux fonctions et visées assez hétérogènes. Après la loi de 1901, qui fixe le statut des associations, de nombreuses intervenantes socio-sanitaires (infirmières visiteuses, intendantes d’usine, puis, peu de temps après, assistantes de service social…) se structureront elles-mêmes en associations. Le sociologue Henri Pascal montre que les secteurs du social commencent à s’institutionnaliser dans le premier quart du XXème siècle, alors que de nombreuses écoles, associations d’action sociale et institutions publiques se développent. Le bénévolat commence à reculer, le militantisme à se transformer, et, dès les années 1930, « s’il y a encore des bénévoles dans les associations, les salariées composent la grande majorité des travailleuses sociales »[11]. À partir de cette époque, l’appareil d’État légifère pour garantir les conditions nécessaires au bon déroulement de ces interventions d’assistance aux démunis.
Ainsi commence à se constituer la sphère du Social au sens large, rassemblant différents dispositifs qui ont émergé avant la Seconde guerre mondiale : droit du travail, protection sociale, action sociale, travail social… Comme l’explique le sociologue Michel Autès, le social se construit, dans un grand inconfort, à l’articulation « entre l’économie de marché et le gouvernement démocratique »[12].
Avec la période des « Trente glorieuses » qui suit la Seconde guerre mondiale, l’appareil de « l’État providence » étend son emprise sur cette multitude d’initiatives privées, en réglementant les formations, les types de structures et d’activités, les modes de financement, les rapports à la puissance publique… Les secteurs du travail social se retrouvent en tension, du fait de leur généalogie complexe, « entre l’action tutélaire de l’État sur les individus et le travail émancipateur au sein de la société civile »[13]. L’institutionnalisation de ces initiatives privées et militantes pose question à nombre d’acteurs et actrices : « Tout cela conduit à un paysage qui se rigidifie et dont la génération montante, moins marquée par le catholicisme social, plus attirée par une culture libertaire, a de plus en plus de mal de se satisfaire »[14].
Par conséquent, à partir des années 1960-1970, l’encadrement des activités du travail social par l’appareil de « l’État providence » est pointé et dénoncé à travers « une critique d’un ensemble d’interventions dont les fonctions sociales consistent à contrôler et à normaliser les populations »[15]. L’esprit de Mai 68 bouleverse les cultures professionnelles du travail social, au point que Marcel Jaeger parle de « deuxième naissance » de ce champ : « Si Mai 68 a transformé l’ensemble de la société sous l’angle du rapport à l’autorité, cela a été d’autant plus fort chez les travailleurs sociaux, marqués désormais par une approche humaniste et démocratique de la prise en charge des personnes les plus vulnérables. »[16]
Dans sillage de Michel Foucault, de l’Analyse institutionnelle, de Cornélius Castoriadis, de l’anti-psychiatrie et d’autres mouvements de pensée des années 1960-1970, les critiques des institutions du social, de l’éducation, du soin, notamment, se multiplient, principalement dirigées contre leurs tendances à perpétuer différents systèmes de normes, parfois de façon « totalitaire »[17]. En réponse aux pathologies de l’institutionnalisation du travail social par l’appareil d’État, les travailleuses et travailleurs sociaux à partir des années 1960 semblent massivement gagnés par une « humeur anti-institutionnelle »[18], comme disent certains sociologues influencés par Pierre Bourdieu. Les institutions sont de plus en plus assimilées à des espaces non-démocratiques, perpétuant un nouveau contrôle social téléguidé par l’appareil d’État[19].
Cependant, à la même époque, à cette critique « libertaire » des institutions, de leur autoritarisme, et de l’encadrement par l’appareil d’État, s’ajoute une critique libérale qui, elle aussi, pointe les entraves bureaucratiques et réglementaires aux activités – surtout aux activités économiques et entrepreneuriales. Après les chocs pétroliers des années 1970, qui marquent l’entrée dans une période dite de « crise économique », de nombreux décideurs politiques, économiques et médiatiques notamment, trouvent différents intérêts à se convertir au néolibéralisme. Comme l’expliquent les chercheurs Christian Laval et Pierre Dardot, le néolibéralisme est une doctrine économique et politique qui devient dominante à partir des années 1980, et prône des réformes profondes de l’appareil d’État, de ses interventions et des services publics, en vue d’en faire l’outil et le garant du système économique marchand[20].
L’extension de l’idéologie néolibérale, dans le dernier quart du XXème siècle, permet à la critique libérale des institutions de prendre le dessus sur la critique « libertaire » – ce qui semblerait expliquer qu’un certain nombre d’anciens « gauchistes » ou « mai-soixante-huitards » aient pu se reconvertir dans le libéralisme et gagner des positions d’intellectuels reconnus ou d’experts médiatiques : « l’aspiration à l’autonomie, qui travaille la société française depuis les années soixante, se solde par un puissant investissement imaginaire dans la forme entrepreneuriale »[21].
C’est à partir de cette époque que s’enclenchent d’importantes tendances économiques et politiques qui contribuent à modeler la situation actuelle des secteurs du travail social dans le sens d’une industrialisation, du fait de la nouvelle porosité entre gestion bureaucratique et gestion marchande.
1.2 Le travail social en voie d’industrialisation ?
Les différentes branches du social ont commencé à se construire avant l’intervention de l’appareil d’État, et parfois même malgré elle ou contre elle. Répondant aux besoins de financement, de régulations institutionnelles, voire de règlementations, qui ont été exprimés par certains secteurs, l’appareil d’État a été amené à les reconnaître et les soutenir, mais au prix d’un nécessaire encadrement, ces derniers devenant avec le temps des auxiliaires, voire des instruments des politiques publiques. Par conséquent, la forme et l’usage de ces secteurs encadrés dépendent des modalités de leur subordination aux intérêts de l’appareil d’État, selon les différentes séquences historiques. Autrement dit, dans la mesure où ils deviennent des éléments de la politique sociale, financés et réglementés, les différents secteurs sociaux sont modelés par l’appareil d’État en fonction de ses propres normes et impératifs.
Le travail social s’est ainsi beaucoup développé pendant les Trente glorieuses, car les idéologies motrices, durant cette période, étaient plutôt celles de la solidarité et de la croissance heureuse, probablement en raison du discrédit dans lequel était tombée une grande partie du patronat français après sa collaboration active avec le IIIème Reich, et du fait également de la proximité du Parti Communiste Français avec le gouvernement, et de la vigueur des mouvements sociaux jusque dans les années 1980.
À partir du dernier quart du XXème siècle, le paradigme des politiques publiques, leurs principes fondamentaux, ont évolué considérablement. L’usage et la forme faits aux secteurs sociaux par l’appareil d’État fait alors advenir une tendance à l’industrialisation du travail social à plusieurs dimensions[22]. Examiner les aspects de cette colonisation industrielle qui concernent le plus directement notre sujet peut aider à envisager pourquoi certains acteurs et actrices tentent de lui échapper en prenant leur indépendance.
Une instrumentalisation marchande
À partir des années 1980 les politiques dites d’austérité ont imposé une quête de l’efficience budgétaire, c’est-à-dire une quête de rentabilité financière, et l’on ne se souvient plus très bien si l’on est sorti ou pas de ces paradigmes de crises et d’austérité. En effet, actuellement, l’appareil d’État cherche à rentabiliser ses investissements comme s’il était un actionnaire : pas assez de profits électoraux ou financiers ? On supprime ou on privatise !
C’est, par conséquent, un constat partagé, comme dans le cas des services publics : les logiques marchandes s’étendent sans cesse. L’aide aux devoirs scolaires, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les services à la personne, les agences de voyages « adaptées », la petite enfance… De nombreux secteurs du travail social, au sens large, sont déjà en grande partie ouverts aux acteurs marchands et à la concurrence.
Comme le précisent les chercheurs Pierre Dardot et Christian Laval, le néolibéralisme qui devient dominant dans le dernier quart du XXème siècle en Europe, fortement influencé par la doctrine de l’ordolibéralisme, ne prône pas moins d’intervention de l’appareil d’État, mais, bien au contraire, la nécessité de mettre celui-ci au service de la construction et de l’extension des logiques marchandes[23]. C’est pourquoi le processus de marchandisation des secteurs encadrés du social se manifeste également à travers les façons de les financer. Les appels à projets se sont multipliés ces dernières années, comme nouveau mode de gestion des financements, engendrant une mise en concurrence entre les acteurs associatifs, voire publics, pour des budgets de court-terme.
La colonisation marchande du travail social génère également une pression aux fusions-absorptions, et l’émergence d’énormes trusts nationaux qui éradiquent les plus petites structures.
Par ailleurs, le passage d’Emmanuel Macron au Ministère de l’Économie, sous Français Hollande, a permis à la colonisation financière du social de faire un grand bond en avant, avec les Contrats à Impact Social, qui permettent à des investisseurs privés de prendre part aux financements d’actions sociales[24].
L’instrumentalisation politique des secteurs au service de la colonisation marchande exige dès lors un contrôle resserré des pratiques de terrain, ce qui tend à générer un véritable formatage des pratiques.
Un formatage des pratiques professionnelles
La marchandisation orchestrée par l’appareil d’État et les managers du social réduit la masse salariale à une variable comptable : les métiers doivent être recalibrés pour coûter moins cher et répondre mieux aux normes gestionnaires.
Les formations en travail social ont été plusieurs fois réformées, et auraient été bien plus uniformisées si un mouvement de protestation n’avait pas répondu aux États généraux du travail social[25]. Par ailleurs, une grande variété de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions moins qualifiés et moins bien payés se multiplient, et tendent de plus en plus à remplacer les métiers historiques : on observe une « déqualification » progressive et générale[26].
Le formatage des pratiques passe principalement par les instruments de gestion imposés :
- procédures et référentiels,
- appels à projet,
- cahiers des charges,
- tableaux de bord,
- bilans d’activité,
- fiches de liaison ou de suivi,
- indicateurs de la « démarche qualité »,
- mille-feuille de règlementations et de projets institutionnels…
Ces documents et dispositifs illustrent la colonisation marchande et gestionnaire, qui multiplie, empile et impose les procédures de travail et d’évaluation préformatées, avec, pour objectifs inatteignables, de faire entrer le réel dans les cases de logiciels de reporting, de notes de service, de tableurs Excel et de bilans financiers.
Au fur et à mesure que se développe l’écart entre normes gestionnaires et réalités humaines, entre « travail prescrit » et « travail réel »[27], se développe ce que j’appelle un double métier : d’une part, les professionnels s’efforcent de répondre aux missions sociales et éducatives au service des gens qu’ils accompagnent, d’autre part, ils doivent répondre aux injonctions et procédures gestionnaires au service des hiérarchies, et montrer que leurs pratiques et activités rentrent dans les formats imposés.
Cette gestionnarisation d’inspiration marchande s’appuie par ailleurs sur le financement de nouvelles technologies visant à suppléer et parfois à dépasser les limites de l’intervention humaine, au service des exigences de gestion : la vidéosurveillance dans les lieux de vie, l’informatisation, les e-mails, téléphones portables et « applis » de smartphones, les plateformes et logiciels de dématérialisation des services, les bornes de Pôle Emploi, de la CAF ou de la CPAM… Toutes ces technologies bouleversent profondément les relations et les communications entre les gens, mais aussi la lecture et, donc, la teneur des activités de terrain.
La gestionnarisation s’appuie sur ces différents instruments, procédures et technologies, et exige donc pour fonctionner un certain format de pratiques, ce qui engendre une tendance au formatage de celles-ci.
Ce formatage vise à optimiser la maîtrise technique, économique et politique des organisations de travail, des professionnels de terrain et de leurs pratiques. Ces derniers voient leurs conditions de vie, de travail, de reconnaissance, se dégrader. L’industrialisation en cours les renvoie, parfois douloureusement, à leur condition de prolétaires.
Une prolétarisation des professionnels de terrain
Malgré le fait qu’ils travaillent selon des démarches engagées au contact de gens, les travailleuses et travailleurs sociaux ont de plus en plus les caractéristiques sociales et professionnelles objectives, extérieures, de n’importe quel membre du prolétariat. D’un point de vue général, les prolétaires sont ceux dont le produit et le sens du travail ne leur appartiennent pas, car ils appartiennent à ou sont gérés par des hiérarchies économiques ou politiques. Autrement dit, les prolétaires sont celles et ceux qui sont sous les ordres de quelqu’un, et qui n’ont personne sous leurs ordres. Ils et elles ont par conséquent une position généralement subalterne dans les décisions liées à l’organisation du travail, et donc, de ce fait même, une condition socioéconomique plutôt modeste.
La figure des prolétaires a longtemps été assimilée à celle des seuls ouvriers, mais le développement des métiers des services doit faire évoluer notre perception : être un prolétaire ce n’est pas seulement travailler à l’usine ! De nombreux métiers sont concernés par cette prolétarisation, qui se repère principalement à deux phénomènes : l’exploitation au travail et le sentiment de perte de sens de celui-ci ou aliénation.
L’exploitation des travailleurs et des travailleuses sociaux se voit à trois niveaux.
- D’abord aux niveaux du salaire : la plupart d’entre eux gagnent bien moins que le salaire français moyen, qui est de 2200 € nets mensuels environ, et un grand nombre de travailleurs et travailleuses sociaux font partie des 50% de la population française qui touche moins de 1800 € nets mensuels[28].
- Ensuite dans les conditions de travail et les moyens dégradés – du moins quand les financements ne servent pas à imposer de nouveaux dispositifs gestionnaires et technologiques – ainsi que dans la subordination aux hiérarchies institutionnelles et aux « autorités de tarification », ce qui ne va pas sans les conflits du travail les plus tristement banals…
- Enfin dans l’utilisation fortement suggérée des « bons sentiments », de la bonne volonté, de la « personnalité », de « l’humanité » des travailleurs et des travailleuses sociaux : cette exploitation de l’engagement peut engendrer un surmenage, un sentiment de déni de reconnaissance, de vulnérabilité, de culpabilité, et contribue donc à la perte de sens du travail.
Car ce n’est plus un scoop, le travail social souffre d’une « crise de sens » : ce que signifie travailler dans le social en subissant une industrialisation, une marchandisation, une gestionnarisation…, ne correspond pas à l’idée qu’en ont en général les gens qui s’y engagent. Le sens qu’ils mettent dans leur travail leur est ôté, il est nié ou mal reconnu, ce qui peut provoquer souffrance et malaise. Ce phénomène est appelé aliénation par différents courants de pensée, en philosophie, sciences sociales ou en psychologie[29]. Il se repère concrètement dans le travail social à travers les phénomènes de turn-over du personnel, les arrêts maladie, les burn-out, les reconversions professionnelles, la dépolitisation des milieux de travail, qui apparaissent comme des espaces non-démocratiques… « Ce sont bien les organisations de travail et leur mode d’instrumentation par les politiques publiques qui constituent le vif de la crise actuelle. »[30].
Cette exploitation et cette aliénation sont, par ailleurs, généralement plus aiguës lorsque le travailleur social est une travailleuse sociale, ce qui est le cas pour une écrasante majorité des travailleurs de terrain[31]. Comme l’ont établi les recherches sur le travail du care, c’est sur les femmes que pèse le plus l’injonction à réaliser ces activités visant à prendre soin d’autrui, et l’on attend alors d’elles une sollicitude et une implication psychique encore plus fortes, mais que l’on peine à reconnaître à leur juste valeur : « il est difficile de savoir si les métiers du social sont peu valorisés parce qu’ils sont féminins, ou s’ils sont féminins parce qu’ils sont peu valorisés. Mais ce qui est clair, c’est que l’un renforce l’autre. »[32]
Déclarations d’indépendance
Comme le pointe le sociologue Michel Chauvière dans de multiples travaux, depuis les années 1980, la décentralisation a renforcé le poids de l’appareil d’État, qui fait peser sur tous les échelons une « stratégie top down (« de haut en bas »), autoritaire et systémique »[33], au service de la marchandisation. L’industrialisation du travail social signifie qu’il subit une lente colonisation par les logiques marchandes et par les contrôles gestionnaires et bureaucratiques, qui réforment en profondeur les métiers, les pratiques, les organisations et conditions de travail, jusqu’au sens des activités, et ainsi que, par conséquent, les conditions d’existence des professionnels et des personnes accompagnées. Les travailleuses et travailleurs sociaux sont appelés à devenir des ouvrières et ouvriers de la gestion sociale, des manutentionnaires de l’insertion.
Face à cette colonisation industrielle appuyée par l’appareil d’État, certains professionnels cherchent à proclamer leur indépendance, faisant émerger depuis quelques temps le thème du travail social indépendant. Ce dernier semble se présenter comme un ensemble de tentatives, d’expérimentations, pour sortir du rapport de subordination totale à l’appareil d’État. De ce point de vue, a priori, il semble difficile de s’opposer au travail social indépendant, qui semble se présenter comme un élan anticolonialiste et novateur. Pour comprendre les critiques qui lui sont faites, il faut confronter cette approche conceptuelle à certaines réalités actuelles du travail social indépendant.
II – Situation du travail social indépendant
Dans la septième édition de leur ouvrage classique d’introduction à la sociologie du travail social, publiée il y a une quinzaine d’années à peine[34], Jacques Ion et Bertrand Ravon ne consacrent pas un seul paragraphe au travail social indépendant. Pourtant, cette branche est suffisamment développée pour que différents médias en évoquent certaines formes[35]. La particularité de cette branche du travail social est d’avoir la possibilité de sortir une large partie de son cadre d’intervention des régulations de l’appareil d’État. Ce dernier réglemente les statuts des professionnels (formations et qualifications, droit du travail et protections sociales…), mais la relation aux personnes accompagnées par les travailleurs et travailleuses sociaux indépendants peut se faire dans le cadre d’une relation privée, marchande.
Cet aspect fait apparaître le travail social indépendant comme un relai direct de la colonisation marchande. Pour comprendre cette situation, il faudrait caractériser un peu plus concrètement comment se présente, actuellement, le travail social indépendant, car le fait est qu’il se développe presque entièrement sous la forme auto-entrepreneuriale et marchande. En effet, la prégnance du statut d’auto-entrepreneur dans le travail social indépendant et le risque d’ubérisation de certains secteurs du travail social suscitent la critique, mais ne doivent pas nous empêcher de chercher d’autres modèles de travail social indépendant.
2. 1 Le travail social en voie d’ubérisation ?
La forme actuelle de travail social indépendant commence à émerger, assez significativement, dès le courant des années 1980, alors que des travailleurs et travailleuses sociaux décident de quitter des secteurs encadrés du travail social, et notamment la fonction publique :
Les lourdeurs administratives et les dérives hiérarchiques et institutionnelles me pesaient
M. Prudet
annonce, dans un entretien[36], Monique Prudet, l’une des premières professionnelles à tenter l’expérience, et qui participe à la fondation de l’Association réseau national des travailleurs sociaux indépendants (ARTSI). Il semble assez clair que c’est la décentralisation qui, engendrant une emprise renforcée de l’appareil d’État sur les secteurs sociaux, a poussé ces acteurs à déserter le rapport d’instrumentalisation et de subordination salariale à cet appareil d’État[37]. Il est important de noter que cette génération de travailleurs et travailleuses sociaux indépendants prennent pour la plupart un statut calqué sur celui des professions dites libérales.
Le travail social indépendant, lorsqu’il apparaît dans sa forme moderne, dans les années 1980 – 1990, est donc globalement un travail social en libéral. Les professionnelles concernées se comptent « sur les doigts d’une main », et exercent principalement au sein de différentes organisations souhaitant mettre en place un service social (entreprises, bailleurs immobiliers, cliniques…)[38]. Les personnes ou les ménages ne représentent qu’une petite partie des clients de ces professionnelles en libéral.
La rencontre fondatrice de l’ARTSI, à la fin des années 1990, rassemble une vingtaine d’assistantes de service social et de conseillères en économie sociale et familiale, exerçant en libéral, ce qui suggère la position très minoritaire du travail social en libéral dans les secteurs sociaux. Malgré sa faible visibilité, il s’est pourtant développé dans différents secteurs :
- service social en entreprise,
- service social hospitalier,
- protection juridique des majeurs,
- enquêtes sociales commandées par les tribunaux ou par l’Aide sociale à l’enfance…
Cependant, si le travail social indépendant a une position minoritaire dans les secteurs sociaux, ce n’est pas seulement parce qu’il est encore peu développé, mal connu et reconnu dans les cultures professionnelles du Social au sens large. C’est aussi parce que sa principale forme actuellement fait jaillir de profonds questionnements et incertitudes sur le sens des métiers du social, sur le rapport aux personnes accompagnées, au travail en général…
Le travail social en libéral émerge en effet à une époque où dominent peu à peu le « culte de la performance » et le « néo-individualisme »[39], ainsi que la critique libérale des institutions. Ces dénonciations de l’archaïsme et de l’inertie de l’appareil d’État comme entraves à l’essor des activités économiques imposent alors à ce dernier des mutations importantes, qui restructurent toutes les politiques publiques.
Ainsi, l’aide à la création d’entreprise devient dans le dernier quart du XXème siècle un « outil consensuel utilisé tant par la droite que par la gauche de gouvernement. Cette dimension consensuelle se comprend à travers la mise en place d’une rhétorique entrepreneuriale qui appartient à la famille économique et politique du libéralisme »[40].
L’entreprise est progressivement érigée en « modèle culturel de masse »[41]. Les logiques marchandes, concurrentielles, sont réputées fournir aux gens la discipline la plus efficace, en vue de continuellement « améliorer leur offre d’eux-mêmes »[42]. Cette injonction massive à la performance, à être « entrepreneur de soi-même »[43] peut être analysée comme un renouveau du contrôle social[44]. Le travail social en libéral inquiète car il est d’abord perçu comme un fruit de cette colonisation marchande et de l’injonction entrepreneuriale.
Le travail social en libéral est donc vu comme une source de déstabilisation des secteurs sociaux, car il amène à voir l’acte professionnel comme une marchandise, ce qui est en opposition avec les logiques de solidarité et de service public qui fondent le social. Il est craint que ce modèle de travail social ne soit bientôt dominé par une logique de service privé, marchand et concurrentiel, uniquement accessible à ceux (organismes comme particuliers) qui auront les moyens de payer des intervenants à la prestation. Parce qu’il est a priori en congruence, en adéquation, avec la colonisation marchande portée par l’appareil d’État et les managers du social, le travail social libéral pourrait être directement ou indirectement instrumentalisé par ces derniers.
L’inquiétude à l’égard du travail social indépendant s’est cependant renforcée avec l’apparition de la forme auto-entrepreneuriale et sa diffusion dans les années 2010. En effet, cette forme récente paraît premièrement alimentée par la critique libérale de l’appareil d’État : Hervé Novelli, le secrétaire d’État responsable de la mise en place du statut d’auto-entrepreneur, explique en effet dans un entretien que selon lui le « grand problème » de notre pays était, non pas la concentration des richesses et des pouvoirs, mais plutôt, « la surrèglementation, l’excès de normes, et le Code du Travail en est un bon exemple »[45].
Cette critique libérale va de pair avec une volonté de libéralisation des activités entrepreneuriales et économiques, une passion pour la compétition marchande : c’est la pseudo-idéologie de la gagne, promue par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, à travers son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Cette idéologie diffuse l’illusion que ces formes entrepreneuriales individuelles vont être pour tous et toutes une libération des entraves institutionnelles, qui les empêchaient de mieux gagner leur vie : « aujourd’hui je fais un bon salaire, mais avec beaucoup plus d’heures », fait observer une assistante sociale en libéral dans Lien Social[46]. Le statut d’auto-entrepreneur semble être une matérialisation, une mise en pratique, à la fois légale et concrète, de la figure du « gagneur » et du nouvel entrepreneur-aventurier qui se diffuse dans le dernier quart du XXème siècle et remplace celle du « grand patron »[47].
Ce statut favorise le lancement de nombreux travailleurs et travailleuses sociaux dans des activités entrepreneuriales : « Il n’y a pas de statistiques disponibles mais la tendance est là… »[48]. De nouveaux secteurs sont investis par les travailleuses et travailleurs sociaux en libéral, tels que la « guidance parentale » et l’intervention à domicile. Mais le statut de micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur produit une différence sensible par rapport au travail social en libéral qui avait émergé dans les années 1980 – 1990, notamment du point de vue de leurs modèles de référence. En effet, si le travail social en libéral est plutôt fondé sur le modèle des professions libérales et indépendantes, le travail social en auto-entrepreneur, quant à lui, inquiète, car il risque d’importer les dérives de l’ubérisation dans les secteurs sociaux.
La distinction entre ces deux formes de travail social indépendant est cependant assez fine, beaucoup considérant même le travail social en auto-entrepreneur comme une forme très récente de travail social en libéral. Ce qui est sûr, c’est que la forme auto-entrepreneuriale transforme la conception du travail social libéral.
On peut donc imaginer sans difficulté que l’accès aux services des nouveaux intervenants en libéral pourrait être très difficile pour certains ménages ne disposant pas des fonds ou des capacités de négociation pour mettre en place ces interventions. Les secteurs non-marchands, encadrés par l’appareil d’État, verraient alors se réduire la mixité des populations accompagnées, laissant entre eux des gens qui n’ont pas eu d’autre choix que le service public dégradé.
Comme avec les hôpitaux et institutions sanitaires, les établissements scolaires de tous niveaux, les transports de personnes, on assisterait alors à une dualisation, une séparation, entre des secteurs privés auxquels certaines catégories sociales auraient les moyens et la démarche de faire appel, et des secteurs publics dégradés où d’autres catégories sociales se retrouveraient de fait assignées. Sous cette forme, le travail social indépendant alimenterait à nouveau la déstabilisation des secteurs par la marchandisation. En effet il a fréquemment été pointé que ce statut « devient un outil pratique et exploité par les entreprises pour embaucher ou débaucher sans passer par les formalités liées à l’embauche […] Le fait de pouvoir esquiver le droit du travail constitue aujourd’hui une stratégie payante, du moins à court terme. »[49]
Pour des questions de trésorerie, les structures sociales sont de plus en plus amenées à faire appel à des intervenants ponctuels libéraux ou intérimaires[50], souvent extérieurs à l’histoire des établissements, des personnes accompagnées, des collectifs de travailleuses et de travailleurs, et qui doivent intervenir dans des temporalités limitées et difficiles.
Cette dernière observation est étayée par ceux et celles qui étudient la diffusion du modèle auto-entrepreneurial depuis une dizaine d’années, pointant notamment que celui-ci est fort loin de sauver définitivement les travailleuses et les travailleurs de l’exploitation et de l’aliénation[51]. En effet, les situations de « salariat déguisé » se multiplient, les auto-entrepreneurs étant « très contraints par les horaires des entreprises avec qui ils sont en échange, par le fait que, comme ils sont payés à la quantité de travail, ils se sentent tenus de travailler beaucoup »[52].
Il est intéressant de constater qu’historiquement le travail social en libéral s’est développé comme un service à des entreprises ou organismes, sous la forme d’une sous-traitance du service social à une intervenante extérieure. Cette configuration se retrouve chez les assistantes sociales en libéral, actuellement, comme nous l’apprend un journal du Maine-et-Loire retraçant les débuts de deux d’entre elles, désireuses d’intervenir auprès de ménages qui les solliciteraient : « Ni l’une ni l’autre ne se font encore un vrai salaire. Elles compensent leur faible tarification avec des prestations ponctuelles pour des entreprises ou des opérations de communication […] »[53]
Ainsi, le statut de travailleuse ou travailleur indépendant, libéral ou auto-entrepreneur, perpétue une injonction entrepreneuriale qui peut être toxique : « l’indépendance s’obtient en étant l’entrepreneur de soi-même, où « soi-même » est le produit et l’image du produit, voire l’entreprise et l’image de l’entreprise »[54]. Cette « entrepreneurisation des comportements » engendre ceci que « chacun porte de plus en plus le poids de ses responsabilités […] Désormais les erreurs se paient comptant »[55].
Ce que confirme à sa façon Monique Prudet, l’une des premières assistantes sociales à exercer en libéral :
« Nous ne pouvons jamais « ouvrir le parapluie ». Ce qui bloque les initiatives, en effet, ce n’est pas l’aspect financier, puisqu’on peut très bien démarrer petit à petit […] mais c’est le fait d’être seule responsable en tant que personne, car à ce moment ce n’est plus le service social qui porte le « chapeau » mais Madame X, citoyenne à part entière, face aux usagers et aux établissements… »
M. Prudet [56]
De même, comme le confie sous forme d’euphémisme une assistante sociale devenue auto-entrepreneure en 2017, « le libéral n’est pas de tout repos »[57], ces statuts peuvent provoquer de l’anxiété, du surmenage, un malaise dans le travail. L’injonction entrepreneuriale n’est donc pas seulement synonyme de libération, comme le voudraient les néolibéraux, mais peut raviver des souffrances sociales : « l’obsession de gagner, de réussir, d’être quelqu’un et la consommation en masse de médicaments psychotropes sont étroitement liées, parce qu’une culture de la conquête est nécessairement une culture de l’anxiété qui en est la face d’ombre »[58].
Il faut ici ajouter que les souffrances sociales générées par l’injonction entrepreneuriale semblent particulièrement atteindre les catégories sociales de la population où sont recrutés les travailleuses et travailleurs sociaux : « Sentiment d’impuissance, de désespoir, de dévalorisation […] Quelle que soit la tranche d’âge, ce sont surtout les femmes des classes populaires urbaines qui surconsomment les médicaments psychotropes »[59]. On ne peut s’empêcher de penser que l’injonction paradoxale à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et la performance de soi-même, tout en prenant soin d’autrui en toute abnégation, peut effectivement produire des difficultés de positionnement, spécifiquement chez les travailleuses sociales.
Au final, tout comme le travail social encadré par l’appareil d’État, le travail social indépendant peut lui aussi présenter des pathologies spécifiques par rapport au projet initial de solidarité ou de secours sociaux, notamment dans sa forme libérale et, surtout, auto-entrepreneuriale.
Cette forme tend à sortir le travail social de l’encadrement par l’appareil d’État pour le jeter directement sous la mâchoire de la colonisation marchande. Les travailleurs et travailleuses en quête d’indépendance ne pourraient alors conquérir qu’une forme d’autonomie toute relative, toujours entravée par des phénomènes d’exploitation (sous-traitance de fait et « salariat déguisé », précarité économique…) et d’aliénation (anxiété, surmenage…).
Cette description est celle de l’ubérisation, qui caractérise surtout la situation des chauffeurs Uber et autres « travailleurs des applis »[60]. De ce point de vue, la critique de la condition d’auto-entrepreneur s’avère nécessaire, car elle produit des bataillons de « nouveaux prolétaires »[61]. Mais dans quelle mesure cette critique s’applique-t-elle au travail social ? En effet, l’intérêt porté au travail social indépendant doit nous amener à nous demander plus précisément ce que recherchent les professionnels qui expérimentent une activité libérale.
L’hypothèse que l’on peut émettre est que le travail social indépendant existe précisément parce que les travailleuses et travailleurs sociaux ont besoin d’une certaine indépendance pour s’adapter aux territoires, aux personnes, aux phénomènes qu’ils et elles rencontrent.
Cela expliquerait que le travail social soit largement mis en difficulté par les processus de gestionnarisation, de formatage des pratiques, d’industrialisation, qui limitent forcément les marges de manœuvre des professionnels. L’accès à une autonomie permettant de travailler plus adéquatement est ce que le travail social indépendant semble favoriser a priori.
2. 2 La praxis du travail social indépendant
Depuis la seconde moitié du XXème siècle au moins, le concept d’autonomie infuse dans les politiques sociales et le travail social. Bien entendu, ce concept comporte une diversité de significations selon sa provenance : l’injonction à l’autonomie provenant de l’appareil d’État ou du management social ne renvoie pas à la même signification que la revendication d’autonomie portée par exemple par les acteurs et actrices de Mai-68 et leurs héritiers libertaires, et diffère également de l’autonomie recherchée par les professionnels en libéral. Cependant, il semble possible de dégager une définition consensuelle : l’autonomie pour l’individu ou le groupe est la possibilité de s’impliquer dans son propre sort à travers un savoir et un pouvoir sur les conditions qui déterminent ce sort.
Ce sont ces dernières qui, en renvoyant à des possibles différents, opposent les différentes visions de l’autonomie. Quoi qu’il en soit, la définition consensuelle en elle-même permet de conceptualiser le travail social comme une activité où des sujets utilisent leur autonomie pour soutenir en pratique d’autres sujets dans le développement de la leur. Ce type d’activité, qui peut regrouper le travail social, le soin, l’éducation, notamment, est appelé praxis par le philosophe Cornélius Castoriadis, c’est-à-dire un « faire dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme êtres autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie […] La praxis est ce qui vise le développement de l’autonomie comme fin et utilise à cette fin l’autonomie comme moyen. »[62]
Cette quête de l’autonomie dans le travail social est donc fondamentale à prendre en compte : elle permet de jeter une lumière très différente sur la quête d’indépendance qui travaille de plus en plus le secteur. En effet, il faut reconnaître que la majorité des travailleuses et travailleurs sociaux qui expérimentent actuellement une activité en libéral le font parce que ce modèle est supposé leur conférer une plus grande autonomie, non pas – ou pas seulement – parce qu’ils souhaitent faire de leur travail une activité lucrative !
Cette exigence d’autonomie est l’une des principales raisons poussant des travailleuses et travailleurs sociaux à vouloir sortir de l’encadrement gestionnaire : la plupart estiment vraisemblablement que leur activité les rapproche moins de la figure de l’ouvrier à la chaîne que de celle de l’artisan indépendant. C’est ce que suggère le sociologue Michel Autès : le travail social, « ce n’est pas l’application de techniques issues d’un savoir à des situations toujours identiques. C’est, à chaque fois, une expérience recommencée, dans un autre contexte, avec d’autres circonstances, dans des systèmes d’interaction chaque fois marquée des particularités propres aux personnes […] Non pas que les techniques soient inutiles, au contraire elles sont les échafaudages de l’action. Mais elles ne sont pas plus que des échafaudages »[63].
Les enjeux du travail social indépendant doivent donc également être observés en ayant cette dimension en tête, à savoir, qu’il émerge d’un monde professionnel dont l’activité de base peut être pensée comme une praxis artisanale, c’est-à-dire un art de cultiver sa propre autonomie en vue de cultiver adéquatement celle d’autrui : la recherche d’autonomie chez les personnes accompagnées recoupe la recherche d’indépendance des professionnels.
À une époque où pourtant le travail social indépendant était quasiment invisible, M. Autès écrivait déjà que la construction des professions classiques du travail social leur confère un « caractère mixte qui par certains côtés, principalement, les rattache au statut de salarié, mais qui, par d’autres, leur attribue certaines caractéristiques des « professionnels » au sens de libéral. C’est une profession qui se donne ses propres normes de travail. Et qui, tout en exerçant dans le cadre d’une relation salariale avec un employeur, privé ou public, garde une large autonomie dans la définition de ses objectifs, de ses tâches, de son organisation du travail. Encore une fois, le caractère « professionnel » de la formation, à l’écart du système dominant et, notamment, de l’université, souligne et accentue ce caractère de spécificité et d’autonomie »[64]. On peut alors comprendre que les premières assistantes sociales qui ont démarré une activité indépendante se référaient davantage au modèle des professions libérales qu’à celui de l’auto-entrepreneur, simplement pressé de « travailler plus pour gagner plus ».
On le remarque assez clairement avec la Charte de l’Association réseau des travailleurs sociaux indépendants (ARTSI)[65], la première en son genre, qui établit que les adhérents doivent être des « professionnels diplômés d’État » (y compris les éventuels « sous-traitants » ou salariés), qui s’engagent à « suivre la déontologie de leur profession d’origine », à « refuser les missions qui seraient en contradiction avec l’éthique des professions sociales et l’intérêt des usagers. » [66]
Ces prescriptions témoignent des « efforts pour fermer le territoire professionnel », en définissant différentes règles de qualification, d’appartenance et de déontologie, comme le font souvent les corporations d’artisans et professions indépendantes, construisant ainsi leur « idéologie de métier »[67]. Cette « idéologie de métier » amène les professions indépendantes à rechercher, dans leur activité, leur statut, un « supplément d’être » plutôt qu’un simple profit financier, ce qui en fait de véritables « entrepreneurs non maximisant », comme le dit Charles Gadéa[68].
« On n’est pas là pour se faire de l’argent sur la souffrance des gens […] On fait ce métier parce qu’on l’aime. Et la façon dont je le faisais dans les services publics ne me convenait plus », annonce une assistante sociale en libéral du Maine-et-Loire[69]. « J’ai pu retrouver les valeurs d’accompagnement qui m’avaient fait venir vers ce métier », témoigne une autre[70]. Tout comme ces différentes professionnelles, l’ARTSI fait passer les règles éthiques avant celles du fric, stipulant encore dans sa Charte :
« les adhérents qui reçoivent des particuliers à titre payant s’engagent à informer ces derniers de l’existence d’un service social public et/ou institutionnel gratuit ainsi que du montant de leurs honoraires. Ils s’engagent à privilégier l’intérêt du client au sien propre. Comme tout travailleur social, ils ont l’obligation de moyens mais pas celui de résultats »
Charte de l’ARTSI
Le juriste Alain Supiot signale bien à ce titre que les professions indépendantes peuvent constituer l’un des modèles théoriquement alternatifs à la « fiction du travail-marchandise », car ils demeurent centrés sur « l’œuvre » ou le « service » à accomplir en direction du public, davantage que sur la rétribution financière escomptée[71]. L’amour de l’œuvre, du métier, la « soif d’autonomie » que les travailleuses et travailleurs sociaux indépendants partagent avec d’autres professions indépendantes, comptent tellement qu’ils peuvent même les amener à adopter des « comportements anti-économiques »[72], comme c’est le cas pour cette éducatrice qui accueille des enfants à son domicile : « nos charges sont énormes. Au niveau salaire, ou plutôt bénéfice, j’ai 2000 F [environ 300€] par mois », mais le plus important est que « nous sommes autonomes et indépendants »[73].
Pour autant, comme nous l’avons vu en étudiant l’apparition du travail social en libéral, il n’est pas sûr que ce modèle soit plus adéquat que ceux du salariat encadré par l’appareil d’État ou du « nouveau prolétaire » déguisé en « auto-entrepreneur », car il ne s’oppose pas totalement à la logique concurrentielle et individualiste actuellement dominante. Ce modèle a pourtant le mérite d’illustrer l’importance de la volonté d’autonomie des acteurs et actrices de terrain dans le travail social. Toute l’organisation du travail dans les secteurs sociaux est mise en question par cette irruption du travail social indépendant et du besoin d’autonomie qu’il exprime, car ils rappellent que le travail social peut se conceptualiser, du point de vue du terrain, comme une praxis artisanale, c’est-à-dire un art de cultiver sa propre autonomie au service du développement de celle d’autrui. Cette vision du travail social est en opposition avec les phénomènes d’industrialisation, qui alimentent déroutes et paradoxes.
La crise actuelle du travail social ne renvoie-t-elle pas au fait que pour travailler autour de l’autonomie des personnes accompagnées, dans toute leur diversité, les travailleuses et travailleurs sociaux ont eux-mêmes besoin d’une certaine autonomie ?
Les professionnels et les personnes accompagnées auraient donc à ce niveau des intérêts communs à préserver leur autonomie commune. Cela n’exprime ni plus ni moins qu’un besoin de démocratie dans le travail social, contre son instrumentalisation et la verticalité de sa chaîne de commandement. Les tâtonnements entrepris par tous les professionnels qui recherchent ou revendiquent leur indépendance, au nom de ce qu’implique leur métier, appellent à poursuivre la recherche d’un travail social indépendant plus démocratique, en osmose avec son projet solidaire initial. Pour conclure cette réflexion, j’aimerais par conséquent suggérer une piste de réponse, a priori située à égale distance de l’appareil d’État et des logiques marchandes et concurrentielles, car issue de l’économie sociale et solidaire : le système coopératif.
Conclusion : l’hypothèse du travail social coopératif
Mon désir de présenter, en conclusion, l’hypothèse d’un travail social coopératif est motivé par les critiques et les efforts que déploient tous ces travailleuses et travailleurs sociaux dans l’aspiration à se constituer un autre rapport à leur activité. Un modèle juridique existe depuis 1995, les Coopératives d’activité et d’Emploi (CAE), qui regroupent actuellement 10 000 « entrepreneurs salariés » de différents métiers, et permettent à ces travailleurs et travailleuses une grande autonomie dans leur activité, tout en leur conférant de nombreux supports et protections liés à leur condition de salariés et membres d’une structure coopérative[74].
Certes, ce modèle n’est pas un remède miracle, car, comme le rappelle la sociologue Sarah Abdelnour, tout statut d’indépendant peut lui-même donner lieu à des phénomènes d’exploitation : « le renouveau du travail indépendant est ainsi au service des entreprises qui en abusent »[75]. Il faut donc défendre un travail social indépendant démocratique donc collectif, et référé au secteur indépendant « relativement qualifié et « organisé » », pour espérer le préserver de l’ubérisation. C’est à cette condition que « les coopératives d’activité et d’emploi peuvent être des espaces de réinvention face à un salariat jugé trop vertical », pour reprendre encore les mots de Sarah Abdelnour. Les anthropologues Flora Bajard et Maya Leclercq, dans leurs recherches sur les « entrepreneurs salariés » en CAE, notent bien, en effet, que ces structures sont « une forme d’entrepreneuriat originale qui s’appuie sur les principes coopératifs (démocratie, mise en commun des savoir-faire, partage équitable du pouvoir, des risques, de l’information et des bénéfices…) pour proposer un nouveau cadre, entre indépendance et salariat »[76]
Les travailleuses et travailleurs indépendants en coopérative ne rejettent pas le salariat en tant que tel, mais cherchent, pour différentes raisons, davantage « d’autonomie financière, professionnelle et existentielle. »[77] Ces « travailleurs.euses autonomes » semblent au final avoir des aspirations similaires à celles des travailleuses et travailleurs sociaux indépendants : « l’autonomie recherchée n’est pas n’importe laquelle, mais une autonomie ajustée aux pratiques de travail, valeurs et aspirations des entrepreneurs.es, de sorte à être véritablement émancipatrice. »[78]
L’hypothèse d’un travail social coopératif est ici offerte à toutes celles et tous ceux qui voudraient prendre part aux nombreuses et vastes perspectives de réflexion et d’expérimentation qu’elle ouvre : comment garantir un financement pérenne et indépendant ? Des procédures démocratiques de prises de décision pourraient-elle redonner un pouvoir véritable aux personnes accompagnées par les coopératives ? Quelle pourrait être le lien du travail social indépendant en mode coopératif avec les structures de l’économie sociale et solidaire ? Avec celles du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux, de la société civile en général ? Comment construire et tirer parti des collectifs de travailleurs et travailleuses en coopérative[79] ?
Plus globalement, en maintenant à distance les encadrements par l’appareil d’État ou les logiques marchandes et concurrentielles, l’hypothèse de coopératives de travail social ne permettrait-elle pas de contrer les dérives de l’industrialisation, en retrouvant un peu du projet qui, initialement, était commun aux militantismes fondateurs des mouvements ouvriers, de l’économie sociale et solidaire, et du travail social : solidarité, démocratie directe, autonomie ?
Notes de bas de page :
[1] André Guigot, 2006, Michel Foucault. Le philosophe archéologue, Coll. Les essentiels Milan, p. 33.
[2] Louli Jonathan, 2018, « Le travail social en voie d’industrialisation ? » in Le Sociographe, n°64, pp. 95-103
[3] Pierre Dardot, Christian Laval, 2010, « Néolibéralisme et subjectivation capitaliste », in Cités, n°41, p. 39.
[4] Flora Bajard, Maya Leclercq, 2019, « Devenir entrepreneur(e) en coopérative d’activité et d’emploi : les 1001 visages de l’émancipation », in Journal des anthropologues, n°158 – 159, p. 154.
[5] Robert Castel,2005, « Devenir de l’État providence et travail social », in Jacques Ion (dir.), Le travail social en débat[s], La Découverte, p. 31.
[6] Idem p. 33.
[7] Ibid pp. 36 sq.
[8] Danièle Demoustier, 2001, L’économie sociale et solidaire. S’associer pour entreprendre autrement, Paris, La Découverte – Syros, pp. 25 – 34.
[9] Philippe Batifoulier, 1995, L’économie sociale, Paris, P.U.F, p. 15.
[10] Danièle Demoustier, ibid.
[11] Henri Pascal, 2014, Histoire du travail social en France. De la fin du XIXe à nos jours, Rennes, Presses de l’EHESP, p. 94.
[12] Michel Autès, 1999, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod, pp. 1 – 2.
[13] Idem, p. 240.
[14] Marcel Jaeger, 2018, « Mai 68 : la deuxième naissance du travail social », in The conversation, en ligne
[15] Michel Autès, op.cit., p.49.
[16] Marcel Jaeger, ibid.
[17] Pour paraphraser le sociologue Erving Goffman, dans son livre Asiles, paru en France pour la première fois en 1968.
[18] Francine Muel-Dreyfus, 1980, « L’initiative privée », in Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 32-33, pp. 15 – 49.
[19] Brigitte Bouquet, 2011, « Regards sur le contrôle social. Une approche socio-historique », in Marie-Christine Bureau, Ivan Sainsaulieu (dir.), Reconfigurations de l’État social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 36 – 39.
[20] Pierre Dardot, Christian Laval, 2010, « Néolibéralisme et subjectivation capitaliste », in Cités, n°41.
[21] Alain Ehrenberg, 2003 [1991], Le culte de la performance, Paris, Hachette Littératures, p. 243.
[22] Jonathan Louli, 2018, « Le travail social en voie d’industrialisation ? » in Le Sociographe, n°64, pp. 95–104
[23] Pierre Dardot, Christian Laval, 2007, « La nature du néolibéralisme : un enjeu théorique et politique pour la gauche », Mouvements, vol. 50, n°2, p. 108 – 117.
[24] Margot Hemmerich, Clémentine Méténier, 2019, « Solidarité à but hautement lucratif », in Le Monde Diplomatique, disponible en ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/10/HEMMERICH/60476.
[25] Jonathan Louli, 2015, « Les travailleurs sociaux face à la réforme de leurs métiers. Retour sur deux ans de lutte », in Terrains de luttes
[26] Michel Autès, op. cit., pp. 140-141.
[27] Christophe Dejours, 2003, L’évaluation du travail à l’épreuve du réel. Critique des fondements de l’évaluation, Paris, INRA.
[28] Données consultables sur le site de l’Observatoire des inégalités : www.inegalites.fr.
[29] Dans le n°39 de la revue Actuel Marx, sur le thème de l’aliénation, voir notamment les contributions de Franz Fischbach et Christophe Dejours. URL : https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2006-1.htm
[30] Michel Autès, op.cit., p. 275.
[31] Henri Pascal. op.cit., pp. 281 sq.
[32] Linda Daovannary, 2018, « Métiers du social : quand féminisation rime avec moindre valorisation », TSA Quotidien (en ligne)
[33] Michel Chauvière, 2010, « Quel est le « social » de la décentralisation ? », in Informations sociales, n°162, p. 28
[34] Jacques Ion, Bertrand Ravon, 2005 (7ème édition), Les travailleurs sociaux, Paris, La Découverte.
[35] Voir le dossier consacré aux éducateurs et éducatrices en libéral dans Lien Social, n°1216, 2 novembre 2017, ou encore la revue de presse de Didier Dubasque du 31 décembre 2019, « Travail social : l’avenir est-il dans le libéral ? » lisible sur son site : https://dubasque.org/2019/12/31/travail-social-lavenir-est-il-dans-le-liberal-une-fresque-a-la-memoire-de-son-educatrice/.
[36] Guy Benloulou, Joël Plantet, 1996, « Des travailleurs sociaux en libéral », in Lien Social, n°346 (en ligne).
[37] Rouja Lazarova, 2014, « Travail social : ces libéraux qui peinent à séduire », in Gazette Santé Social, (en ligne).
[38] Historique présenté sur le site de l’Association réseau national des travailleurs sociaux indépendants (ARTSI) : http://www.artsi.asso.fr/historique/
[39] Alain Ehrenberg, 2003 [1991], Le culte de la performance, Paris, Hachette Littératures
[40] Marion Beauvalet, 2018, « L’ubérisation, un retour au xixème siècle ? – entretien avec Sarah Abdelnour » in Le Vent Se Lève (en ligne).
[41] Alain Ehrenberg, Ibid., p. 197.
[42] Christophe Trombert, 2011, « Le social auto-disciplinaire de marché, nouveau référentiel de l’insertion ? », in Marie-Christine Bureau, Ivan Sainsaulieu (dir.), Reconfigurations de l’État social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 47 – 60.
[43] Alain Ehrenberg, Ibid..
[44] Brigitte Bouquel, op.cit., pp. 40 sq.
[45] Dans un épisode de l’émission Du grain à moudre, animée sur France Culture par Raphaël Bourgois, intitulé « Autoentrepreneur : une fausse bonne idée ? », et mis en ligne le 8 janvier 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/autoentrepreneur-une-fausse-bonne-idee
[46] Guy Benloulou, Joël Plantet, ibid.
[47] Alain Ehrenberg, op.cit., pp.204-207.
[48] Emmanuelle Chaudieu, 2018, « Se lancer dans l’aventure du travail social en libéral ? », in Le Média Social (en ligne).
[49] Marion Beauvalet, ibid.
[50] Charlène Charles, 2018, « Les paradoxes de l’intérim dans le travail social. Le cas des intérimaires des foyers de l’enfance » in Le Sociographe, n°64, p. 23 – 38.
[51] C’est, du reste, ce que montre brillamment le dernier film de Ken Loach, Sorry we missed you, en dépeignant les multiples difficultés à travailler et à vivre rencontrées par un livreur ubérisé.
[52] Marion Beauvalet, ibid.
[53] Courrier de l’Ouest, vendredi 27 décembre 2019, « Maine-et-Loire. Elles ont choisi d’exercer leur métier d’assistante sociale en libéral » (en ligne)
[54] Alain Ehrenberg, op.cit., p. 182.
[55] Idem, pp. 252-253.
[56] Guy Benloulou, Joël Plantet, ibid.
[57] Aude Mallaury, 2019, « Assistantes sociales en libéral : le défi de l’indépendance » in Le Média Social (en ligne).
[58] Alain Ehrenberg, op.cit., p. 257.
[59] Alain Ehrenberg, idem, p. 266.
[60] Sarah Abdelnour, Dominique Méda (dir.), 2019, Les nouveaux travailleurs des applis, Puf/Vie des idées
[61] Sarah Abdelnour, 2012, Les Nouveaux Prolétaires, Paris, coll. « Petite encyclopédie critique »
[62] Cornélius Castoriadis, 1975, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, p. 112.
[63] Michel Autès, op.cit., p. 248.
[64] Idem, p. 232.
[65] Qu’on trouvera p. 167 dans le présent Cahier de l’Actif.
[66] http://www.artsi.asso.fr/adherer/
[67] Claude Dubar, Pierre Tripier, 1998, Sociologie des professions, Paris, S.E.S.J.M/Armand Colin, p. 189 – 190.
[68] Cité dans Claude Dubar, Pierre Tripier, ibid.
[69] Courrier de l’Ouest, ibid.
[70] Aude Mallaury, ibid.
[71] Alain Supiot, 2019, Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle, Paris, Collège de France, coll. « Leçons de clôture », p. 38.
[72] Claude Dubar, Pierre Tripier, op.cit., p.188.
[73] Guy Benloulou, Joël Plantet, ibid.
[74] Flora Bajard, Maya Leclercq, 2019, « Devenir entrepreneur(e) en coopérative d’activité et d’emploi : les 1001 visages de l’émancipation », in Journal des anthropologues, n°158 – 159, p. 152
[75] Marion Beauvalet, ibid.
[76] Flora Bajard, Maya Leclercq, op.cit., p. 152.
[77] Idem, p. 159
[78] Idem, p. 170
[79] Flora Bajard, Maya Leclercq, op.cit., pp. 167-168.

thami habchi - 27 octobre 2020 à 18h41
Merci bcp