Epicure, ou la connaissance au service de la vie bonne
18 Mai 2021
Imprimer
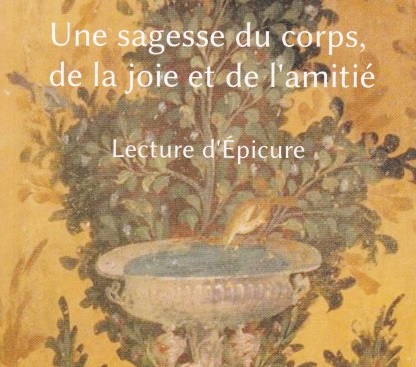
Note de lecture de :
Emilio Lledó, Une sagesse du corps, de la joie et de l’amitié. Lecture d’Épicure, Blajan, Solanhets Éditeur, 2017, 158 p., traduit de l’espagnol par Vincent Ozanam
Diffusée sur le site Lectures (6 septembre 2017)
Site des éditions Solanhets
Après avoir été réédité plusieurs fois en espagnol depuis les années 1980, l’ouvrage d’Emilio Lledó est enfin disponible pour le lecteur francophone, agrémenté par une préface de l’auteur à la dernière édition espagnole de 2014, grâce à une traduction de Vincent Ozanam. Lledó, philosophe né en 1927 à Séville, est présenté par les éditeurs comme une « référence » pour ses travaux sur la philosophie grecque, la morale et le langage. Il signe ici un ouvrage passionnant – car passionné – visant à réhabiliter la pensée d’Épicure contre les simplifications et attaques dont elle a été victime tout au long de l’histoire – y compris, et c’est une des particularités de l’épicurisme, du vivant d’Épicure. L’objectif du livre est de restituer à la fois quelques-unes des plus importantes implications de ce courant de pensée, porteur d’une « idée révolutionnaire de l’existence » (p. 15), ainsi que les conditions intellectuelles d’émergence de ces savoirs spécifiques. Partant à la recherche du « germe de liberté et de créativité » (p. 18) qui anime l’épicurisme, le livre de Lledó se découpe en une quinzaine de petites parties, prenant chacune pour thème un aspect clé de la pensée épicurienne aux yeux de l’auteur espagnol.
La pensée d’Épicure émerge dans un contexte socialement et politiquement troublé, peu après la chute de l’empire d’Alexandre. Les penseurs de l’époque abandonnaient peu à peu « l’idéal de la polis » et, cherchant à répondre à la question « comment bien vivre ? », ils héritaient en même temps des « problèmes théoriques » posés par Platon, Aristote et leurs disciples. C’est à cette époque qu’Épicure entame son travail intellectuel et fonde une école près d’Athènes vers -306, le Jardin. À cette époque où théorie et pratique n’avaient pas vocation à être séparées, le philosophe insiste, davantage que nombre de ses illustres prédécesseurs, sur le fait que la philosophie doit aider à prendre « conscience des limites réelles de la vie » (p. 26), relatives notamment à la dimension « corporelle » de l’existence humaine, mais, en même temps, contribuer à produire de la « liberté », entendue comme l’émancipation de tous les modes de pensée aliénant transmis « par inertie » dans les cultures et les usages.
Cette « nouvelle attitude théorique » (p. 36) promue par l’épicurisme suggère un rapport neuf à la philosophie et au langage. Elle abandonne justement son « combat » contre le langage et veut rénover le sens et l’enjeu de la connaissance philosophique, en les orientant selon la perspective du bonheur humain. Cela implique un nouvel usage du langage et du savoir : le « langage culturel », qui éloigne des réalités naturelles, doit être questionné. Épicure cherche à interroger et à connaître les êtres humains à partir de leurs modes de vie concrets, en vue de mieux se « faire comprendre » et afin que les lecteurs puissent mémoriser ses propos.
En proposant cette nouvelle « épistémologie », Épicure s’attaque donc aux « consolations métaphysiques » que sont les cultures abstraites héritées sans « conscience critique », à commencer par les mythes et religions. « Les dieux existent parce que les hommes parlent d’eux » (p. 80) : les religions cosmiques et leurs dieux aux desseins impénétrables sont « de vieux habitants de notre langage » et de nos consciences, mais leurs voix sont désormais plus lointaines que jamais. C’est pourquoi l’épicurisme estime que nous gagnerions davantage à connaître la nature – y compris la nature humaine – pour nous en émanciper, plutôt que d’attendre d’éventuelles explications divines, d’autant que ces dernières frustrent la vie naturelle, réduisent l’horizon de la pensée et angoissent continuellement celui qui craint les châtiments divins.
À l’inverse de ces connaissances abstraites et aliénantes, Lledó rappelle un des principaux leimotiv de l’épicurisme : « pour la plupart, les Hommes ne comprennent qu’avec leur corps » (p. 84). Même pour ceux qui croient en l’existence de l’âme, on voit bien qu’une entité de cet ordre est incapable d’agir seule dans le monde : toute connaissance et toute action réelle prennent leur fondement dans les sensations corporelles et dans les sens humains, selon Épicure ; c’est ce que Lledó appelle la « corporéité ». Face au caractère éphémère de la sensation, c’est la mémoire humaine individuelle qui produit de la continuité temporelle, et c’est le langage qui fait le lien entre chaque individu.
La sensation corporelle est également au fondement du plaisir, qui est une des formes les plus intenses de conscience de la temporalité et de la réalité. Le plaisir revêt aussi, dans cette perspective, une dimension morale : « on ne peut bien vivre sans vivre d’une façon sensée, belle et juste ; ni vivre d’une façon sensée, belle et juste sans bien vivre et d’une façon plaisante », synthétise Lledó (p. 115). La connaissance intellectuelle doit donc servir cette vie bonne et chercher ce qui lui est nécessaire. Sous cet aspect, l’épicurisme apparaît à l’auteur espagnol comme une « anthropologie de la nécessité », ou une quête du « bien vivre » selon une « politique du nécessaire » à ce bien vivre (p. 118). Le sens de la connaissance intellectuelle doit en effet être continuellement remis en question, pour conserver cette exigence de servir la vie humaine sans jamais se retourner en son opposé et devenir « une menace pour le corps et pour la vie » (p. 120).
La vie bonne, dans sa dimension collective, prend son sens lorsqu’elle est fondée sur l’amitié – la philia –, dégagée des traditions culturelles qui soumettaient celle-ci à un critère d’utilité. Dans une époque où la solidarité était fondamentale, Épicure voulait faire de la philia une fin en soi, basée non sur l’utilité mais sur l’éveil corporel et le plaisir comme ouvertures à autrui. Appelant de ses vœux une « communauté fraternelle », Épicure reste sceptique à l’égard des « sauveurs » de peuples qui exploitent l’égoïsme ainsi que la « culture de désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires », et qui mènent une politique consistant en une quête de pouvoir et de raison froide. La politique d’Épicure est donc « terrestre », dit Lledó ; elle part de l’aspect naturel de l’humain, du plaisir et de la connaissance par corps, et refuse les idées abstraites et idéologies qui viennent « flotter au-dessus de la réalité […] assombrissant la vie au lieu de l’éclaircir » (p. 138).
On peut s’en apercevoir au final, l’ouvrage présenté ici n’est pas un texte de présentation ou de vulgarisation de la pensée épicurienne. C’est un livre qui présente des échos de cette pensée sur différents thèmes importants. Si l’on peut avoir parfois l’impression d’une absence de fil conducteur, c’est que l’auteur est avant tout un connaisseur et un passionné de la philosophie épicurienne – non un simple commentateur ou théoricien. Ainsi, dans un style d’écriture fluide à l’esthétique travaillée, le livre de Lledó semble appliquer cette méthode épicurienne : mettre en lumière, à l’époque d’Épicure comme à l’époque actuelle, les implications directes et essentielles du savoir philosophique dans notre rapport au monde, à la vie, à la connaissance. Véritable invitation à la réflexion à partir de nos pratiques et de nos vécus – ou praxis, comme dit Lledó– plutôt que simple exposé savant, la vision que transmet l’auteur de l’épicurisme fait bien ressortir l’« élément révolutionnaire et émouvant » qui en constitue le cœur : « le corps humain, avec toutes ses limitations mais, en même temps, avec sa capacité de sentir et de penser, était l’unique fondement de la vie et la source exclusive de l’existence » (p. 142). C’est pourquoi l’épicurisme accorde tant de place à la joie, aux plaisirs individuels et partagés ainsi qu’au « bien-vivre » : ils sont les « indicateurs » du « bien-être », « élément d’équilibre et de liberté face à soi-même » (p. 143). En Grèce antique comme dans notre société, c’est donc une leçon que l’être donne à l’avoir.
