France, XIXème – XXème siècles : du travail au salariat
Histoire Sociologie et Anthropologie
19 Avr 2016
Imprimer
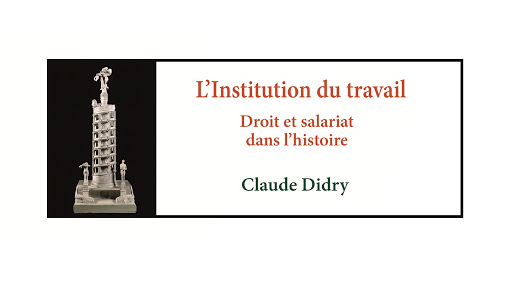
Note de lecture et podcast audio à propos de :
Claude Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute, coll. « Travail et salariat », 2016, 244 p.
Note de lecture diffusée sur le site Lectures
Le site de l’éditeur : la Dispute
Durée du podcast : 11 minutes
Fichier audio également disponible sur Bandcamp
Lecture audio intégrée :
Note de lecture :
Claude Didry, sociologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’IDHES-Cachan [1], développe depuis plusieurs années une sociologie historique du droit du travail, de l’innovation, du dialogue social et des restructurations d’entreprises. Avec le présent ouvrage, publié dans une collection animée par Bernard Friot, Claude Didry questionne la constitution de notre notion de « travail », à travers une sociologie historique des principaux dispositifs législatifs et juridiques qui l’ont instituée depuis la Révolution Française. Le livre est découpé en sept chapitres, qui prennent moins pour objet des séquences temporelles du XIXe et du XXe siècle que la mise en œuvre de principes et de catégories sociopolitiques et juridiques ayant eu une influence sur la construction de notre droit du travail actuel (le louage d’ouvrage et le marchandage, le contrat de travail, les classifications par branches et établissements, les « champions nationaux », les restructurations…).
Le livre de Claude Didry est donc d’une grande densité et d’une grande précision, fruit de longues recherches universitaires : c’est à la fois un gage de qualité, mais aussi un inconvénient. En effet, la compréhension de l’ouvrage nécessite quelques connaissances, non seulement en matière de droit du travail, de relations professionnelles et de leurs histoires respectives, mais aussi en histoire sociale, car Claude Didry n’ayant pas produit ici un livre d’histoire généraliste, il doit avoir recours à des ellipses temporelles pour conserver le fil conducteur de sa recherche. Le caractère universitaire du livre se retrouve aussi à travers la démarche, quelque peu iconoclaste, de l’auteur, qui s’en prend aussi bien à ce qu’il appelle « l’histoire sociale classique » (Robert Castel, Alain Cottereau notamment), qu’à des catégories devenues courantes, et qu’il cherche à dénaturaliser : « marché du travail », « emploi », « chômage », etc. Mais, comme il l’annonce en introduction, son travail de déconstruction historique voudrait surtout s’attaquer au « réformisme libéral » et à ses poncifs qui assimilent le travail (et son droit) à l’emploi, et cherchent à reconfigurer le premier en espérant améliorer le second.
Claude Didry commence donc par s’attaquer à l’idée reçue selon laquelle la Révolution française aurait été bourgeoise [2], et qu’en ce sens elle aurait amorcé les processus de subordination ouvrière et d’individualisme face au travail. Le « louage d’ouvrage », institué par la Révolution puis par l’Empire (à travers une série d’articles du Code Civil), témoigne d’une dynamique autrement plus complexe. Le « louage d’ouvrage » (d’où vient le terme « ouvrier ») admet en effet les ouvriers comme un groupe à la fois hétérogène, libre de travailler pour qui bon lui semble, et d’embaucher pour cela des subalternes (notamment des membres de la famille des ouvriers). En ce sens, la Révolution française et l’Empire font entrer le « monde ouvrier […] dans le droit commun des citoyens » (p. 31), en lui offrant une nouvelle « grammaire » juridique, qui répond en outre à certaines revendications ouvrières, comme la possibilité de prendre contrat librement avec des entrepreneurs et des subalternes. L’auteur prend pour cela l’exemple des Canuts lyonnais, qui représentent selon lui un « idéal-type du monde ouvrier » de l’époque.
Claude Didry estime par conséquent qu’au XIXe siècle ce n’est pas tant l’exploitation et la discipline en tant que phénomènes généraux qui questionnent le monde du travail, mais plutôt le « marchandage », sorte de dévoiement du « louage d’ouvrage », qu’on pourrait assimiler à notre actuel phénomène de sous-traitance. Le « marchandage » est condamné, surtout par des acteurs du mouvement ouvrier, des socialistes, des républicains, des catholiques sociaux, car il engendre une exploitation entre ouvriers mêmes, le travail des enfants et des femmes dans des conditions inadaptées, un brouillage de la lutte des classes… Il faudra attendre 1892 pour qu’une loi remette explicitement en cause ce phénomène.
À cette période, l’arrivée de députés socialistes, passés eux-mêmes par le monde du travail, engendre d’intenses réflexions pour tenter de renforcer les législations relatives au travail, de limiter les dérives telles que le marchandage et ses « violences morales », et d’établir la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des travailleurs. Les parlementaires commencent à songer à la publication d’un Code du Travail et s’organisent, dès les années 1890-1900, dans des commissions qui discutent les notions de contrat de travail, d’employeur, de convention collective… La réforme des Conseils de prud’hommes du milieu des années 1900 engendre elle aussi une réflexion sur les catégories de justiciables et d’électeurs : c’est à cette époque qu’on commence à parler de « salariés ».
Avec l’économie de guerre mise en place durant la Première guerre mondiale, et les mouvements contestataires qui suivent cette dernière [3], la puissance publique met en place des réformes qui constituent une « rationalisation » de la production, en vue de mieux en maîtriser les conditions ; ce qui entre de fait en contradiction avec beaucoup de politiques patronales. Claude Didry estime qu’on s’acheminait alors vers une « victoire du salariat », car les temps de travail réglementés ainsi que les droits et protections sociales instaurés dans les années 1910 amenèrent des discussions sur les « nomenclatures » professionnelles (donc les appartenances et conditions collectives) et sur les responsabilités des employeurs. Avec les législations républicaines, le travail commence, au début du XXe siècle, à apparaître comme une activité sociale spécifique, et les travailleurs comme appartenant à une « condition commune ».
Plus tard, cette notion moderne de travail s’affine à nouveau au cours de luttes sociales, et notamment celles qui culminent avec les grèves de mai 1936. Claude Didry rappelle d’abord que l’activité syndicale elle-même a contribué à ce processus [4], dans la mesure où les syndicats, pour se constituer, devaient travailler autour de notions, encore peu courantes à l’époque, telles que les « branches » ou « industries », ainsi que les « établissements ». C’est également des « avant-gardes » telles que les « midinettes » et les ouvriers de la métallurgie, qui suite à leurs mobilisations, obtiennent l’application de « contrats collectifs », qui impliquent de nouvelles réglementations de leur activité, et la classification des travailleurs pouvant en bénéficier. Lorsque les grèves s’élargissent et que les occupations d’usine se multiplient en 1936, beaucoup de travailleurs prennent conscience de leur appartenance à un même établissement. Leurs revendications de « contrôle ouvrier » font ainsi apparaître l’idée de « comités d’usine » [5], et mettent en débat les questions de démocratie et de représentation de tous les salariés dans l’établissement.
Parallèlement à l’émergence de cette conscience de l’établissement, se pose donc également la question de la « branche » ou « industrie », comme lieu tiers entre le travailleur et l’employeur. Ce sont les élus communistes de la Libération, ministres et députés, et surtout Ambroise Croizat, qui élaborent des catégories d’emploi pour consolider la notion de « branche » et établir des « accords de branche » de plus en plus larges. Ce travail sur la construction de catégories d’emploi engendre un processus de qualification du salarié, d’abord relatif au poste occupé et à l’établissement, en vue de fixer des salaires généraux. Les syndicats poseront assez vite la nécessité de rattacher cette qualification à la personne du travailleur et non plus à son activité, pour limiter les pertes en cas de rupture du contrat de travail.
Claude Didry souligne ensuite la « profonde ambiguïté de la politique gaulliste » (p. 140) qui, cherchant à tirer parti du Marché commun établi par les Accords de Rome en 1958, veut développer des « champions nationaux » sur le modèle américain, mais engendre ainsi un fort démarrage du chômage dans les années 1960, dû aux restructurations qui ont souvent lieu du fait des fusions-absorptions. Ce chômage, qu’on commence vite à qualifier de « structurel », devient une préoccupation des pouvoirs publics, qui prennent diverses dispositions au long des années 1960-1970 pour tenter de lutter contre celui-ci [6], ce qui tend en creux à faire évoluer les définitions des situations d’emploi et de chômage.
Les années 1980 à 2000 voient la mise en place d’un « marché du travail », pensé comme nouvelle solution pour réduire le chômage, alors que celui-ci a fortement augmenté. Certains acteurs, diagnostiquant la régression quantitative des emplois stables, promeuvent ainsi la nécessité d’une « flexicurité » qui pourrait fluidifier la mobilité professionnelle et « dédramatiser le chômage » (p. 164) [7]. Pourtant malgré les constats répétés de « fin du travail à vie » et de montée du « précariat », Claude Didry tient à rappeler, à travers des analyses statistiques, qu’une part considérable de la population active est salariée en CDI, avec plusieurs années d’ancienneté – ce qui montre selon lui que le travail demeure « une activité qui se déploie dans la durée […] » (p. 174).
Durant la seconde moitié du XXe siècle donc, les pouvoirs publics ont surtout été des « pompiers » face aux licenciements massifs engendrés par les « restructurations », et ce sont les représentants du personnel qui devaient mener la lutte juridique pour la « cause de l’emploi ». En défendant une multitude de salariés contre les directions, des « savoirs collectifs » se constituent, et les revendications et modes d’action se structurent [8]. Face à l’accentuation de la mondialisation, des délocalisations, de la concentration des directions d’entreprise, et la montée quantitative des licenciements individuels échafaudés par les directions pour contourner les entraves aux licenciements collectifs, les mobilisations sociales semblent rendues plus difficiles à mettre en œuvre. Nombre d’acteurs syndicaux et intellectuels réfléchissent alors à tenir davantage compte des désirs individuels des salariés et de leurs éventuels projets de mobilité professionnelle ; on cherche alors de plus en plus à « sécuriser les parcours » et à un garantir le statut des salariés pour minimiser les conséquences du chômage. Mais par ses impacts, la crise financière de 2008 contribue à déstabiliser cet équilibre émergent.
Dans le dernier chapitre, Claude Didry commence par revenir sur certaines de ses thèses, précisant tout d’abord que le travail en tant qu’idée n’a rien d’évident avant la société industrielle, et qu’il s’est constitué progressivement, notamment par le droit du travail. Cependant, rappelle-t-il, le contrat de travail ne pointe généralement pas très bien la figure de l’employeur, alors même que les responsabilités de celui-ci devraient être réaffirmées dans le contexte actuel de « financiarisation » du travail. Cette dernière fait en effet peser de lourdes pressions sur les emplois, sur l’efficacité des travailleurs (et sur leur santé), et, au final, sur la signification même du travail. L’auteur termine en pointant la fécondité du modèle allemand de « codétermination » des entreprises, qui, importé en France, conférerait davantage de pouvoir aux comités d’entreprise, et contribuerait à garantir ce qu’il appelle une « sécurité sociale industrielle » (p. 235). Ces dispositions permettraient de trouver des alternatives aux restructurations, et de reconstruire une « finalité du travail » dans laquelle les salariés subalternes pourraient refaire unité face à un employeur responsable.
Au final, un ouvrage d’une grande densité, très difficile à synthétiser, et par moments peu aisé d’accès du fait des connaissances de base qu’il serait nécessaire d’avoir en tant que lecteur pour mieux mesurer la portée et l’articulation des arguments développés par l’auteur. Cependant, les savoirs historiques et juridiques déployés par Claude Didry, à travers une analyse sociologique et sociopolitique très fine, permettent de mettre en perspective nombre de catégories qui sont les nôtres, dans une période où le travail et son droit font beaucoup parler d’eux. Un ouvrage riche, fourmillant d’analyses élaborées, qui devraient alimenter les débats pour un moment.
Notes :
[1] Voir sa page sur le site de l’ENS-Cachan : http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/haut-de-page/annuaire/didry-claude-65916.kjsp?RH=1189438478217
[2] Idée défendue notamment, depuis le XIXe siècle, par les courants marxistes. Voir par exemple Karl Kautsky, Les luttes de classe pendant la Révolution française, Demopolis, 2015
[3] Dont une des avant-gardes peut être trouvée chez les « midinettes », ces couturières à domicile travaillant pour les magasins textiles de luxe et la grande distribution dans des conditions assez précaires. Elles se mobilisent très tôt et obtiennent la promulgation de lois en 1915 et 1917 qui améliorent considérablement leurs droits et les font entrer « dans l’âge du salariat » (p. 92).
[4] Claude Didry pointe d’ailleurs une « homologie » intéressante entre la constitution, à la même époque, d’un Code du Travail et d’une Confédération Générale du Travail.
[5] Qui correspondraient à nos « comités d’entreprise » et « comités d’établissement » actuels.
[6] Mise en place de l’UNEDIC, des ASSEDIC, de l’ANPE, et d’institutions d’expertise statistique, de nouvelles réglementations sur le contrat de travail et les licenciements, entrée en jeu d’administrations publiques de terrain qui contrôlent les licenciements (notamment l’Inspection du Travail), tentatives d’« activation » de la politique d’emploi (à travers des exonérations de charges, par exemple)…
[7] « De là, un décalage croissant entre un monde politique qui ne voit dans les politiques de l’emploi que le sacrifice nécessairement impopulaire de garanties surannées, et un travail vécu par les salariés à travers les cadres juridiques qui leur permettent – malgré tout – d’en faire leur vie, d’y trouver une autonomie. De là, également, une grande absente, l’entreprise, qui peut se dédouaner à bon compte de ses responsabilités, pour se consacrer pleinement à la recherche exclusive de la rentabilité en s’abritant derrière les contraintes que lui impose la concurrence globale » (p. 165).
[8] Notamment grâce à l’action des comités d’entreprise, dont Claude Didry étudie dans un article les principaux registres d’argumentation : Didry, Claude, « Les comités d’entreprise face aux licenciements collectifs : trois registres d’argumentation », Revue française de sociologie, n°39-3, 1998, p. 495-534, accessible en ligne : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1998_num_39_3_4814
