Propriété, inégalités, hiérarchies… les contradictions du « contrat social » selon Rousseau
05 Mar 2023
Imprimer
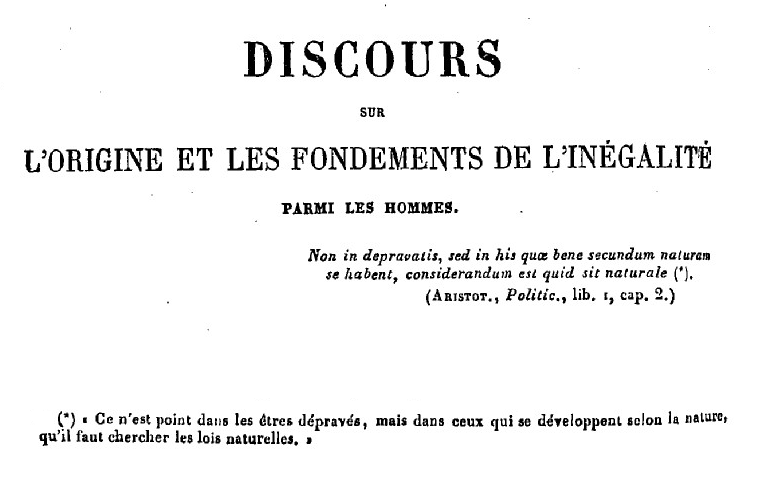
Note de lecture de :
Rousseau, J.-J., 1992, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Discours sur les sciences et les arts, Paris, GF Flammarion, présentation par Jacques Roger.
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) est l’un des plus célèbres auteurs français. Il se fait connaître par oeuvres littéraires : Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), Émile ou De l’éducation (1762), ou des oeuvres touchant davantage à la philosophie : Du contrat social (1762), l’article Economie politique de l’Encyclopédie (1755).
Dès sa jeunesse, il s’intéresse à la musique, et se fait remarquer après le texte qu’il a écrit à l’Académie de Dijon, Discours sur les sciences et les arts (1750). Après le succès de ce premier texte, il répond à nouveau à un concours de l’Académie de Dijon, c’est le fameux Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755).
Dans ce texte, Rousseau réfléchit sur l’origine historique et le développement des inégalités au sein des sociétés humaines, après leur sortie de « l’état de nature ». Selon lui, c’est avec la civilisation qu’apparaissent la propriété, la hiérarchie et les inégalités… Comme je le développerai ci-dessous.
La référence de l’édition que j’utilise est mentionnée ci-dessus. Le texte est librement accessible sur Wikisource (texte brut) mais aussi sur Gallica (livre scanné)
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
A la République de Genève
Dans cette dédicace à la République de Genève, où il a grandi, Rousseau énonce ce qui serait pour lui la patrie idéale : « j’aurai voulu vivre et mourir libre », là où peuple et souverain auraient un même intérêt, soit un « gouvernement démocratique ». Vivre libre selon Rousseau c’est-à-dire en étant soumis à de bonnes lois, comme le reste des citoyens (p.146), sans pour autant donner brusquement la liberté à ceux qui n’y sont pas habitués (p.147).
Il aurait voulu une patrie qui ne soit pas tentée par la conquête de ses voisins, et ne les craint pas non plus. « J’aurai cherché un pays où le droit de législation fût commun à tous les citoyens ; car qui peut mieux savoir qu’eux sous quelles conditions il leur convient de vivre ensemble dans une même société ? » (p.148). En même temps Rousseau estime qu’il faut de la « circonspection » dans la réforme : il n’approuve pas une démocratie directe et populaire (p.148-149), préférant une démocratie représentative « où la vertu des magistrats portant ainsi témoignage de la sagesse du peuple » (p.149)…
Il intime aux citoyens de n’être ni trop riches ni trop pauvres, de se méfier des importuns qui critiquent continuellement (p.152), il apprécie que les dirigeants de Genève soient de fervents chrétiens (p.154), et que les femmes ne gouvernent que dans les foyers (p.154-155).
En somme dans cette adresse à la République de Genève on retrouve un patriotisme (amour des siens), une préférence pour la démocratie représentative, pour la théologie chrétienne (il apprécie des dirigeants religieux) et une essentialisation des genres (les femmes ne sont bonnes que si elles sont chastes et gouvernent à la maison).
Préface
Rousseau estime que la connaissance de l’humain devient une science absolument nécessaire. En effet, la vie humaine est d’une diversité tellement immense selon les différents contextes, qu’on peut se demander si l’humain existe encore, c’est-à-dire s’il est toujours bien sensé de n’utiliser qu’un seul concept pour parler de cette variété de formes de vie…
Il commence en disant « la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l’homme », en citant un passage de l’Histoire Naturelle de De Buffon, où celui-ci postule qu’il nous est difficile de nous connaître nous-mêmes car nous ne sommes pas à l’écoute du « sens intérieur » qui nous en donnerait la connaissance (p.157). Connaître l’Homme est donc la première tâche, si l’on veut étudier l’inégalité et son origine, mais cela est très difficile car la nature humaine a été altérée, telle la statut de Glaucus, et il considère que c’est dans ces changements que réside le début des inégalités (p.158).
Ce qu’il y a de plus cruel, c’est que tous les progrès de l’espèce humaine l’éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d’acquérir la plus importante de toutes, et que c’est en un sens à force d’étudier l’homme que nous nous sommes mis hors d’état de le connaître
Rousseau, Discours sur l’inégalité… p.158
Il ne considère pas être sûr de lui et admet une marge d’erreur, voulant simplement « éclaircir » le problème, bien conscient qu’il va parler d’un état de nature « qui n’a peut-être point existé » et pour la connaissance duquel les expériences à réaliser sont encore inconnues, difficiles, incertaines (p.159). Ces expériences et « ces recherches » sont pourtant primordiales pour connaître les « fondements réels de la société humaine », et la nature de l’homme, à partir de laquelle il propose de constituer une « science » (p.160).
Il y a une variété de points de vue sur l’état de nature et ses lois, qui en rend la connaissance très difficile (p.160-161, il fait une sorte d’état de l’art) ; pourtant il faut s’efforcer de connaître l’homme naturel pour connaître « la loi qu’il a reçue ou celle qui convient le mieux » (p.161). Il propose donc de considérer, parmi toute la littérature, deux principes sur lesquels il semble y avoir accord, et antérieurs à la raison : la conservation de soi-même et la répugnance à voir tout être sensible souffrir (p.161-162), mais remarque-t-il, « De cette manière, on n’est point obligé de faire de l’homme un philosophe avant que d’en faire un homme » (p.162). Mais la répugnance à voir un être sensible souffrir implique que les animaux également participent au droit naturel et l’homme leur reconnaît certains droits (p.162).
Il termine en disant que lorsqu’on examine l’histoire humaine de façon un peu désinvolte on ne voit que chaos et hasard, « violence » et « oppression », mais, lorsqu’on arrive(ra ?) à mettre en place « l’étude sérieuse de l’homme » qu’il appelle de ses vœux, on parviendra à voir, sous le « sable » et la « poussière », « l’édifice » sur lequel est édifié le destin humain (p.163).
Question de l’Académie de Dijon : Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ?
Rousseau commence par repérer deux sortes d’inégalité : « naturelle ou physique », et « morale, ou politique », qui « dépend d’une sorte de convention » (p.167). Il propose de s’intéresser à la seconde (p.168), et commence par remarquer que les philosophes ont beaucoup spéculé sur l’état de nature, en vain – de façon même paradoxale, parfois, pour ceux qui croient en la Genèse (p.168). Il propose donc d’« écarter tous les faits » et de considérer la réflexion comme faite de « raisonnements hypothétiques et conditionnels », de « conjectures » (p.169).
Première partie
Dans cette première partie du Discours, Rousseau évoque l’état de nature chez l’humain (la différence entre l’humain et l’animal…), l’apparition du langage, et la sortie de cet état de nature.
La nature était bien partie …
Il cherche d’abord à montrer que l’homme est avant tout un bipède (p.170-171), ne spéculera plus au sujet de l’évolution anatomique de l’homme et le supposera le même de tous temps, car l’anatomie comparée n’a pas fait assez de progrès pour établir des données fiables (p.172). Il avance quelques spéculations sur l’impact de l’écosystème (p.173) l’alimentation et la sélection naturelle (p.174), constatant qu’à Sparte ou chez les sauvages le corps est un instrument dont nous autres modernes avons perdu l’usage, ce qui fait que nous sommes moins robustes (p.174-175), comme en attestent les récents récits de voyageurs (note p.175). En revanche, Rousseau contredit Hobbes et considère le sauvage comme timide et craintif (p.176), et en équilibre de force avec son environnement, avec lequel il vit donc en paix (p.177).
Rousseau estime que « la plupart de nos maux sont notre propre ouvrage », c’est-à-dire que c’est la vie culturelle qui nous a séparés de la simplicité naturelle, en nous accablant d’oisiveté ou de travail, de mauvais aliments, « les excès de toute espèce », des passions… (p.179). En effet les sauvages n’avaient visiblement pas une plus mauvaise santé, mais, pour autant, n’avaient pas de médecins (p.180). Hommes et animaux, en sortant de l’état sauvage, deviennent mous et fragiles (p.181).
Si elle [la nature] nous a destinés à être sains, j’ose presque assurer que l’état de réflexion est un état contre nature, et que l’homme qui médite est un animal dépravé
Rousseau, Discours sur l’inégalité… p.180
L’humain est naturellement bon, et socialement corrompu
D’un point de vue « métaphysique et moral », maintenant, l’homme ressemble à l’animal en ce qu’ils sont une « machine ingénieuse » dotée de sens, mais ils diffèrent en ce que l’homme a le libre-arbitre en plus (p.182) : il y a une base physique commune, mais l’homme a « la conscience de cette liberté » en plus que l’animal, conscience qui ne trouve pas d’explication « mécanique » (p.183). La faculté de se perfectionner est une autre différence notable (p.183), mais peut apparaître, dans une certaine mesure, comme la source des maux humains, car l’homme par elle déploie d’immenses efforts pour peu de résultats (p.184). Dans une longue note (p.184-189), Rousseau explique ainsi que l’homme est naturellement bon mais socialement méchant, notamment parce qu’il cherche continuellement à profiter d’autrui (p.184-185). Tous les malheurs qu’on connaît sont le prix infligé par la nature au « mépris que nous avons fait de ses leçons » (p.186). Il y a ainsi de nombreux métiers qui avilissent l’espèce (ouvrier, mineur), tandis que d’une part le luxe « achève » de corrompre la société et que d’autre part les métiers indispensables, tel agriculteur, sont négligés, et que l’agriculteur doit abandonner son champ et aller travailler dans l’industrie (p.187).
Les arts et les sciences nous ont considérablement affaiblis face aux barbares, au point qu’il se demande s’ils n’ont pas été inventés « comme une peste salutaire » pour limiter la prolifération d’humains, bientôt trop nombreux pour notre planète… Pour autant il se moque de ceux qui proposent de retourner vivre dans les bois (p.188), car il explique que son idéal de citoyenneté ne se passe ni de loi, ni de princes, ni de civilisation (p.189).
Difficile de saisir les frontières entre humain et animal
Reprenant le cours de sa réflexion, il fait observer dans une nouvelle note que si l’on avait pu observer les peuples anciens, on aurait vu des différences dans « la figure et l’habitude du corps » lui-même, c’est-à-dire que le corps est socialisé (p.189). Il émet alors quelques hypothèses sur les types physiques, et se demande si les animaux anthropomorphes (type orang-outang), ne peuvent pas être considérés comme des hommes, d’après les récits de voyageurs (p.190-191), qu’il critique pour leur anthropo-ethno-centrisme (p.191-192). Il se questionne sur les intentions et le sens des actions de ces animaux (p.192), difficiles à saisir car les récits de voyageurs européens sont saturés de préjugés (p.193). Il ne comprend donc pas pourquoi les hommes ne partent pas eux-mêmes s’instruire, et aimerait que, plutôt que « des Européens plus curieux de remplir leurs bourses que leurs têtes », des grands savants aient l’opportunité de parcourir le monde pour nous instruire (p.194).
Spéculations sur l’apparition des langues
Revenant à la discussion principale, il avance quelques spéculations sur les déterminismes géographiques, le rapport passif du sauvage à l’environnement, et les avancées principales – maîtrise du feu et agriculture – qui apparaissent très progressivement (p.196-197). Il contredit ensuite les essentialistes qui refusent l’évolution : tout est impossible sans langage et sans société (p.198), et il appuie son idée en examinant l’origine des langues, de façon spéculative (p.199), en rapportant cela à la forme de la famille sauvage (p.199-202, autour d’idées de Locke). Les langues ne viennent pas de la forme familiale, pour diverses raisons (p.203 et avant). Il préfère considérer que l’apparition de la langue est accidentelle, n’a pas été une nécessité (p.204), et que le premier langage a été le « cri de la nature », ensuite perfectionné dans sa forme vocale et dans ses significations (les mots de la langue sauvage devaient avoir des significations très étendues) (p.205-206).
Au bout d’un moment, « plus les connaissances étaient bornées, et plus le dictionnaire devint étendu », les connaissances et le vocabulaire (ou « nomenclature ») progressant ensemble, car pour nommer il faut connaître (p.206). Inversement, « toute idée générale est purement intellectuelle », et saisie par des mots : les représentations, l’imagination (ou les sensations ?) ne saisissent que des formes très particulières (p.206-207). S’en sont suivis des efforts pour affiner et réduire le langage, qui ont débouché sur les catégories métaphysiques, probablement inaccessibles au départ (p.207-208), et sur l’invention des nombres (note p.208). Il se dit finalement « convaincu de l’impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s’établir par des moyens purement humains » (p.208-209) : est-ce à dire qu’il pense à des moyens divins ? Ou des causes totalement accidentelles et indépendantes ? En tout cas la nature ne semble pas avoir aidé à la constitution des langues (p.209).
Les civilisés ne sont pas forcément plus vertueux que les sauvages…
Il contredit ensuite l’idée que la vie sauvage était « misérable », faisant remarquer que seuls les civilisés se plaignent, trouvent leur vie « insupportable », voire se suicident, ce qui a priori n’est pas le cas des sauvages… « Qu’on en juge donc avec moins d’orgueil de quel côté est la véritable misère » (p.209). Les sauvages avaient ce qu’il fallait pour vivre dans la nature, et ne pouvaient donc être « ni bons ni méchants » ; tandis qu’on peut se demander si les civilisés sont vraiment plus vertueux, « si le progrès de leurs connaissances est un dédommagement suffisant des maux qu’ils se font mutuellement […] » (p.210), puis il contredit à nouveau Hobbes (p.210-211), qui n’a pas pris en compte le principe de pitié (p.212). Il explique dans une note la différence entre « amour de soi-même », sorte d’autoconservation à l’origine de « l’humanité et la vertu » ; et « amour propre », sorte d’égocentrisme à l’origine de divers maux (note p.212). Il fait ensuite remarquer que les animaux cherchent à préserver les leurs, et que, même nos mœurs « dépravées » ont du mal à venir à bout de la « pitié naturelle », sans laquelle, comme le pressent Mandeville, les hommes n’auraient été que des « monstres » (p.213). C’est d’ailleurs la raison et l’amour-propre qui ruinent la « commisération » et « l’identification » de l’homme à son semblable : « il n’y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe, et qui l’arrachent de son lit […] » (p.214).
La « pitié naturelle » est antérieure à la raison
Il revient donc sur la « pitié », qui amène chacun à modérer son amour-propre et concourt donc à la « conservation mutuelle de toute l’espèce » (p.214). L’humanité ne se préserve donc pas que par la raison, mais aussi par des principes antérieurs : « Quoiqu’il puisse appartenir à Socrate, et aux esprits de sa trempe, d’acquérir de la vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain ne serait plus, si sa conservation n’eût dépendu que des raisonnements de ceux qui le composent » (p.215). Les conflits eux-mêmes, considère Rousseau, étaient peu nombreux et peu impressionnants dans l’état sauvage (p.215), du moins jusqu’à l’apparition de l’amour (p.215-216). Il examine donc les deux dimensions de l’amour : physique et morale (p.216), et estime que s’il n’y avait pas la dimension morale, il n’y aurait aucun problème (p.216) ; c’est dans l’état social que l’amour devient problématique, et les sauvages ne s’égorgeaient certainement pas pour cette raison (p.217). Il échafaude un raisonnement (d’ordre démographique) pour suggérer que les humains ne devraient pas être portés aux conflits à cause de l’amour (p.217-218), et estime que, quand bien même ça arrive, dans la civilisation ça fait beaucoup plus de ravage que dans n’importe quel autre espèce ou état (p.218 : jalousie, vengeance, débauche, avortements…).
Le mythe du bon sauvage…
Il commence à conclure cette partie en rappelant que l’homme sauvage vivait en accord avec la nature, et que lui a surtout cherché dans ces lignes à détruire les préjugés sur l’état de nature (p.218-219) : « Il est aisé de voir qu’entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs passent pour naturelles qui sont uniquement l’ouvrage de l’habitude et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société » (p.219). C’est la civilisation elle-même qui instaure, d’ailleurs, bon nombre de différences : dans l’état de nature tout est plus uniforme (p.219), il n’y a ni servitude ni domination (contrairement à notre société) simplement car les sauvages ignorent de quoi il s’agit : « Quelles pourront être les chaînes de la dépendance parmi des hommes qui ne possèdent rien ? » (p.220), en effet « il est impossible d’asservir un homme sans l’avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d’un autre » (p.220). Le développement des hommes s’est donc réalisé à travers plusieurs causes accidentelles, fortuites (p.220-221), et Rousseau propose maintenant d’examiner, par conjectures, comment l’homme est devenu un être de culture.
Seconde partie
Dans cette partie, Rousseau propose une analyse de l’émergence de la civilisation, avec son cortège de hiérarchies, de propriétés et d’inégalités.
Il réaffirme que c’est la propriété qui est au fondement de la société, et dit qu’il va chercher les fondements de ces instances (p.222). Il remarque que l’homme développe des « industries », des techniques pour affronter la nature, a découvert le feu, a fait progressivement preuve de « réflexion » (p.223), a dompté les animaux, et a commencé à établir des rapports à autrui à travers des associations éphémères (p.224), pour lesquelles il n’y avait pas besoin de langage perfectionné (p.225). Petit à petit les groupements se sédentarisent, des familles apparaissent, ainsi que l’amour conjugal, la répartition genrée du travail (p.225-226). Cependant les « commodités » et avancées techniques deviennent des « besoins », qui asservirent l’homme, souffrant de leur privation bien plus qu’il n’appréciait leur possession (p.226-227). Ainsi, les hommes rassemblés développent des langages et des formes sédentaires, unis par des « mœurs », un « genre de vie et d’aliments, et par l’influence commune du climat » (p.227).
Les idées spirituelles et esthétiques se développent alors, et « chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime publique eut un prix », chacun cherche de la « considération » et la « civilité » devient un devoir (p.228). C’est précisément cette vision des sauvages déjà déchirés par l’amour-propre qui biaise la vision qu’en ont les observateurs (p.229). Alors, « il fallait que les punitions devinssent plus sévères à mesure que les occasions d’offenser devenaient plus fréquentes ». Cet état primitif est idéalisé par Rousseau notamment parce qu’il était « moins sujet aux révolutions » (p.229), et suggère dans la note de bas de page que la difficulté à civiliser les sauvages montre qu’ils sont satisfaits de leur mode de vie, et non malheureux (p.229-231).
tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l’individu, et en effet vers la décrépitude de l’espèce
Rousseau, Discours sur l’inégalité…, p.231
Lorsque l’interdépendance des hommes leur apparaît, la propriété et le travail apparurent, de même que « l’esclavage et la misère ». C’est ensuite notamment par « le fer et le blé » que la civilisation émerge (p.232-233), et, à travers l’agriculture, par la propriété, le partage de la terre (p.234). L’égalité naturelle est donc ainsi rompue (p.234), et les facultés humaines décuplent ; « il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu’on était en effet. Etre et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes », les hommes se pensèrent comme dépendants de la nature et d’autrui (p.235).
La civilisation émerge quand chacun renonce à un peu de liberté pour s’intégrer au pacte social…
Ambition, avidité, jalousie envahirent la société, qui se divisa en riches et pauvres, les premiers cherchant à conserver leurs richesses et dominer les seconds (p.236), et un état de guerre de tous contre tous s’installa (p.236-237). Rousseau observe en outre dans la note de base page que c’est par inertie que les hommes ne se pensent que comme interdépendants et nécessairement soumis à un « joug » (p.237). Les riches ont alors craint que la situation ne dégénère, et, ayant tout à perdre, ont décidé de se prémunir en utilisant la force des autres (p.238) : tout le monde est d’accord pour s’associer et préserver les richesses de chacun : « tous coururent au-devant de leurs fers croyants assurer leur liberté », même les sages se résolurent à abandonner un peu de liberté, « comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps ». C’est probablement ainsi que les lois ont vu le jour, selon Rousseau, qui « pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère » (p.239). Enfin, les sociétés s’organisent alors entre elles selon un droit civil, à l’interne, un contrat social et, réciproquement, à l’égard l’une de l’autre, selon un droit naturel, qui n’a pas duré longtemps, car les guerres sont apparues : « les plus honnêtes gens apprirent à compter parmi leurs devoirs celui d’égorger leurs semblables […] Tels sont les premiers effets qu’on entrevoit de la division du genre humain en différentes sociétés » (p.240). Il complète sa théorie de la genèse de la société avec quelques données, notamment l’idée que « les pauvres n’ayant rien à perdre que leur liberté, c’eût été une grande folie à eux de s’ôter volontairement le seul bien qui leur restait pour ne rien gagner en échange » (p.241).
Progressivement le gouvernement se perfectionne et certains concentrent le pouvoir (p.242), ce qui est une perversion car les peuples, à la base, se dotent de chefs « pour défendre leur liberté et non pour les asservir ». Les hommes politiques cependant font des « sophismes » pour justifier la servitude alors que ce n’est pas l’état naturel de l’homme, et que nombre de sauvages font de grands efforts pour s’en préserver :
ce n’est donc pas par l’avilissement des peuples asservis qu’il faut juger des dispositions naturelles de l’homme pour ou contre la servitude, mais par les prodiges qu’ont faits tous les peuples libres pour se garantir de l’oppression
Rousseau, Discours sur l’inégalité, p.243
Ainsi, ce n’est pas sur les civilisés qu’il faut baser les observations sur la liberté, mais sur les efforts périlleux des sauvages pour se préserver de la civilisation et de la colonisation, de sorte que « ce n’est pas à des esclaves qu’il appartient de raisonner de liberté » (p.244). Le pouvoir politique ne dérive donc pas du pouvoir paternel, qui est doux dans l’état de nature (p.244). Cela l’amène à se demander comment on peut aliéner sans risque une partie de sa liberté pour le bien commun (p.245), car on ne peut renoncer à la vie, donc à la liberté, ce qui est contre-nature, comme, au passage, l’esclavage (p.246).
Les contradictions du contrat social…
Rousseau en vient donc à proposer une définition idéale du « pacte » ou « contrat » fondateur de la société (p.246) : le peuple délèguerait à des chefs et des magistrats (p.246-247). Les magistrats, les lois et l’Etat recouvrent la liberté naturelle, le problème étant surtout qu’il n’y a pas de pouvoir extérieur à ce contrat social et les contractants sont donc juges et parties (p.247) : « le peuple, qui paye toutes les fautes des chefs, devrait avoir le droit de renoncer à la dépendance », mais pour se renforcer, le pouvoir s’est réclamé du droit divin (p.248). Les luttes politiques par la suite sèment la discorde. Rousseau propose une petite synthèse de l’émergence de l’inégalité p.249 : 1) la loi et la propriété établissent des riches et des pauvres 2) la magistrature institue des puissants et des faibles 3) le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire institue des maîtres et des esclaves, « dernier degré de l’inégalité » ; cela jusqu’à ce que de nouvelles « révolutions » s’attaquent au gouvernement pour le dissoudre ou le rapproche « de l’institution légitime ».
Il note ensuite que « les vices qui rendent nécessaires les institutions sociales sont les mêmes qui en rendent l’abus inévitable », c’est-à-dire que si tout suivait toujours les règles établies, celles-ci deviendraient inutiles. L’inégalité se répand alors au fur et à mesure que les hommes sont enrôlés dans les lois de ces institutions (p.250, voir fiche citation), qu’ils se rassemblent et se comparent entre eux (p.251). Cette inégalité recoupe un des quatre types repérés par Rousseau (richesse, noblesse ou rang, puissance, mérite personnel, p.252), et tient à la « fureur de se distinguer » qui anime les hommes, produisant le meilleur et le pire, et notamment ceci que « Si l’on voit une poignée de puissants et de riches au faîte des grandeurs et de la fortune, tandis que la foule rampe dans l’obscurité et dans la misère, c’est que les premiers n’estiment les choses dont ils jouissent qu’autant que les autres en sont privés, et que, sans changer d’état, ils cesseraient d’être heureux, si le peuple cessait d’être misérable » (p.252).
Rousseau fait remarquer qu’il faudrait un livre entier pour montrer l’évolution historique de l’inégalité et ses conséquences : « on verrait les défenseurs de la patrie en devenir tôt ou tard les ennemis, tenir sans cesse le poignard levé sur leurs concitoyens » (p.253), d’une part, et d’autre part, « on verrait fomenter par les chefs tout ce qui peut affaiblir des hommes rassemblés en les désunissant ; tout ce qui peut donner à la société un air de concorde apparente et y semer un germe de division réelle ; tout ce qui peut inspirer aux différents ordres une défiance et une haine mutuelle par l’opposition de leurs droits et de leurs intérêts, et fortifier le pouvoir qui les contient tous » (p.253). Le despotisme remplacerait alors bientôt la république, et ce serait « le dernier terme de l’inégalité » ; sous cet état de loi du plus fort, la révolte serait tout à fait justifiée (p.254). Il approuve ceux qui, comme Diogène, estiment qu’il n’y a plus d’homme, tellement l’homme a évolué et changé ; et en effet, tout oppose le sauvage et le civilisé : « le citoyen toujours actif sue, s’agite, se tourmente sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la mort, il y court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l’immortalité » (p.255), plus encore : « l’homme sociable toujours hors de lui ne fait vivre que dans l’opinion des autres, et c’est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le sentiment de sa propre existence », car pour les civilisés tout n’est qu’apparence et « plaisir sans bonheur » (p.256).
