Une analyse marxiste de la Révolution française
05 Mai 2015
Imprimer
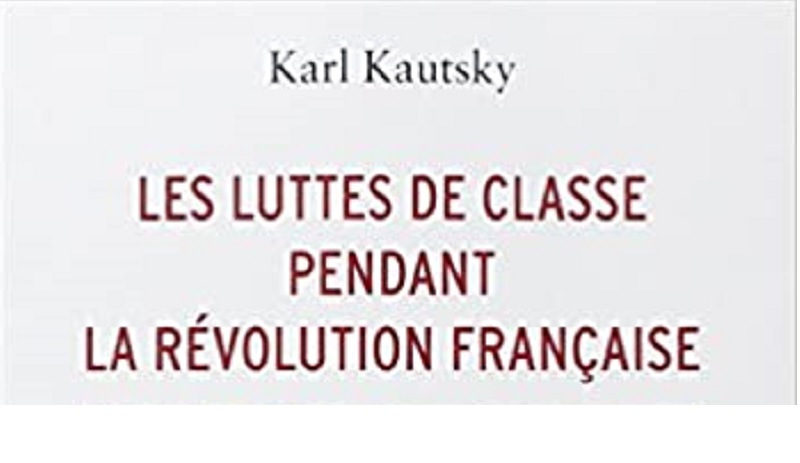
Note de lecture de :
Karl Kautsky, Les luttes de classe pendant la Révolution française, Demopolis, 2015, 131 p., traduit de l’allemand par Jacques Hebenstreit.
Disponible sur le site Lectures
« Karl Kautsky est le plus grand intellectuel marxiste de sa génération » clame la préface de l’ouvrage (p. 3). Celui-ci, né en 1854, rencontre Marx et Engels dans les années 1880, avant de s’installer à Londres pour devenir le secrétaire du second. En 1889, à l’occasion du centenaire de la Révolution française, Kautsky publie une brochure sur le sujet [1], qui est aujourd’hui éditée par Demopolis.
Dans cet ouvrage, l’auteur étudie le contexte social et politique qui précède la Révolution française, cherchant à montrer que c’est la lutte des classes dans l’Ancien Régime et l’émergence du mode de production capitaliste qui expliquent les événements de 1789. Pour cela, il étudie les principales forces sociales en présence, à savoir les classes sociales d’Ancien Régime et leurs recompositions, pour mettre en lumière les antagonismes qui les traversent, remontant parfois très loin dans le temps le fil des dynamiques sociales qui sont en jeu à l’époque.
La préface, très pédagogique, après avoir proposé un point biographique sur l’intellectuel marxiste, explicite deux éléments clés de sa pensée : l’émergence de la notion de « lutte des classes » [2], et la méthode « dialectique » mise en place par Kautsky, inspirée de Hegel et Engels. La préface se consacre en outre largement à dresser une analogie entre la situation qui a précédé la Révolution française et la situation actuelle qui, suite à la crise financière de 2008, tend à exacerber les antagonismes sociaux[3]. Comme à la fin du XVIIIe siècle, alors que les groupes dominants se déchirent, « l’entrée en scène, imprévisible, des classes populaires sera déterminante » (p. 19).
Dans son introduction, Kautsky expose son questionnement et son projet. Il suggère que l’écart entre les idéaux des artisans et partisans de la Révolution française, et le résultat qui est advenu en pratique, reste incompréhensible si l’on n’adopte pas une conception particulière de l’histoire : la « conception matérialiste ». Cette approche, que Kautsky considère comme déjà fort répandue à l’époque, consiste à étudier moins la « volonté des humains » que les « circonstances » et les contingences qui contrarient ou déterminent les actions individuelles. Pour Kautsky, ces « circonstances » consistent fondamentalement en une dynamique de lutte des classes. Aux yeux de l’intellectuel marxiste, l’enjeu « consiste moins aujourd’hui à défendre [cette conception matérialiste] qu’à l’empêcher de tomber dans la platitude » (p. 24). Il faut à tout prix éviter de réduire cette approche à une vision binaire et simpliste de l’histoire de la société, comme s’il n’y avait toujours que « deux masses solides et homogènes » (bourgeois et prolétaires) : « si c’était effectivement le cas, l’écriture de l’histoire serait une tâche assez facile » (p. 24). C’est donc à travers une forme critique et exigeante du matérialisme historique que Kautsky propose d’analyser les prémisses de la Révolution française.
On peut diviser l’ouvrage en deux grandes parties : la première rassemble les quatre chapitres qui concernent les antagonismes propres aux groupes sociaux dominants (monarchie, aristocratie, clergé, administrations d’État). La seconde est constituée des quatre chapitres qui se centrent sur les divisions internes au Tiers-État (bourgeoisie, intellectuels, sans-culottes, paysans). L’ouvrage s’achève sur une ouverture concernant la contre-révolution européenne et esquisse quelques perspectives explicatives concernant l’avènement de l’empire napoléonien.
La première partie débute par un point sur l’évolution du pouvoir d’État depuis le XVIIe siècle. « La forme de l’État » a en effet, aux yeux de Kautsky, une influence déterminante sur « les formes de la lutte des classes » (p. 25). Il importe donc de constater, pour commencer, que la monarchie absolue a impliqué, aux XVIIe et XVIIIe siècles, un développement important de l’appareil d’État, à travers une bureaucratie et une armée royale en pleine expansion. Pour soutenir ce développement, la royauté a dû s’adjoindre d’une part le soutien symbolique des aristocrates, qui étaient ses principaux concurrents dans la course au pouvoir politique, et d’autre part le soutien financier des grands « bourgeois industrieux ». Cette situation engendre des difficultés [4] et s’appuie sur un équilibre très précaire entre les groupes aristocratiques et bourgeois : pour Kautsky, il suffisait qu’un roi doté d’un « caractère faible » arrive au pouvoir pour que la situation dégénère : c’est ce qui s’est passé avec Louis XVI.
Depuis un moment, le clergé et la royauté réservent donc de nombreux postes très généreusement rémunérés aux grands aristocrates, dans l’Église, l’armée, l’administration de l’État, la cour… Une grande partie de la bourgeoisie et de la petite aristocratie féodale et rurale est indignée de l’avidité des grands nobles, entretenus par les finances publiques. Dans l’Armée ou l’Église, de nombreux sous-officiers et subalternes recrutés dans le Tiers-État se retourneront contre leurs supérieurs, et Kautsky de donner l’exemple hautement significatif, au début des États généraux de 1789, du moment où il a fallu décider si les votes se feraient par ordre ou par tête [5].
Une aristocratie de fonctionnaires a progressivement vu le jour depuis le XVe siècle, et parmi eux, les juristes sont devenus des métiers stratégiques. Les Parlements se sont alors placés « à la pointe » de l’aristocratie dite de robe [6]. Avec l’hérédité de certaines charges, les parlementaires deviennent à leur tour des privilégiés, adoptant donc des positions réactionnaires de défense de leurs privilèges. Cependant, observe Kautsky, en quelques occasions, les Parlements doivent, pour faire valoir une décision, s’appuyer sur l’opinion publique contre la royauté ou la noblesse, et sont ainsi amenés à soutenir certains mots d’ordre du Tiers-État [7]. En effet, les diverses fractions des groupes sociaux dominants [8] se livrent à des luttes intestines au cours desquelles il leur arrive d’enrôler le peuple pour des causes diverses. L’auteur rappelle alors l’exaspération des aristocrates face aux politiques de redressement mises en place par les ministres Turgot puis Calonne, ce dernier étant démis de ses fonctions en 1787 [9]. Au comble du mécontentement, les aristocrates exigent paradoxalement la convocation des États généraux : « aveuglés par leur colère, les privilégiés se retrouvèrent sur le terrain révolutionnaire » (p. 58). C’est à ce moment qu’entre en jeu le Tiers-État.
Kautsky commence par constater à ce sujet que « le tiers état était aussi divisé que les deux autres ordres » (p. 61), l’auteur refusant en effet de considérer le prolétariat comme un « quatrième ordre ». Kautsky s’attèle donc dans un premier temps à présenter les scissions qui se déploient à l’intérieur de la bourgeoisie, ou « classe des capitalistes ». Celle-ci est fondamentalement divisée entre, d’un côté, ceux qui tirent profit du système des privilèges et de la dette publique contractée par l’Ancien Régime : haute finance, manufactures de luxe, etc. ; d’un autre côté, ceux qui cherchent à dépasser les restes du féodalisme, et aspirent à ce qu’on pourrait appeler une libéralisation de l’économie, encore entravée par les taxes et règlements féodaux : commerçants, entrepreneurs industriels…
En second lieu, Kautsky examine l’émergence et le rôle du groupe des « intellectuels ». Dans l’Ancien Régime, artistes et philosophes sont d’abord très dépendants du mécénat aristocratique, dont ils défendent les intérêts et divertissements. Avec la diffusion des livres et l’émergence du journalisme, les intellectuels s’émancipent de l’aristocratie et se rapprochent culturellement et matériellement de la classe bourgeoise. Ils veulent dépasser le système féodal de domination et assimilent la libéralisation de l’économie à une émancipation collective. Raison pour laquelle, selon Kautsky, on peut considérer que les intellectuels du XVIIIe siècle, et dans une large mesure les Lumières, défendaient les intérêts de la classe bourgeoise [10]. Après la chute de l’aristocratie et de certains de ses satellites bourgeois, c’est donc « la classe des intellectuels bourgeois » (p. 79) qui reste seule capable de gouverner. Mais la bourgeoisie n’a pas fait la Révolution seule, bien que celle-ci soit son « œuvre » : c’est bien « le peuple » qui a pris les initiatives, et a mené les luttes concrètes [11]. D’où l’intérêt d’observer de plus près comment se composaient ces classes populaires au moment de la Révolution.
Kautsky explique que, concernant les « sans-culottes » vivant dans les villes, les diverses composantes du groupe [12] développent une rancœur croissante à l’égard des dominants. Pour tenter de calmer le mécontentement, la royauté a libéré certains quartiers des règlements corporatistes et féodaux pour laisser plus de liberté aux travailleurs. C’est précisément dans ces « faubourgs » que va se concentrer progressivement toute une masse populaire qui deviendra révolutionnaire en 1789 [13], bien que Kautsky avertisse que ces groupes populaires ne doivent pas être assimilés au prolétariat moderne basé sur la conscience de classe. Quoiqu’il en soit, ce sont ces « sans-culottes » qui, en défendant la Révolution dans la rue, armes à la main, « ont donné le signal de la révolte des paysans dans tout le pays » (p. 88).
La paysannerie, en effet, accablée par les règlements, impôts et préséances de l’Ancien Régime, se joignait déjà massivement au prolétariat urbain pour tenter de trouver du travail. Depuis longtemps dans l’attente d’un événement déclencheur qui annoncerait la fin de la domination féodale, les paysans se lèvent partout avec enthousiasme pour soutenir la Révolution – c’est-à-dire, souligne Kautsky, que la paysannerie, dans son écrasante majorité, se fait révolutionnaire moins par adhésion aux idéaux républicains que par opposition à l’ancien système qui la désavantageait largement. L’auteur met en outre en lumière la fonction sociale clé de l’armée révolutionnaire, qui fournit travail, gloire et revenus à de nombreux hommes autrement désœuvrés. Kautsky explique par-là le soutien de la paysannerie à Napoléon lorsque celui-ci fera figure de rempart face à la contre-révolution européenne.
Le dernier chapitre de l’ouvrage met d’abord l’accent sur les enjeux importants présentés par les partages successifs de la Pologne entre les grandes puissances voisines. Les rivalités entre les grandes monarchies européennes au sujet de la conquête de nouveaux territoires semblent dépassées lorsque la Révolution française fait l’unanimité comme ennemi commun. Heureusement, d’après Kautsky, la coalition monarchiste européenne s’avère indécrottablement cupide et a beaucoup de difficultés à s’unir efficacement, dès que des enjeux matériels apparaissent (partage des butins pillés et des territoires français et polonais notamment). L’armée révolutionnaire française a donc une marge de manœuvre importante, qu’elle utilisera pour écraser ses adversaires. Kautsky insiste, dans les dernières pages de son livre, sur le fait que c’est bien la décadence morale et intellectuelle de la noblesse européenne, ainsi que les luttes engagées entre les diverses classes, qui sont les moteurs de l’évolution sociale.
Au total, on a affaire à une analyse tenant d’un marxisme assez classique mais qui, au vu de l’impressionnante somme de connaissances déployées, peut paraître relativement sophistiquée. En prenant le contre-pied d’une histoire sensationnaliste basée sur quelques événements ou quelques personnalités, Kautsky réinscrit la Révolution française dans une perspective de long terme, et donne une lecture plutôt originale de la période, car dépassionnée et détachée. Cet aspect froid et méthodique de l’analyse peut être salué comme un effort de scientificité, à une époque où les sciences sociales pouvaient encore revêtir de fortes teneurs spéculatives, morales ou partisanes. Preuve en est que sous certaines conditions épistémologiques, le marxisme peut rejoindre de fécondes intuitions scientifiques, comme en témoigne la rigueur empirique et la créativité sociologique et historienne de Kautsky.
Notes de bas de page :
[1] Destinée à « des militants marxistes lecteurs de Die neue Zeit » (p. 7), la revue qu’il a fondée en Allemagne et qui était devenue l’un des principaux organes de presse du mouvement ouvrier.
[2] Que Marx n’a pas inventée et qu’il a piochée chez des « historiens libéraux » du début du XIXe siècle (Augustin Thierry, François Guizot, Adolphe Thiers, François-Auguste Mignet…) pour ensuite l’enrichir. Voir à ce sujet la lettre de Marx du 5 mars 1852, écrite à Joseph Weydemeyer.
[3] Aux yeux du préfacier en effet, la « classe capitaliste » dominante se scinde actuellement entre les libéraux, qui tirent grand profit de la mondialisation, et une frange de petits capitalistes qui, du fait de sa fragilisation, cède de plus en plus aux sirènes du nationalisme : « ils sont la cible privilégiée de l’agitation et de la propagande du Front National : petits patrons, petits commerçants, artisans, notaires, pharmaciens, médecins, avocats » (p. 15).
[4] Par exemple, le pouvoir étatique ne prête attention aux classes populaires que pour s’assurer qu’elles paient leurs impôts et ne troublent pas la croissance économique, commerciale et agricole.
[5] Le vote par ordre aurait avantagé les deux ordres dominants (noblesse et clergé), tandis que le vote par tête aurait avantagé le Tiers-État, qui comptait un nombre de représentants deux fois supérieur à ceux des deux autres ordres. Ce sont la majorité des deux cent huit curés présents qui, en faisant défection aux supérieurs cléricaux et aux nobles, ont fait peser la décision en faveur du vote par tête. Ces curés étaient majoritairement recrutés dans le Tiers-État.
[6] L’aristocratie de robe regroupe les bourgeois qui achètent leurs titres de noblesse.
[7] En 1648 durant la Fronde, tout comme dans les années 1780.
[8] Noblesse de robe, courtisans, officiers de l’administration étatique, aristocrates féodaux, clergés…
[9] Le ministre Turgot souhaite un État fort au service du développement économique, quitte à s’en prendre aux gaspillages et privilèges des aristocrates. Suite à diverses pressions, Turgot est démis de ses fonctions en 1776 et laisse place au ministre Calonne qui, à partir du début des années 1780, n’hésite pas à tout « sacrifier à une noblesse qui devenait insatiable » (p. 56). Rapidement, on s’aperçoit que cette politique irrationnelle cause des effets dévastateurs : alors que Calonne propose de faire machine arrière, il est à son tour démis de ses fonctions en 1787. Les privilégiés sont hostiles aux ministres qui lui succèdent.
[10] Thèse également défendue, à l’appui d’une grande érudition, par Lucien Goldmann. Voir Goldmann Lucien, « La pensée des « Lumières » » in Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, Vol. 22 (4), 1967, p. 752 – 779. Disponible à l’adresse suivante : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1967_num_22_4_421569
[11] Comme le rappelait par ailleurs Daniel Bensaïd à l’occasion du bicentenaire de la Révolution : Bensaïd, Daniel, Moi, la Révolution, Paris, N.R.F/Gallimard, Coll. Au vif du sujet, 1989, p. 117 – 132.
[12] Petits-bourgeois, prolétaires, compagnons, « lumpenprolétaires »…
[13] La concentration populaire et ouvrière dans certains quartiers parisiens et ses conséquences lors des processus de contestation sociale sont des aspects étudiés par exemple par Maurizio Gribaudi. Voir Gribaudi, Maurizio, Paris, ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), Paris, La Découverte, 2014. Voir ma note de lecture de cet ouvrage
