Une science des intuitions
Sociologie et Anthropologie Travail social
06 Juin 2013
Imprimer
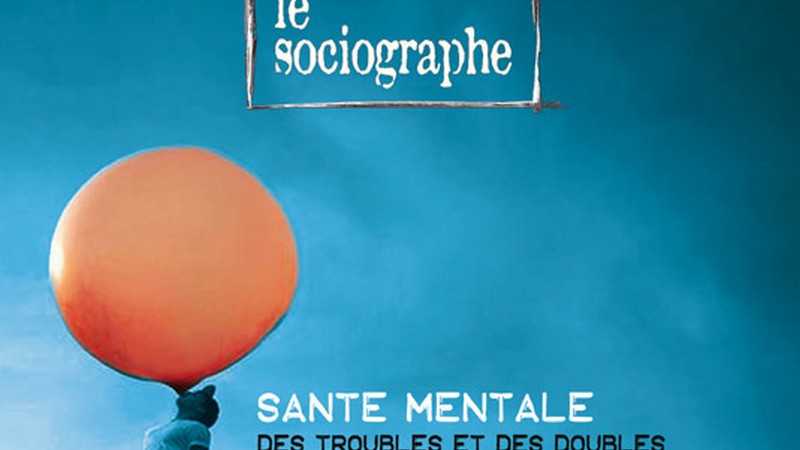
Jonathan Louli, « Une science des intuitions », dans Le Sociographe, n°42, juin 2013, p. 33 – 40.
Disponible à l’adresse suivante (avec tout le numéro du Sociographe): Cairn.info
Site de l’éditeur : Le Sociographe
Il en va de la liberté des opinions comme de la santé : individuelles toutes deux, on ne saurait pour aucune établir de règle générale. Ce qui est nécessaire à tel individu pour sa santé est déjà pour tel autre une cause de maladie
Friedrich Nietzsche, 1988, p.216.
La culture technique est inculture de tout ce qui n’est pas technique
André Gorz, 2004, p.144.
Les champs de la santé mentale et du travail social sont actuellement traversés par une série de questionnements, dont les principaux touchent en substance à la question fatidique : comment ces professions relationnelles (soignants, travailleurs sociaux…) peuvent-elles s’exercer dans le contexte économique et politique actuel, de durcissement des conditions socio-économiques ?
Avant même de savoir comment faire face à ces questions et à la plupart de celles que se posent chercheurs et praticiens, il faut savoir que faire ; autrement dit le travailleur doit toujours conserver près de lui une boussole – affective, éthique, politique… – qui produise et indique le sens que ce dernier aimerait donner à son activité.
Et l’on sait que dans une société en mutation, qui fait reposer toujours davantage de responsabilités sur l’individu (au travail et en dehors du travail, comme l’a montré Alain Ehrenberg par exemple) et valorise la course aux profits (économiques, culturels, symboliques…), un travail de soin et de relation qualitative ou éducative voit son sens perpétuellement mis en cause ; parfois instrumentalisé, parfois méprisé, la plupart du temps incompris – en un mot ces débats sont refoulés par tous ceux (« décideurs », « financeurs », médias) qui n’y sont pas confrontés sur le terrain.
Il ne faut pas beaucoup gratter pour que ce refoulé refasse surface, prouvant l’importance qu’il y a, pour ces activités professionnelles particulières, à empêcher que le sens ne sombre dans le marasme de la routine et soit oublié. C’est au cours d’une recherche réalisée dans plusieurs grandes villes du Nord-Pas-de-Calais entre septembre 2011 et juin 2012 dans le cadre de mon master de sociologie que j’ai été confronté à cette question, éminente s’il en est.
Ma recherche portait sur la façon dont les travailleurs sociaux faisaient face aux problèmes de santé mentale de leurs ayants droit. Elle m’a permis d’explorer plusieurs sous-champs du travail social, ces lieux et moments spécifiques où le travail social est confronté aux troubles psychiques, et l’investigation, essentiellement basée sur des entretiens avec des professionnels et quelques observations, m’a permis de m’enfoncer – phénoménologiquement, dirons-nous – dans la question du sens. À vrai dire, si le travail social était une maison, je dirais que je suis entré par une petite fenêtre, aux étages supérieurs, et que le sol s’est plusieurs fois dérobé sous moi, jusqu’à ce que j’atterrisse au niveau des fondations.
Je vais donc tenter de restituer ma visite dans la maison travail social, dans ses pièces très différentes, auprès de membres divers de cette grande famille. Parlant de donner ou redonner du sens aux choses, j’entreprendrai une première définition : la santé mentale ; puis je me concentrerai sur deux des principaux problèmes qui émergent dans la quête du sens du travail social – le problème du qualitatif et du subjectif, et le problème de l’évaluation et de l’objectif – tout en gardant à l’esprit que le thème de la santé mentale a été une porte d’entrée, condition méthodologique nécessaire mais non suffisante. Enfin je tenterai de tirer quelques-unes des conséquences de mes observations au-delà des champs du travail social et de la santé mentale (au-delà c’est-à-dire dedans mais aussi dans d’autres champs proches).
Porte d’entrée : la santé mentale
Le concept de santé mentale pose problème, car il évoque plutôt les domaines de la psychiatrie, du soin, en somme la pathologie plus ou moins lourde ; il est pourtant faux de considérer que ceux qui ne sont pas soignés par des « psy » ou des institutions sont en parfaite santé. C’est un des premiers problèmes auxquels j’ai été confronté au début de ma recherche : qu’entendre par santé mentale ?
On peut distinguer santé mentale pathologique, qui doit être l’objet de soins, de traitements, et la santé mentale non pathologique, troubles légers qui, s’ils sont détectés, ne nécessitent pas de prise en charge médicale lourde. Je me réfère donc ici à ce que depuis peu les sciences sociales appellent la souffrance, au sens par exemple de Jean Furtos :
Souffrir n’est pas une maladie, la souffrance psychique n’est pas la maladie mentale […] La souffrance psychique ou souffrance d’origine sociale peut, selon les situations, être « bien vécue », ou alors empêche de vivre, voire empêche de souffrir ; il peut s’en suivre une pathologie, définie comme ce qui empêche de vivre, voire une aliénation
Furtos, 2001, p.5
Il y a donc un ensemble de phénomènes, qui, tenant de la santé mentale non pathologique, font de plus en plus partie des objets du travail social, et un autre ensemble qui tient de la pathologie mentale, et a plutôt vocation (lorsque c’est matériellement possible) à être réorienté vers le domaine « psy ».
Ainsi, pour dire les choses plus clairement, mon hypothèse était que le contexte socio-économique qui va en se dégradant devait engendrer une vulnérabilité accrue des groupes sociaux les moins favorisés, les situations de difficultés socio-économiques (à la base desquelles on trouve la pauvreté, le chômage, etc.) engendrant un « stress », un « mal-être », une « déprime », etc., pour le dire simplement – soit cet ensemble de phénomènes psychiques que je rassemblais sous le thème de la souffrance – et j’ai cherché précisément à savoir comment les travailleurs sociaux faisaient pour faire face à la montée de cette problématique parmi leurs ayants droit. C’est ce que je vais tenter de restituer maintenant en étudiant un couple dialectique de problèmes : subjectif/qualitatif et objectif/quantitatif.
Le qualitatif et le subjectif
En cherchant d’abord à savoir si et, si oui, comment les travailleurs sociaux percevaient ce thème de la santé mentale, j’ai observé, lors des entretiens (dont sont extraites les brèves citations dans la suite du texte) l’utilisation de mots identiques dans la façon dont les professionnels voyaient les choses : confiance en soi, estime de soi, souffrance, mal-être, notamment. Mais ces concepts étaient utilisés avec des sens et une importance qui divergeaient d’un professionnel à l’autre : certains travailleurs sociaux accordent beaucoup d’importance à la confiance en soi et à l’estime de soi en tant que regards que l’individu peut porter sur ses propres qualités. D’autres travailleurs sociaux voient dans la confiance (en autrui, en les institutions, en l’« existant ») le lien à consolider pour lutter contre la marginalisation ; parfois encore on parle de « souffrance sociale », et on assimile mal-être et souffrance psychique (« traumatismes »), etc.
En somme, ce qui est important de retenir ici, c’est que, d’un côté, la pratique professionnelle des travailleurs sociaux est orientée par des objectifs précis, des principes moraux, des dispositifs politiques, institutionnels ou administratifs (notamment en ce qui concerne l’insertion) ; ces éléments forment un cadre collectif, un arrière-plan de la pratique, et sont connus par tous les travailleurs sociaux. Mais d’un autre côté, cependant, les travailleurs sociaux ne semblent pas avoir de définition commune de ce que j’appelais la santé mentale, ni de perception « théorisée » et largement partagée, ou de « protocole » formel face à une situation de souffrance.
Ainsi, si de nombreux travailleurs sociaux avaient comme idéal de ramener l’ayant droit vers les dispositifs existants pour « qu’il soit acteur de son projet de vie », à l’inverse, et par contraste, en matière de santé mentale, de nombreux professionnels faisaient plutôt remarquer que « chacun a sa définition » et sa démarche, en fonction de son expérience, de sa formation, de son vécu, de son réseau partenarial, etc. Et de la même façon, quand je demandais à un professionnel comment faisait-il pour « repérer » un ayant droit en souffrance, l’intégralité de mes interlocuteurs m’ont expliqué qu’ils se fondaient sur leur « ressenti », c’est-à-dire une appréciation subjective, et qu’il n’y avait rien qui ressemblât à une « grille de lecture », classification ou catalogue des troubles avec leur solution.
Ce qui est plus étonnant encore, c’est qu’en étudiant les mots, les concepts et les sens assimilés dans les discours, je me suis aperçu que les perceptions des travailleurs sociaux se rejoignaient. Ainsi, des professionnels m’ont parlé de souffrance psychique, de manque de confiance en soi ou d’estime de soi, mais m’ont expliqué qu’ils ne luttaient pas contre ces phénomènes en eux-mêmes, qui étaient des objets psychologiques, mais plutôt contre leurs causes et leurs conséquences sociales : isolement, solitude, manque de lien social, impossibilité de trouver une « place » dans la société, etc. Les travailleurs sociaux s’efforcent de ne pas faire un travail de psychologue, ils travaillent plutôt sur le lien social et les conséquences de sa fragilisation.
On peut donc retenir que l’appréhension du trouble psychique est très subjective, presque affective (c’est souvent une question de ressenti), et que, de même, dans la façon de faire face à cette problématique, « ça dépend de la relation » entre le travailleur social et l’ayant droit : la plupart de mes interlocuteurs m’ont expliqué qu’il s’agissait d’écouter et de comprendre, de faire preuve d’empathie et de patience plutôt que de manier des techniques d’évaluation. Il peut donc paraître étonnant, voire contradictoire, que dans les aptitudes professionnelles la subjectivité, l’empathie, l’affectivité occupent une telle place, alors que, propres à chaque individu, elles ne peuvent a priori qu’être difficilement assimilées à des « techniques » ou des « outils » professionnels.
L’étude que j’ai pu faire de la manière dont les travailleurs sociaux accompagnent un individu en souffrance m’a permis de recueillir le point de vue de ces professionnels, très largement partagé parmi mes interlocuteurs, selon lequel le travail social, au-delà même de cet accompagnement de la souffrance, apparaît comme un travail éminemment qualitatif, subjectif, d’une subjectivité envers une autre, d’un individu dans tout ce qu’il a d’humain, d’affectif, de faillible, en direction d’un autre individu qui lui est semblable en de nombreux points.
Pour autant, le travail social revendique une technicité, un professionnalisme, et son caractère fondamentalement subjectif pose de nombreuses questions, à commencer par la difficulté d’une évaluation (surtout selon des critères quantitatifs), comme on va le voir dans la partie suivante. Où l’on quitte le seuil de la maison, et où le sol se dérobe.
Le quantitatif et l’objectif
Il faut ici réaliser que la posture du travailleur social face à la souffrance, posture éminemment subjective et affective, est la posture professionnelle idéalement revendiquée par les travailleurs sociaux, en ce qu’elle est basée sur l’écoute et la compréhension d’autrui, en vue de parvenir à régler les problèmes des ayants droit et/ou accomplir leurs projets.
Le problème est alors que la plupart de mes interlocuteurs ont exprimé le sentiment d’être au mieux incompris, au pire peu valorisés, et peu reconnus par les échelons financeurs et décideurs élevés (supérieurs au niveau local) : la posture idéale du travailleur social est incompréhensible car ses effets ne sont a priori pas évaluables. Il me semble qu’en haut lieu on ne sait pas à quoi sert le travail social, son utilité est difficile à déchiffrer, c’est pourquoi on tente de le rendre plus lisible et plus « palpable » en confiant au travail social des objectifs évaluables, notamment des objectifs chiffrés : lutte contre le chômage, baisse des chiffres de la délinquance, réorientation de l’activité vers certaines tranches du public, activités évaluées selon le nombre d’ayants droit rencontrés, etc. Cela pose la question compliquée de l’objectif et de l’objectivité revendiqués par le travail social.
Selon mes interlocuteurs en effet, le travail social induit une posture professionnelle et donc une « objectivité ». Cependant, il me semble que dans les métiers où l’on observe et on accompagne l’humain, l’objectivité ne peut pas consister en une posture de négation de sa propre subjectivité et de refus de tout ce qui fait de nous un humain : le dilemme entre engagement subjectif et affectif et rigueur professionnelle se retrouve dans le travail social aussi bien qu’en sciences sociales par exemple.
Ainsi, une des conclusions de ma recherche est que, concernant les métiers « humains » ou « sociaux » (sciences humaines, travail social, enseignement, etc.) l’objectivité c’est la subjectivité ; c’est-à-dire que l’humain ne peut pas être calculé, prévu, géré : il est un être subjectif, affectif, donc « techniquement » imprévisible et ingérable (à moins de lui faire violence), et la relation, par exemple, entre un travailleur social et un ayant droit, ne peut pas être totalement maîtrisée par des techniques. L’objectivité, dans ces métiers, c’est donc de reconnaître la subjectivité et la sensibilité de ceux auprès desquels on travaille ; mais c’est aussi et surtout de reconnaître la subjectivité du professionnel. L’objectivité ce n’est pas d’essayer de bien faire son travail en atteignant des objectifs fixés par les décideurs ou les financeurs : car cette objectivité-là amène le professionnel à transformer ses ayants droit en objets, en chair à canons statistiques.
C’est bien pour cette raison que le travail social refuse d’être l’agent de la normalisation bête et méchante : reconnaître la subjectivité de l’ayant droit et chercher son épanouissement est en opposition avec la simple démarche de (trans)former un ayant droit pour « l’insérer » dans un moule, et le faire entrer dans les cases des tableaux des rapports d’activité.
C’est aussi pour ces raisons que le travail social est parfois en opposition avec les décideurs et les financeurs : ceux-ci ont une objectivité différente de celle des travailleurs sociaux, leur visée n’est pas la même. Les financeurs et les décideurs ont vocation à produire, servir et consolider un ordre des choses, un édifice social bâti notamment sur le travail et l’emploi. Or en période de récession économique et de montée du chômage, il est difficile, voire paradoxal de continuer à accorder une valeur positive aux gens seulement en fonction de leur travail et de leur emploi ; les travailleurs sociaux savent généralement qu’à la base le bonheur de chacun (qui est le but idéal du travail social) est bien loin de dépendre uniquement du travail et de l’emploi. La plupart de mes interlocuteurs m’ont dit qu’ils cherchaient à répondre aux désirs des ayants droits, à accomplir leurs projets, à les faire accéder, plus simplement, à l’autonomie. Et que tout cela ne dépend pas seulement d’être en emploi ou pas – c’est simplement la particularité de notre société que de lier aussi étroitement l’estime sociale au fait d’avoir un « bon » emploi et de ne pas être pauvre.
C’est pourquoi l’objectivité du travail social, un « bon » travail social, c’est aussi, parfois, de ne pas répondre aux objectifs, c’est de refuser de faire des ayants droit une simple « matière » à transformer pour alimenter les statistiques. C’est aussi refuser les objectifs qui, en valorisant seulement la réussite dans la forme et dans la norme, c’est-à-dire avoir des « bons » chiffres, poussent parfois les travailleurs sociaux à travailler seulement avec les ayants droit qui sont proches de remplir les objectifs, et à délaisser les cas désespérés, qui ne seraient que perte de temps aux yeux des évaluations quantitatives. Le travail social doit donc parfois être dans l’opposition : son éthique a une incidence politique.
Ce que m’a appris ma recherche sur l’accompagnement par le travail social des personnes en souffrance c’est que, de manière plus large que dans le seul domaine de la santé mentale, et contre la qualité subjective et le travail réalisé sur les liens intersubjectifs, sur l’identité (Autès, 1999, p.242 et suivantes), sur la reconnaissance, les « décideurs » et les « financeurs », bras armés d’une raison sociale abstraite, tronquée en une rationalité gestionnaire, économiciste, comptable, ou politicienne, font valoir des objectifs décalés qui aliènent les travailleurs sociaux. L’aliénation est précisément dans le fait que les travailleurs sociaux sont privés du sens qu’ils aimeraient donner à leur activité ; ce sens n’est pas reconnu, leur travail n’est pas « valorisé ».
On peut voir également l’aliénation dans le fait que le travail social revendique une « objectivité » qui est en fait constituée de l’ensemble de ces « objectifs » aliénants ; objectifs qui visent à constituer les « sujets » (les gens) en « objets » de la société, en les faisant travailler pour elle, en les faisant être en bonne santé (pour pouvoir travailler), en les formant scolairement (pour pouvoir travailler), etc. C’est le front des « objectifs », où se dressent les bataillons de chiffres et de procédures techniques, contre celui des « subjectifs », où s’ébattent les « personnalités » et les « émotions » ; dans une langue un peu bourdieusienne, on aurait dit qu’il s’agit de l’objectivité des objectifs objectivant contre la subjectivité des sujets subjectivant..
C’est la soumission à ces objectifs qui est productrice d’une « objectivité » aliénante, notamment en ce qu’elle castre la « posture » politique des travailleurs sociaux : le travail social est un travail profondément humain, comme on l’a noté précédemment, mais un travail d’humains aliénés à qui il est totalement dénié la possibilité d’être des animaux politiques (selon le mot d’Aristote dans La politique). L’aliénation est aussi dans le fait que la force des choses, comme je l’ai signalé, devrait appeler les travailleurs sociaux à des positionnements politiques, parfois à un militantisme – une posture de contestation de l’ordre qui génère massivement la souffrance des ayants droit et les injustices – en fait, on l’a vu, ils revendiquent une « objectivité » et une « déontologie », qui apparaissent maintenant largement comme un cache-misère de l’impuissance ressentie à changer les choses.
L’objectivité qui constitue les objectifs du travail social est celle qui ne voit en les individus que des « instruments » de la société, celle qui proclame qu’il faut « travailler plus » pour mériter une place, alors qu’on est en pleine crise du travail et de l’emploi, c’est la rationalité « qui en confortant l’opinion dans des attentes irréalisables, dans l’adhésion à des normes qui ne correspondent plus à rien (…) alimente les manichéismes, la recherche de boucs émissaires, l’idéologie et les pratiques protofascistes » (Gorz, 1997, p.99), comme l’écrivait André Gorz à une époque où les ministres n’étaient pas encore condamnés pour propos racistes, et où le Front National n’arrivait pas encore aux deuxièmes tours des élections présidentielles.
C’est là qu’est que réside la contradiction fondamentale dans laquelle est placé le travail social : servir une intégration sociale impossible parce que basée sur le travail et sur l’instrumentalisation des sujets ; et c’est dans l’adhésion à cette rationalité que se trouve une rationalisation du travail social.
Alors que le travail social est un travail foncièrement affectif, subjectif, éthique, il est réorienté vers « l’objectif », et en imposant partout leurs chiffres et leurs normes, les rationalités instrumentale et économiciste dominantes produisent la marginalisation de cette attitude fondamentale du travail social, plaçant celui-ci devant le risque de la déshumanisation.
Conclusion
À partir de questions posées aux travailleurs sociaux sur leur façon d’accompagner l’individu en souffrance, j’ai entendu et observé des postures similaires en dehors du domaine de la santé mentale, postures de travailleurs sociaux qui ont toutes en commun de mettre l’acte communicationnel au centre du travail social. Par acte communicationnel, j’entends ici l’établissement d’une relation entre professionnels et ayants droit où chacun écoute, dialogue, négocie, en vue de dépasser les obstacles qui empêchent l’ayant droit d’atteindre l’autonomie et l’estime sociale. Cette activité relationnelle induit des postures subjectives (empathie, écoute, affectivité, patience, éthique, idéaux, etc.) : beaucoup de travailleurs sociaux m’ont dit « on n’est pas là par hasard », on ne devient pas travailleur social par hasard, on le devient par conviction, sinon par vocation. On s’engage dans le travail social comme on s’engage dans une activité que l’on croit juste, et pas seulement utile ou comme emploi « alimentaire ».
La façon dont le travail social fait face aux troubles de santé mentale nous renseigne sur une posture idéale dans nos rapports avec autrui : du travail social, éducatif, thérapeutique, en passant par la recherche en sciences sociales, tout lien intersubjectif visant un progrès commun doit passer par le respect et la reconnaissance des subjectivités ; ce postulat justifie l’engagement contre les tendances sociales, politiques, institutionnelles…, qui nient les subjectivités en tentant de leur imposer des décisions, de les gérer ou de les manipuler.
Bibliographie
Autès Michel, Les paradoxes du travail social, Paris : Dunod, 1999.
Furtos Jean, « Précarité du monde et souffrance psychique », in Rhizome, n°5, 2001, p. 5.
Gorz André, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique, Paris : Folio Essais, 2004 [1988].
Gorz André, Misères du présent, Richesse du possible, Paris : Galilée, 1997.
Honneth Axel, La lutte pour la reconnaissance, Paris : Les Editions du Cerf, 2010 [1992].
Nietzsche Friedrich, Humain, trop humain I, Paris : Editions Gallimard, 1988 [1878].
